BILLET DE BLOG 30 AVRIL 2024
Le label du documentaire lancé par Mediapart et quatre autres partenaires
« État limite », comment bien soigner dans une institution malade ?
Tourné dans le sillage du jeune psychiatre mobile de l’hôpital Beaujon, à Clichy (Hauts-de-Seine), ce documentaire sensible sonde le délabrement de notre système de santé et l’épuisement de celles et ceux qui le portent au quotidien. La plongée terrible et fascinante de Nicolas Peduzzi dans un service de soins asphyxié sort en salle ce 1er mai avec le soutien du label Oh My doc !
Bande annonce État Limite de Nicolas Peduzzi© Alchimistes Films:
Fils de médecins syriens établis en France, Jamal Abdel-Kader a grandi dans les couloirs de l’hôpital public. C’est là qu’il se sent chez lui, là qu’il a décidé de poursuivre sa vocation de psychiatre. Tourné dans son sillage, ce documentaire de Nicolas Peduzzi sonde le délabrement de notre système de santé et l’épuisement de celles et ceux qui le portent au quotidien.
Comment bien soigner dans une institution malade ?
Des urgences au service de réanimation, de patients atteints de troubles mentaux à ceux qu’une maladie chronique retient alités. En dépit des impératifs de rendement et du manque de moyens, Jamal Abdel-Kader s’efforce d’apaiser leurs maux.

État Limite raconte évidemment quelque chose de la psychiatrie, mais il touche plus généralement à l’état de l’hôpital public en France. Le constat que fait Nicolas Peduzzi, comme le professeur Jamal Abdel-Kader, comme tous ceux qui choisissent de tendre l’oreille aux alertes de ses professionnels, c’est que l’institution se meurt, rongée de l’intérieur par la voracité de son modèle libéral.
Le récit choral présenté par État limite salue le courage du personnel soignant, mis en exergue par le contraste entre le rythme harassant de l’hôpital, poussé à l’extrême pendant la crise sanitaire, et les bulles de temps que Jamal, figure tutélaire, et son équipe aménagent pour leurs patients en souffrance.
*
Pour aller plus loin :
Lisez ci-dessous un texte du réalisateur Nicolas Peduzzi
Écoutez l’entretien du réalisateur et de Jamal Abdel-Kader dans l’émission Les matins du samedi sur France Culture
État limite a bénéficié du soutien à la créationde Mediapart et Tënk dans le cadre de l’appel à projets pour la visibilité du cinéma documentaire.

***
Notes de Nicolas Peduzzi :
« L’hôpital public français a toujours eu pour moi un visage amical : c’est lui qui avait sauvé mon père en 1990, lui qui m’avait accueilli et soutenu en service psychiatrique lorsque j’en avais eu besoin.
Il y a quatre ans, la crise sanitaire a révélé l’ampleur du mal-être de l’institution, mais les causes de la gangrène étaient évidemment plus profondes. J’ai voulu les interroger, comprendre où et comment s’était ouvert la brèche, et je me suis mis à filmer le quotidien des soignants de l’hôpital Beaujon.

Là, j’ai rapidement rencontré Jamal, figure indispensable et controversée. Indispensable: c’était le seul médecin psychiatre de l’établissement ; controversé ; malgré sa jeunesse, malgré tout son amour pour l’hôpital, il travaille vent debout contre les évolutions drastiques de l’institution, qui contredisent frontalement ses valeurs humanistes. Chaque jour, baskets aux pieds, il gravit et dévale à l’infini les escaliers de fer, courant d’un service à un autre et d’un chevet à un autre.
Jamal, c’est Sisyphe, et Beaujon sa montagne.
Notre premier contact fut frontal : en pleine explosion Covid, Jamal se méfiait des journalistes. Il a fallu que je montre patte blanche et lui prouve que ma démarche n’était pas journalistique. J’ai donc pris mes quartiers à Beaujon pour accompagner ses médecins et ses patients au long cours.
C’est là ce qui l’a convaincu : le temps, c’est le cheval de bataille de Jamal. Dans un environnement déraisonnable de vitesse, qui enterre les gens sous les chiffres, il se fait un devoir de prendre son temps avec ses patients et leurs proches, et de leur offrir l’attention et l’écoute que personne ne veut, ne peut plus leur prêter. Il apaise, rassure, oriente avec une patience infinie.

Un des enjeux du film, pour moi, est donc de faire exister ensemble ces temporalités contradictoires : d’un côté le rythme effréné de l’hôpital, en état d’urgence permanent – longs couloirs surpeuplés, échanges entre deux portes, cris des patients en demande d’attention ; de l’autre, les bulles de temps que Jamal aménage pour ses patients, imperméables au chaos.
Pour ses patients, mais aussi pour ses collègues : Jamal leur a consacré beaucoup de son temps et de son énergie pendant le Covid, et certains ont gardé l’habitude de s’ouvrir à lui de leurs problèmes. Le film fait donc aussi entendre les voix de Romain, aide-soignant, d’Alice et de Lara, les internes qui le secondent au quotidien, d’Ayman, ancien patient devenu stagiaire.
Toutes et tous partagent une même vocation et racontent l’amour du soin, mais aussi le vertige face à la souffrance des patients, leur propre mal-être, leurs doutes et leurs aspirations.
Jamal et ses internes sont les seuls médecins de Beaujon à circuler dans tous les services. A travers eux, j’ai donc eu accès à l’ensemble de l’hôpital. Partout le même constat : manque de financements, de lits, de personnel et de temps.
Tant de manques pourraient se payer d’un défaut d’attention. Ce n’est pas le cas : les soignants de l’hôpital Beaujon retendent chaque jour leur effort vers l’idéal humaniste qui les a conduits à s’engager. Pour autant, tout le monde n’est pas prêt à sacrifier sa vie et sa santé sur l’autel de ses idéaux.
Jamal est un personnage à part, hors du commun, dostoïevskien, un peu border en fait,qui substitue au monde tel qu’il est, le monde tel qu’il voudrait qu’il soit.

Le problème, c’est que le réel menace toujours de le rattraper. C’est son corps qui a donné l’alerte le premier : une douleur lombaire s’est installée au fil des semaines.
Et avec la douleur, le doute. Le film soulève ainsi le masque de confiance affiché par Jamal pour révéler ses doutes : a lui aussi, il semble parfois que les lignes ne bougeront pas assez vite, et que l’épuisement, la solitude, le manque de reconnaissance et le découragement finiront par avoir raison de sa vocation.
« Je me suis efforcé de filmer l’hôpital public tel qu’il est vécu par ceux qui le peuplent, médecins et patients confondus, et tel que je l’ai moi-même perçu au fil de mes mois d’immersion : comme une institution crépusculaire. »
Le film raconte la force de son idéalisme, mais on comprend que Jamal doit accepter les limites de son humanité. Lorsque Jamal est au chevet de ses patients, je recueille leur témoignage.
Je suis sensible aux personnalités troubles, et je partage avec Jamal cette idée que le dérèglement d’une société se mesure à la façon dont elle traite ses « fous ».
Après deux premiers documentaires sur des personnages tourmentés aux États-Unis, État Limite fait entendre la souffrance des gens qui échouent ou se réfugient à l’hôpital, et que notre société française s’arrange pour ne pas voir.
Au fond, l’hôpital Beaujon est un territoire aussi difficile d’accès que la banlieue de Houston, et les névroses des uns et des autres résonnent à l’unisson.
De manière générale, la gestion des troubles psychiatriques en France m’interpelle. Méconnue par les uns, dénigrée par les autres, la psychiatrie est indispensable à l’épanouissement de notre société.
Le décalage entre la fragilité des patients et la rigidité de l’institution, trop bureaucratique, trop protocolaire, est intolérable. Intolérable, enfin, le fait que des médecins doivent assumer la tâche écrasante de soigner les hommes que la société a rendus fous. »
Nicolas Peduzzi

*
État limite – France • 2021 • 102 minutes // Écriture et Réalisation : Nicolas Peduzzi // Assistanat de réalisation : Hortense Maunoury // Image : Nicolas Peduzzi, Laetitia de Montalembert // Son : Alexandre Bracq, Benoît Déchaut, Louis Bart, Antoine Pradalet // Montage : Nicolas Sburlati // Musique originale : Gaël Rakotondrabe // Mixage : Antoine Pradalet // Production : GoGoGo Films
*

Ce film a reçu le label “Oh my doc !” créé en 2020 par France Culture, la Cinémathèque du documentaire, l’associationLes Écrans, la plateforme Tënk et Mediapart afin de chaque mois soutenir la sortie en salle d’un documentaire remarquable.
Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.
L’HÔPITAL À BOUT DE SOUFFLE ENTRETIEN
« État limite » de l’hôpital public : « Pour lutter, il faut s’organiser collectivement, être subversifs »
Le film « État limite », qui sort en salle le 1er mai, suit un psychiatre dans les méandres de l’hôpital public, où l’humanité s’étiole. Isolé, en manque de moyens, il s’épuise parce qu’il refuse de transiger sur son éthique du soin. Réalisateur et psychiatre racontent.
PendantPendant deux ans, en 2020 et 2021, le réalisateur Nicolas Peduzzi a filmé l’hôpital Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine), dans les pas du seul psychiatre de l’établissement. Le docteur Jamal Abdel-Kader arpente en tous sens ce lieu intimidant, bâtiment ocre de onze étages, « gratte-ciel de la souffrance », disait-on lors de sa construction dans les années 1930.
Dans la scène d’ouverture du film, on suit Romain, aide-soignant aux urgences, un bouton marche/arrêt tatoué sur la nuque. Le service est en ébullition : un patient est en crise, les policiers qui l’escortent sont excédés. Débarque le psychiatre, qui temporise pour protéger le patient. Il parvient à faire baisser la tension, cet « état limite » que connaît aussi l’hôpital public.
Cette ouverture est aussi la scène de rencontre entre le réalisateur Nicolas Peduzzi et le docteur Abdel-Kader, qui devient sa focale sur l’hôpital, celui qui lui ouvre les portes des chambres des patient·es.
À contre-courant de soignant·es qui, par protection, se détachent, le docteur Abdel-Kader s’accroche à ses valeurs de soin, d’humanité. Il tisse des liens d’une grande intensité avec les patient·es. On le voit s’user, privé des moyens à la hauteur de sa tâche.
Le film finit par interroger la possibilité même de soigner, dignement, à l’hôpital public.

Mediapart : Pourquoi avoir choisi de filmer l’hôpital Beaujon, qui est un hôpital général sans service de psychiatrie, à travers le regard de son psychiatre ?
Nicolas Peduzzi : Un jour, il y a une grande tension aux urgences, parce que la police a amené une personne qui doit être évaluée par le psychiatre. Tout le monde l’attend. Et là, je vois arriver un type en baskets. Il a un truc un peu fou dans le regard. Moi, je ne peux pas m’empêcher d’être attiré par des gens un peu hors norme. J’adore sa façon de faire. Il parle avec la police, il essaie de temporiser. Au début, il s’agace que je filme. Puis hors caméra, on se rend compte qu’on parle un peu le même langage, je crois.
Jamal Abdel-Kader : J’ai vu un de tes films où les gens dévoilent des choses qui peuvent paraître honteuses, et que tu montres avec énormément de décence. Dans ta manière de filmer, j’ai retrouvé une manière que j’ai de travailler.
Quand on se rencontre, j’ai déjà des symptômes d’épuisement qui se manifestent surtout par de l’agacement, et plus tard par un mal de dos. Puis j’ai traversé d’autres symptômes plus graves : ma pensée était comme dans un brouillard, je ne parvenais plus à réfléchir comme avant.
Si tu te contentes de suivre les protocoles, tu es un médecin dangereux.
Jamal Abdel-Kader
Le film est rythmé par des séquences où vous montez et descendez des escaliers, intérieurs et extérieurs. L’hôpital paraît être un immense dédale.
Jamal Abdel-Kader : Comme cet hôpital est ancien, les rénovations se font difficilement, la moitié des ascenseurs ne marchent pas. Donc tu peux attendre l’ascenseur un quart d’heure. Pour éviter de perdre trop de temps, je prends les escaliers.
Je suis un psychiatre de liaison, j’interviens sur l’ensemble de l’hôpital Beaujon, qui fait onze étages. C’est un centre de référence pour les maladies du système digestif – le pancréas, l’intestin, le foie, les voies biliaires – et pour les polytraumatisés. Parfois, ces polytraumatismes sont le fait de situations psychiatriques aiguës, par exemple d’états délirants. Aux urgences, il y a aussi chaque jour quatre ou cinq patients qui doivent être vus par un psychiatre. Je peux donc être appelé dans chaque service, à tous les étages.
À LIRE AUSSILa contention, une « culture de la domination » en psychiatrie
17 septembre 2023
Petit à petit, j’ai découvert qu’au onzième étage, il y a pas mal de très jeunes adultes, qui ont des maladies très rares, chroniques, très invalidantes, qui bouleversent tout, leur vie familiale, scolaire, amicale, sentimentale.
La caméra suit ces jeunes jusque dans leurs chambres. Aux urgences, on voit des personnes très vulnérables, physiquement et psychiquement. Comment avez-vous obtenu l’accord des patient·es pour accéder à une telle intimité ?
Nicolas Peduzzi : C’est Jamal qui nous ouvre les portes. On a eu très peu de refus.
Aux urgences, c’était assez déroutant, mes préjugés étaient chamboulés. Une fois, face à une patiente qui paraissait un peu folle, Jamal m’a dit : « Vas-y, elle sait très bien ce qu’elle veut. » D’autres paraissaient très lucides, mais là Jamal m’interdisait de filmer. « Il est complètement intoxiqué », disait-il.

Jamal, vous organisez un atelier théâtre avec vos jeunes patient·es. On en voit certain·es se métamorphoser. Vous rencontrez aussi les familles pour renouer des liens coupés. N’allez-vous pas au-delà des missions classiques d’un psychiatre de liaison ?
Jamal Abdel-Kader : Ma pratique est atypique par rapport à la formation universitaire standard. Au bout d’un moment, tu te rends compte qu’il y a un écart entre ce qu’on te demande de faire et ce qu’il faudrait faire. C’est l’expérience du réel. Si tu te contentes de suivre les protocoles, tu es un médecin dangereux. Mon travail, c’est de soigner les gens, de faire en sorte que psychiquement ils souffrent moins, et peut-être qu’ils ne souffrent plus du tout.
Pour y parvenir, il faut soigner le milieu dans lequel est plongé le patient : l’institution qui est potentiellement maladroite, les interactions entre la personne et son entourage. Cela fait partie du travail de recueillir leurs récits, d’essayer de faire le pont.
Plus je réfléchis à ce que je fais, et plus une dimension m’apparaît fondamentale, en particulier avec les jeunes, c’est le travail. La philosophe Simone Weil écrit : « C’est par le travail que la raison saisit le monde et s’empare de l’imagination folle. » Faire du théâtre, c’est se mettre au travail.
Et il faut aller jusqu’au bout : le rétablissement, la guérison. Pour cela, il faut réfléchir à une formation, à un futur métier. Le problème, c’est que je ne peux pas faire cela tout seul, il faut construire un réseau. Cela n’apparaît pas dans le film, mais je suis en dialogue constant avec mes collègues, notamment les assistantes sociales. Mais les gens sont bien contents de se décharger sur moi. Si j’ai mal au dos à un moment donné, c’est parce que je porte beaucoup, beaucoup trop de choses.
Je voulais montrer qu’ils sont contraints d’avoir recours à des pratiques qu’ils ne valident pas.
Nicolas Peduzzi
Dans le film, vous paraissez très seul, sans aucun collègue psychiatre. Vous êtes d’ailleurs conscient que vous ne devriez pas vous « retrouver tout seul ainsi ».
Jamal Abdel-Kader : Je suis le seul psychiatre à temps plein, je n’ai avec moi qu’un ou deux internes, des externes, et des stagiaires en psychologie. Deux jours dans la semaine, un collègue au statut précaire m’aide uniquement sur les urgences. Pour pallier ce manque, les trois premières années à Beaujon, j’ai fait l’équivalent de six mois de temps de travail additionnel.
Nicolas Peduzzi : On arrivait vers midi, tu étais là depuis 8 heures du matin, et tu repartais vers 23 heures ou minuit. Et tu disais oui à tout le monde.

Jamal Abdel-Kader : Une organisation des soins, importée de l’entreprise, a dépecé l’hôpital depuis une trentaine d’années. Face à cela, il y a deux catégories de soignants. Il y en a qui se battent pour prodiguer des soins justes et protéger les patients d’une institution devenue maltraitante. Et il y en a d’autres qui font la grève du zèle : ils ne font plus que le travail prescrit par le management et ne font plus preuve d’une once humanité. Cela conduit à des accidents graves.
Pour lutter contre ça, il faut que les soignants soient subversifs. C’est ce que je fais, et c’est pour cela que j’ai l’air atypique. Mais tout seul, c’est vain. Il faut s’organiser collectivement pour tenir.
Nicolas Peduzzi : Tu dis que tu es subversif, mais tu ne fais pas des trucs de fou. Tu essaies de trouver une salle pour faire du théâtre. Tu apportes des plateaux-repas, tu files des cigarettes. Tu fais des choses censées, et on a l’impression que c’est exceptionnel. C’est ce que disent les personnes qui voient le film.
Jamal Abdel-Kader : Quand je sers un plateau-repas, ce n’est pas pour le plaisir. C’est pour entrer en lien avec la personne. Mais c’est surtout parce qu’on refuse, aux urgences, de servir des plateaux-repas : les gens pourraient s’habituer, revenir, notamment les indigents.
Aux urgences, il y a une scène de contention. On semble la voir, mais en réalité on ne fait que l’entendre. Nicolas, comment filmez-vous ce moment ?
Nicolas Peduzzi : Moi, je filme du point de vue de Jamal et de l’interne, Lara. C’est la première fois qu’elle assiste à une contention. Elle a été choquée, elle me l’a dit après.
Je baisse la caméra, parce que ce n’était pas possible de filmer : l’homme était intoxiqué, les soignants nerveux. Surtout, je voulais montrer qu’ils sont contraints d’avoir recours à des pratiques qu’ils ne valident pas. De ce moment-là, on a seulement le son, parce que Jamal était équipé d’un micro. On a choisi de montrer des photographies de l’hôpital.
Jamal Abdel-Kader : Dans cette scène, on « contentionne » un homme très alcoolisé, qui veut se suicider. Pour faire autrement, il faudrait être un certain nombre dans sa chambre, pour le retenir, y compris physiquement, mais sans le ligoter. Je suis convaincu qu’on pourrait se passer de la contention, avec plus de temps, de personnel.
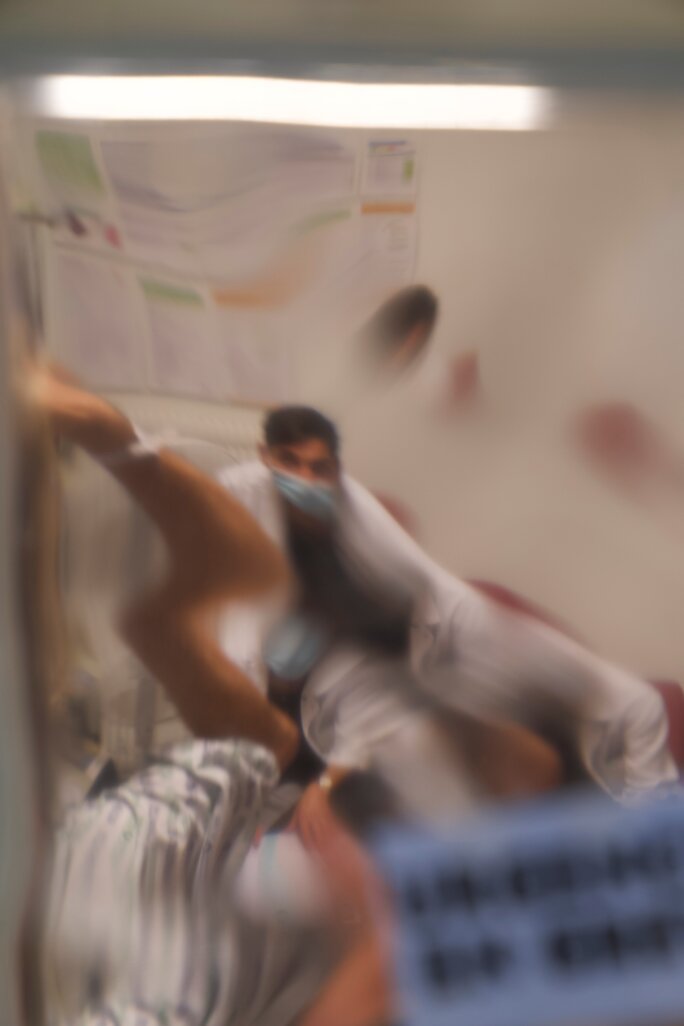
Jamal Abdel-Kader, vous ne voulez pas participer à la contention, pour quelles raisons ?
Jamal Abdel-Kader : Normalement, les médecins prescrivent la contention et n’y participent pas. Moi, je considère que c’est essentiel d’y participer. Sauf qu’à ce moment-là, j’ai le dos pété, j’ai peur de me faire encore plus mal. Ça ne tergiverse pas autant d’habitude parce que je suis à la manœuvre. Plus on est en nombre, moins il y a d’angoisse du côté soignants, mieux cela se passe pour le patient. Mais comme on n’est pas en nombre… J’emploie toujours des sédatifs. Pour moi, la contention doit se limiter au temps que le médicament fasse effet. Puis il faut détacher. Mais il y a une facilité à laisser les patients attachés, c’est une pratique courante. Parfois on oublie même de les sédater, ce qui est inhumain.
On assiste à une régression vers la psychiatrie sécuritaire, pas manque de moyens, de formation. J’ai travaillé à la prison de la Santé à Paris, j’en ai vu des gens délirants qui avaient commis des délits, des crimes qui auraient pu être évités. Ces gens, tu les vois dans la rue. Ça glisse, ça glisse. Il faut faire attention, dans un moment de panique on peut finir par ligoter et enfermer tout le monde.
Vous avez un échange avec une patiente en crise, sur votre pouvoir de psychiatre qui peut priver de liberté. Vous lui confiez que c’est pour vous un « dilemme très difficile ».
Jamal Abdel-Kader : Là encore, j’ai très peur du glissement qu’on peut opérer entre le principe juridique du devoir de porter assistance à une personne en danger, et des pratiques sécuritaires ou même, disons, paternalistes. Quand un psychiatre fait du contrôle social, il ne soigne pas. Quand il dénie l’intelligence et refuse le dialogue, souvent par manque de temps, il ne soigne pas non plus.
Tout comme pour la contention mécanique, si les psychiatres n’avaient plus la possibilité de priver de liberté des « fous », alors on serait obligés d’imaginer faire différemment. Et sans doute que c’est l’ensemble de l’organisation de nos sociétés, de nos institutions qu’il faudrait repenser. Une chose m’apparaît certaine : si on détruit les solidarités, si on laisse les plus fragiles livrés à eux-mêmes, ce sera l’explosion de la violence et du ressentiment. Pour éviter ça, il faut que les hôpitaux redeviennent des lieux accueillants, y faire preuve d’hospitalité.
L’hôpital est un lieu très hiérarchisé, notamment entre les médecins et les autres soignant·es, les agentes et agents hospitaliers. Dans le film, Jamal, vous interagissez avec tout le monde et vous nouez des liens forts avec un aide-soignant.
Nicolas Peduzzi : J’ai rencontré Romain, qui est aide-soignant, en premier. Il connaissait déjà Jamal, ils se parlent au quotidien. Ils sont souvent complices. Vous êtes tous les deux atypiques, vous partagez la même vision du soin, vous vous êtes trouvés.
Jamal Abdel-Kader : Cette question de la hiérarchie, je la renverse aussi dans ma réflexion du soin. J’accueille des personnes vulnérables, et pas à pas, par le soin, j’essaie d’arriver à une position horizontale, de restaurer l’autonomie.
À la fin du film, vous rapportez une conversation avec un psychiatre spécialiste du travail. Il vous dit de sauver votre peau, que l’hôpital public n’est pas un endroit où vous pouvez exercer correctement votre métier. En êtes-vous arrivé à cette conclusion ?
Jamal Abdel-Kader : À l’AP-HP [l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris – ndlr], c’est probablement fini pour moi : ils ont voulu me mettre au pas, je ne l’ai pas supporté, j’ai refusé de manifester un minimum de subordination. J’ai quitté l’hôpital Beaujon, je suis pour l’instant en disponibilité de mon poste. J’adorais pourtant ce travail. Sans toute cette bureaucratie, j’aurais tenu. Je ne vois pas ce film comme une rupture avec l’hôpital public, mais comme un parcours intellectuel, de réflexion sur ma pratique.