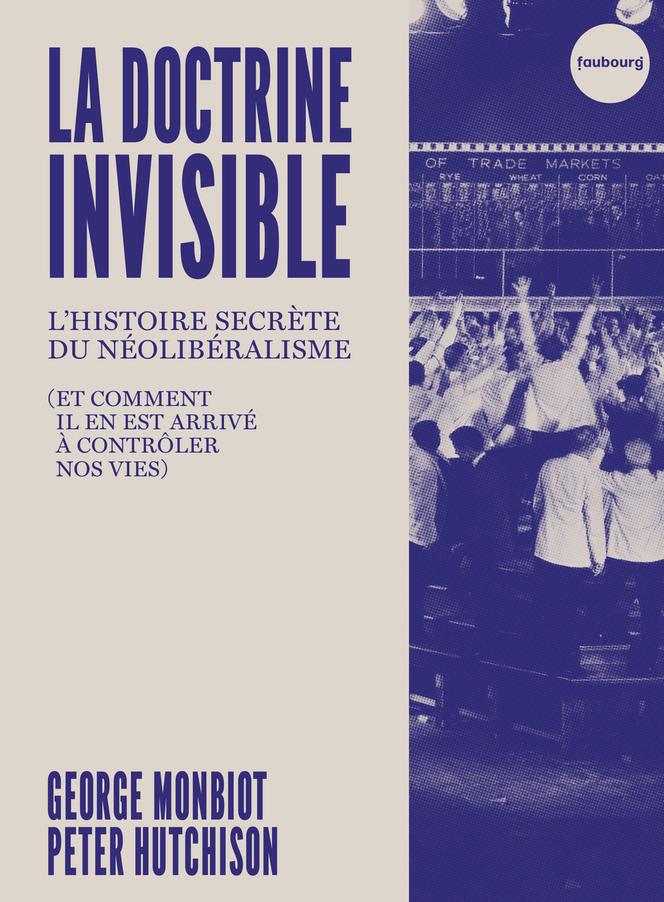George Monbiot, essayiste britannique : « Le consensus néolibéral des grands partis a fini par tuer l’espoir en politique »
Le néolibéralisme a réussi à faire croire que les choix politiques n’avaient pas d’importance face aux décisions économiques. Il faut donc s’en débarrasser en se rappelant qu’il est loin d’être une « loi naturelle » indépassable, affirme, dans un entretien au « Monde », le co-auteur de « La Doctrine invisible. L’histoire secrète du néolibéralisme ».
Propos recueillis par Pascal Riché
Publié aujourd’hui à 16h00, modifié à 16h06
Temps de Lecture 4 min.

Le néolibéralisme est devenu si omniprésent que nous ne le reconnaissons plus comme une idéologie, un système construit, mais comme un environnement naturel : c’est la thèse de La Doctrine invisible. L’histoire secrète du néolibéralisme (et comment il en est arrivé à contrôler nos vies) (Ed. du Faubourg, 256 pages, 21 euros), un ouvrage décapant signé par l’essayiste britannique George Monbiot, chroniqueur au Guardian, et le réalisateur américain Peter Hutchison. Le premier a répondu aux questions du Monde.
Chacun semble avoir sa propre définition du néolibéralisme. Quelle est la vôtre ?
Un système dans lequel on remplace le choix politique par le choix économique, ce qui conduit inévitablement à l’oligarchie, car ce n’est plus le citoyen qui est aux commandes. C’est le moyen par lequel le capitalisme surmonte son plus gros problème : la démocratie. Le néolibéralisme n’est pas une variante du capitalisme mais un catalyseur.
Jusqu’ici, ceux que l’on désigne par le terme « les marchés » favorisaient des partis modérés. Mais des candidats autoritaires et/ou populistes semblent avoir le vent en poupe auprès d’eux. Que s’est-il passé ?
Le consensus néolibéral au sein des partis dominants a fini par tuer l’espoir en politique. Cela a permis à des hommes comme Donald Trump aux Etats-Unis ou Javier Milei en Argentine de se faufiler dans la brèche. Ils portent le néolibéralisme à un tout autre niveau, prônant la destruction des services publics, l’austérité extrême, le remplacement du pouvoir public par le pouvoir privé…
Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « L’invention du néolibéralisme », de Serge Audier : néolibéraux, détestés et méconnusLire plus tard
Les capitalistes traditionnels, ceux que nous appelons dans le livre « capitalistes domestiqués », sont parvenus à une sorte de compromis avec le principe démocratique. Ils ne l’aiment pas particulièrement mais ils recherchent la stabilité et la prévisibilité. Ils ont favorisé des politiciens ternes, technocratiques et centristes : Emmanuel Macron, Tony Blair, David Cameron, Keir Starmer…
Mais sont apparus les « capitalistes seigneurs de guerre » qui cherchent quelque chose de complètement différent : ils veulent démolir le système et prospérer sur ses ruines. Pour y parvenir, ils poussent un modèle de leader politique différent, dénué de scrupules : Boris Johnson, Jair Bolsonaro, Narendra Modi, Benyamin Nétanyahou, Donald Trump, Javier Milei… Ces leaders font des dégâts énormes, mais ils leur offrent des occasions nouvelles dans un environnement encore plus déréglementé.
Que cherchent ces « seigneurs de guerre » qui sont déjà très prospères ?
La réponse est à chercher du côté psychique. Ils semblent souffrir d’un déficit majeur, un manque qui ne peut pas être comblé. Mais tout cela n’est pas tant une question d’argent que de pouvoir. Ce à quoi nous assistons, c’est une guerre de classes, mais entre quelques milliardaires et le reste de la société. Les milliardaires sont en train de la gagner. Avec à leur tête Donald Trump et Elon Musk, elle apparaît sous sa forme la plus brutale. L’homme le plus riche du monde va superviser directement un programme de coupes budgétaires dévastateur pour les plus pauvres !
Elon Musk est un personnage extrêmement particulier. Il n’est pas encore l’archétype des hommes d’affaires d’aujourd’hui…
Les exigences de l’argent changent avec le temps. Il y a quelques générations, la richesse était très digne, respectable, auguste. Des costumes bien coupés, un langage châtié. Maintenant, on voit un Elon Musk habillé comme un adolescent en quête d’attention, sautant sur place les poings en l’air. Mais peu importe à quoi l’argent ressemble : ses revendications sont toujours satisfaites, à moins qu’il n’y ait une contrainte démocratique suffisante.
Lire aussi la tribune | Article réservé à nos abonnés « Face à Elon Musk, il est temps pour l’Union européenne de défendre ses acteurs et ses valeurs »Lire plus tard
Cette contrainte démocratique, écrivez-vous, s’est affaiblie car le néolibéralisme a favorisé l’apathie dans les sociétés… Par quel mécanisme ?
Il prétend que la politique n’est pas le lieu où les décisions importantes doivent être prises. Ce faisant, il éloigne les gens de la politique, il la désenchante et il rejette la faute de cette évolution sur les individus : si votre enfant est peu éduqué, ce n’est pas à cause du système, c’est parce que vous êtes un mauvais parent. Si vous ne parvenez pas à payer vos factures, ce n’est pas parce que les loyers sont devenus impossibles à payer, c’est parce que vous êtes irresponsable… Et, à l’inverse, si vous êtes extrêmement riche, c’est parce que vous êtes très intelligent et entreprenant – peu importe que vous ayez volé l’argent ou que vous en ayez hérité… Le blâme est individualisé, le crédit est individualisé. Les gens internalisent ce système de croyance et cessent de croire que la société est une proposition transformatrice.
Pourquoi les électeurs ne se tournent-ils pas vers les partis qui proposent un modèle économique alternatif ?
En partie parce que le néolibéralisme a raconté une histoire très claire et cohérente. Il a construit un récit. Cela fait longtemps que la gauche n’a pas fait ça. Il faut remonter à John Maynard Keynes. Or on ne peut remplacer un récit que par un autre récit tout aussi cohérent. Les partis progressistes n’ont pas fait cela. Ils ont juste avancé une version atténuée du néolibéralisme. Et la pensée néolibérale a réussi à imposer un message hégémonique, le fameux « There is no alternative » de Margaret Thatcher.
Lire aussi la tribune | Article réservé à nos abonnés « La montée du péril totalitaire d’extrême droite est une des manifestations de l’entrée en crise du régime néolibéral »Lire plus tard
Quelle serait la bonne méthode pour proposer un récit alternatif ?
Cela ne passera pas par un grand personnage, un nouveau Keynes qui se grattera le menton et dira : « J’ai la solution complète. » L’effort sera collectif. Et il devra être, dans une large mesure, dirigé depuis les pays du Sud. J’y trouve plus d’espoir, plus d’idées, plus d’inspiration que dans mon propre pays.
Mais ne pensez-vous pas que dans ce Sud global, beaucoup de gens ont l’impression que la mondialisation et le capitalisme les ont sortis de la pauvreté ?
Le commerce, activité commune à toutes les sociétés humaines, a été un moyen très efficace de générer de la richesse mais il ne faut pas le confondre avec le capitalisme, invention beaucoup plus récente, qui est le moyen par lequel la richesse est capturée et accumulée. Le commerce n’a d’ailleurs pas attendu le capitalisme pour exister : il existe depuis des milliers d’années. L’augmentation de l’activité économique dans le Sud s’est produite malgré la diffusion du capitalisme, pas à cause de lui.
« La Doctrine invisible », le néolibéralisme au microscope
Il est impossible de combattre un mal quand on ne le voit pas. C’est avec cette conviction que l’essayiste britannique George Monbiot et le réalisateur américain Peter Hutchison ont écrit La Doctrine invisible (Editions du Faubourg, 256 pages, 21 euros). Cette doctrine, c’est le néolibéralisme, qui s’est installé au fil des décennies dans nos institutions, dans nos vies et – plus grave – dans nos têtes. « Imaginez que les habitants de l’Union soviétique n’aient jamais entendu parler du communisme, commence le livre. C’est plus ou moins ce qui nous arrive aujourd’hui. »
La Doctrine invisible est un décryptage méticuleux du néolibéralisme. Les auteurs l’exposent à la lumière pour l’affaiblir – l’« effet Dracula » – et démontrer qu’il ne s’agit que d’une construction lancée par le penseur Friedrich Hayek (1899-1992) et ses adeptes et financée par des grandes sociétés à travers des cercles de réflexion, des médias et des départements d’université. Avec la première ministre britannique Margaret Thatcher (1979-1990) et le président des Etats-Unis Ronald Reagan (1981-1989), le néolibéralisme s’est imposé, se présentant comme un progrès indépassable : « There is no alternative », tranchait la Dame de fer.
Le centre gauche a suivi. Les marchés ont été déréglementés, les syndicats écrasés, les services publics privatisés. Cette ère s’est soldée par un échec patent : une croissance faible, une richesse confisquée par les plus riches, une démocratie abîmée et un climat déréglé. Malgré tout, le « mort-vivant » qu’est le néolibéralisme continue de marcher. Pour l’arrêter, il faut inventer un nouveau « récit » aussi cohérent, plaident les auteurs. Mais qui l’écrira ?
« La Doctrine invisible. L’histoire secrète du néolibéralisme (et comment il en est arrivé à contrôler nos vies) », de Peter Hutchison et George Mondiot, Editions du Faubourg, 256 pages, 21 euros.