Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la progression électorale du Rassemblement national n’est pas le reflet d’une « droitisation » de la société française, démontre le chercheur en science politique. Un constat discuté par l’ancien ministre de l’éducation nationale.
Propos recueillis par Anne Chemin
Publié le 11 octobre 2024 à 06h00, modifié le 11 octobre 2024 à 17h43 https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/10/11/la-france-s-est-elle-vraiment-droitisee-entretien-croise-entre-jean-michel-blanquer-et-vincent-tiberj_6348689_3232.html
Temps de Lecture 13 min.
Année après année, scrutin après scrutin, les victoires électorales du Front national (FN), puis du Rassemblement national (RN), ont installé l’idée que, depuis les années 1980, la société française s’était profondément droitisée.
Le politiste Vincent Tiberj, professeur des universités, chercheur au Centre Emile-Durkheim (Bordeaux) et coordinateur du livre collectif Citoyens et partis après 2022. Eloignement, fragmentation (PUF, 424 pages, 22 euros), réfute ce constat dans La Droitisation française. Mythe et réalités (PUF, 340 pages, 15 euros). Les électeurs votent de plus en plus souvent à droite, voire à l’extrême droite, constate-t-il, mais les citoyens, eux, sont de plus en plus ouverts en ce qui concerne l’immigration. Si la France veut réduire ce fossé entre les valeurs de la société et la couleur politique de ses élus, conclut-il, elle doit inventer des pratiques démocratiques plus horizontales et plus participatives.
Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l’éducation nationale (2017-2022) d’Emmanuel Macron et directeur du Laboratoire de la République, un think tank qui combat l’« idéologie woke », ne conteste pas le constat de Vincent Tiberj. Aujourd’hui retiré de la vie politique, ce professeur agrégé de droit public à l’université Paris-Panthéon-Assas, qui vient de publier un livre sur ses années au gouvernement (La Citadelle, Albin Michel, 416 pages, 21,90 euros), admet que la France est de plus en plus tolérante à la diversité mais, contrairement à Vincent Tiberj, ne croit pas aux vertus des nouvelles formes démocratiques.
Vous démontrez, Vincent Tiberj, que la société française est de plus en plus ouverte sur les questions dites « de libéralisme culturel » – concernant la peine de mort, l’égalité hommes-femmes, le mariage pour tous, etc. – mais aussi de diversité. Quels sont les travaux démontrant cette analyse contre-intuitive ?
Vincent Tiberj : Les enquêtes sérieuses menées dans le temps long montrent sans ambiguïté, même si ce résultat peut surprendre, que la société française est de plus en plus tolérante envers l’immigration. Si l’on étudie, depuis 1984, l’indice longitudinal élargi de tolérance, un baromètre qui agrège 100 séries de questions et 1 366 points de données, on constate que la droitisation de la France « par le haut », celle du champ politique, ne s’est pas accompagnée d’une droitisation « par le bas », celle de la société. Au contraire !
Qu’il s’agisse de la contribution de l’immigration à l’économie, de l’enrichissement culturel lié au métissage ou de l’acceptation des enfants d’immigrés comme des « Français comme les autres », la société française est de plus en plus ouverte aux minorités ethniques et raciales. Le soutien au droit de vote des étrangers est ainsi passé de 34 %, en 1984, à 50 %, en 2022, et l’affirmation selon laquelle l’immigration est une « source d’enrichissement culturel » de 44 %, en 1992, à 73,5 %, en 2022. Quant à l’idée qu’il y a « trop d’immigrés en France », elle a reculé de 69 %, en 1988, à 55,3 %, en 2022.
Ce mouvement est lié à deux phénomènes : l’élévation spectaculaire du niveau de diplôme – faire des études induit une meilleure acceptation de la diversité des croyances, des modes de vie et des histoires familiales – et le renouvellement des générations – les Français les plus jeunes ont grandi dans un monde beaucoup plus métissé que leurs aînés, ce qui fait d’eux des citoyens plus ouverts.
Jean-Michel Blanquer, êtes-vous d’accord avec ce constat ?
Jean-Michel Blanquer : Il faut avant tout définir les termes d’un tel débat : quelle définition donne-t-on de la gauche et de la droite ? Et quels critères utilise-t-on pour classer les Français selon ces catégories ?
Le constat de Vincent Tiberj sur l’ouverture croissante de la société française est vrai. Les enquêtes montrent que l’Hexagone n’est pas le pays « moisi » que certains caricaturent : la France est beaucoup plus tolérante, aujourd’hui, envers l’immigration et la diversité. Or, c’est justement ce pays de plus en plus tolérant qui voit les scores de la gauche baisser spectaculairement depuis deux décennies. Le baromètre 2024 de la confiance politique du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) montre d’ailleurs que 36 % des personnes interrogées se situent à droite ou à l’extrême droite, contre 26 % à gauche ou à l’extrême gauche.
Plus encore que ce positionnement sur l’axe droite-gauche, ce qui me frappe dans cette étude, c’est que les Français sont de plus en plus nombreux à ne se reconnaître ni dans la droite ni dans la gauche : selon le Cevipof, 23 % refusent cette alternative et 15 % déclarent se situer au centre. Ce chiffre considérable (38 %) est l’illustration de la crise profonde que traverse le clivage droite-gauche.
Comment expliquez-vous cette crise, vous qui avez rejoint en 2017 un homme, Emmanuel Macron, qui proposait justement de dépasser ce clivage ?
J.-M. B. : La réponse, à mon sens, est à chercher du côté de l’offre politique. Les frontières traditionnelles entre les deux camps qui structuraient la vie politique depuis la Révolution se sont brouillées. La gauche a abandonné à la droite les thèmes qui étaient jadis les siens – je pense notamment à la laïcité. Aujourd’hui, quand on est l’héritier de Jules Ferry ou de Jean Zay, on est considéré par une certaine gauche comme de droite, voire d’extrême droite. Des pans entiers d’électeurs ou de sympathisants de gauche ont donc été expulsés vers la droite par la gauche elle-même ! Quant à la droite, elle est un peu cul par-dessus tête, notamment en matière économique : le programme économique et social du RN se rapproche à bien des égards de celui du Parti communiste…
Au fil du temps, le clivage traditionnel entre la droite et la gauche s’est émoussé. Emmanuel Macron, en 2017, en avait d’ailleurs pris acte en proposant aux Français de le dépasser. Ce clivage n’est peut-être pas éternel : s’il n’est plus pertinent, s’il ne colle plus au réel, il nous faut inventer de nouvelles catégories pour penser et agir dans le domaine politique. Pour ma part, je pense que ce clivage existe toujours en partie, mais qu’il n’est pas le seul : les clivages territoriaux, si déterminants dans la structuration politique des pays du continent américain, sont aujourd’hui très importants en France.
Vincent Tiberj, estimez-vous, vous aussi, que le clivage droite-gauche est moribond ?
V. T. : Il fut un temps, c’est vrai, où même les enfants pouvaient se placer sur un axe droite-gauche : c’était le cas, y compris à l’école primaire, jusque dans les années 2000, comme le montrent les travaux de recherche sur la socialisation politique. Mais depuis les années 2010, et surtout 2020, ce clivage s’est affaibli : s’il reste vivant en tant qu’outil cognitif permettant de comprendre la vie politique – les gens peuvent situer sur un axe droite-gauche Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron ou Eric Zemmour –, il a énormément régressé en tant qu’outil permettant de s’autodéfinir.
Lire aussi la chronique de Françoise Fressoz | « Le risque de la fin du dépassement voulu par Macron avec le retour du clivage gauche-droite est réel »
Je n’interprète cependant pas ce phénomène de la même manière que Jean-Michel Blanquer. Il n’est pas lié, à mon sens, au fait que les Français aspirent au dépassement d’un clivage « obsolète », comme l’affirmait Emmanuel Macron en 2016, mais plutôt au fait qu’ils rejettent massivement l’ensemble des formations politiques. La fraction des « sans-parti » est passée de 10 % dans les années 1990 à 50 % aujourd’hui et tous les partis – les formations anciennes, comme le RN ou le PS [Parti socialiste], comme les mouvements nouveaux, comme Renaissance – inspirent désormais aux Français une profonde défiance. Ce que rejettent ces « non-alignés », ce ne sont pas les valeurs de droite ou de gauche, mais les partis qui sont censés les incarner. C’est très différent.

Quand on observe la montée du RN, dont le cœur du programme est la dénonciation de l’immigration, on a du mal à comprendre pourquoi le mouvement d’ouverture envers la diversité ne se traduit pas dans les urnes. Pour expliquer ce décalage, vous invoquez, Vincent Tiberj, la politisation des valeurs par les acteurs politiques. Que voulez-vous dire ?
V. T. : Il y a un vieux débat, chez les politistes, consistant à se demander si les responsables politiques se contentent d’exprimer les valeurs des forces sociales en présence, ou s’ils parviennent à imposer des thématiques « par le haut ». La seconde proposition me semble incontestablement la plus solide : les études montrent que les valeurs des citoyens sont plus mouvantes qu’on ne le croit et qu’elles évoluent en fonction du contexte, du voisinage, des réseaux interpersonnels, ainsi que de la manière dont les élites politiques, médiatiques et sociales cadrent le débat public.
Le combat principal des acteurs politiques consiste en réalité à dicter l’agenda : ils poussent certains sujets et façonnent la manière dont on en parle ; que ce thème soit, ou non, au cœur des préoccupations de l’électorat. Leurs discours sur la société française ne correspondent donc pas forcément à la réalité du terrain, et ils ont, à ce titre, une grande responsabilité dans la physionomie du débat public. Si la laïcité nourrit des controverses récurrentes, voire obsessionnelles, ce n’est pas parce que ce thème taraude les Français : c’est parce que l’extrême droite et la droite en ont fait le cœur de leur offensive idéologique.
Jean-Michel Blanquer, diriez-vous, vous aussi, que le personnel politique façonne le climat du débat public ?
J.-M. B. : Oui, la mise sur agenda de thèmes prioritaires fait partie du travail des élus. Ils gagnent les batailles politiques quand ils ont réussi à installer un sujet au cœur du débat, et également quand ils en ont imposé la logique sémantique. Je ne suis pas sûr que la droite soit plus forte que la gauche sur ce terrain : un journal comme Le Monde, par exemple, a un très grand rôle, tant pour les thèmes que pour les mots qui structurent le débat public, et ce n’est pas un journal de droite. C’est également vrai pour l’audiovisuel public ou pour d’autres lieux d’influence « gramsciens » [du philosophe marxiste italien Antonio Gramsci, qui estimait que la conquête du pouvoir ne peut se faire qu’à condition de gagner la bataille de l’opinion et d’atteindre l’hégémonie culturelle], comme l’université, qui sont beaucoup plus de gauche que de droite.
Lire aussi | L’hégémonie culturelle, mère de toutes les batailles politiques
Les élus cherchent, et c’est normal, à modeler l’offre politique ; cependant, les thèmes qu’ils adoptent n’ont aucune chance de se développer s’ils sont artificiels, s’ils ne répondent à aucune demande. J’ai pu le constater lorsque j’étais ministre de l’éducation nationale : contrairement à ce que dit Vincent Tiberj, les atteintes à la laïcité ne sont pas des inventions des responsables politiques, mais des réalités auxquelles sont confrontés les Français. Je pense, bien sûr, au port de signes ostentatoires en milieu scolaire, ainsi qu’à tous les petits faits qui, au quotidien, minent la laïcité : quand certains enfants non musulmans, par exemple, se font harceler à la cantine parce qu’ils mangent du jambon.
Dire que le sujet de l’immigration est instrumentalisé par les hommes politiques de droite est, selon moi, une manière de refuser de regarder la réalité en face. Les Français peuvent très bien être plus ouverts qu’autrefois et, en même temps, ne pas vouloir de la poussée de l’islamisme intégriste et politique grâce à de la fermeté régalienne. Ils peuvent donc avoir des valeurs qui correspondent à la gauche historique, celle de Georges Clemenceau ou de Pierre Mendès France, et s’identifier à des partis du centre et de la droite si la nouvelle gauche ne sait pas prendre en compte ce qu’ils vivent.
Lire aussi | Pierre Mendès France, la gouvernance de la raison et de la pédagogie
C’est malheureusement la déconnexion à laquelle on assiste : quand les partis dominants à gauche renoncent à leur logiciel humaniste et universaliste au profit du différentialisme, cela recèle, à mon avis, de grands dangers. Le signe le plus grave en a été récemment les prurits d’antisémitisme à l’extrême gauche.
V. T. : Vous affirmez que les combats des représentants politiques ne prospèrent que s’ils se font l’écho des inquiétudes des Français. Le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) de 2023 montre pourtant tout autre chose : l’obsession migratoire de la droite et de l’extrême droite ne reflète pas les préoccupations des citoyens. Lorsqu’on les interroge sur leurs craintes, les sujets cités sont, dans l’ordre, le niveau de vie, les inégalités sociales, la délinquance, le terrorisme, le racisme, l’environnement et le système de santé – l’immigration n’arrive qu’après. L’attention politique et médiatique autour de cet enjeu vient non pas d’en bas – la société française –, mais d’en haut – les élus de droite et d’extrême droite.
En politisant sans relâche, depuis les années 1980, les questions d’immigration, voire les faits divers, ces élus ont exacerbé les clivages sur l’islam et l’immigration, comme le montrent nos débats sur la laïcité. Historiquement, la laïcité d’Aristide Briand, en 1905, était destinée à organiser les relations entre l’Etat et les religions et à faire en sorte que chacun puisse croire ou ne pas croire. Néanmoins, à partir des années 1990, elle a pris un tour identitaire : elle a été mise au service de la défense d’une France considérée – à tort – comme homogène. Le discours républicain a souvent servi, et c’est dommage, à cacher des préjugés racistes.
Cette polarisation des valeurs a beaucoup fait progresser – on le mesure dans le baromètre de la CNCDH – l’hostilité envers les pratiques des musulmans, y compris celles qui relèvent de la sphère privée : ne pas manger de porc, ne pas consommer d’alcool, respecter le ramadan ou faire régulièrement sa prière a été, de plus en plus souvent, considéré comme un obstacle au vivre-ensemble – comme s’il fallait que tous les Français aient les mêmes modes de vie. Ce « cadrage musulman » masque non seulement les données chiffrées très solides qui montrent que l’intégration, en France, fonctionne plutôt bien, mais aussi les discriminations dont sont victimes les personnes issues de l’immigration.
Pour expliquer le décalage, en matière de diversité et de racisme, entre les opinions des citoyens et le vote des électeurs, vous ne vous contentez pas d’invoquer, Vincent Tiberj, le phénomène de la « politisation des valeurs ». Vous analysez également le rôle de l’abstention ou, plus exactement, le fait qu’elle ne touche pas tous les citoyens de la même façon. Qu’est-ce à dire ?
V. T. : Au début de la Ve République, l’abstention concernait des électeurs qui ne s’intéressaient pas à la politique : c’était l’abstention « hors du jeu », selon les mots de la politiste Anne Muxel. Toutefois, depuis la fin des années 1990, le refus de se rendre dans les bureaux de vote est devenu une manière d’exprimer des convictions : c’est l’abstention dite « dans le jeu ». Elle touche non plus des citoyens mal intégrés à la société, mais des jeunes et des diplômés de l’enseignement supérieur qui ont des préférences politiques, mais qui ne se sentent pas représentés par les partis. Ces citoyens sont « distants », certes, mais ils ne sont ni « aciviques » ni « sans avis ».
Si tous les secteurs de la population s’abstenaient de la même manière, l’abstention ne fausserait pas le résultat des élections – et n’affecterait donc pas les succès de l’extrême droite dans les urnes. Mais ce n’est pas le cas. Les électeurs « distants » et « intermittents », qui sont de plus en plus nombreux, ont un profil très particulier : ces jeunes et ces diplômés du supérieur sont précisément ceux qui sont les plus tolérants envers l’immigration. En se détournant du vote, ils contribuent donc à la droitisation de l’espace politique.
Les électeurs qui continuent à se rendre très régulièrement dans les bureaux de vote sont, en revanche, majoritairement issus des classes moyennes et supérieures de la génération du baby-boom et ils affichent, comme le montrent les enquêtes, des convictions plus conservatrices, notamment en matière d’immigration. Ces « votants constants », qui sont réticents envers la diversité, pèsent donc beaucoup plus lourd, dans les urnes, que les « votants intermittents », plus tolérants. Ce qui explique que l’ouverture croissante de la société ne se reflète pas dans les résultats électoraux.
Jean-Michel Blanquer, comment comprenez-vous la progression de l’abstention ?
J.-M. B. : La montée de l’abstention est presque toujours synonyme d’affaiblissement des institutions, même si, comme aux Etats-Unis autrefois, une forte abstention a été vue par certains comme une approbation tacite des institutions. Françoise Subileau et Marie-France Toinet, en comparant la France et les Etats-Unis en matière d’abstention [dans Les Chemins de l’abstention. Une comparaison franco-américaine, La Découverte, 1993], nous avaient montré à quel point des contextes différents supposaient des interprétations distinctes du phénomène.
Les facteurs qui nourrissent l’abstention sont ceux qui affaiblissent la démocratie : certains électeurs ont un sentiment d’inutilité du vote, soit parce qu’il est mal pris en compte, comme dans le cas du référendum aboutissant au refus du traité constitutionnel européen de 2005, soit parce qu’ils ont le sentiment d’une faible maîtrise des choses par les gouvernants. S’enclenche alors un cercle vicieux délétère pour la légitimité des institutions.
La démocratie est aujourd’hui fragilisée par quatre types de facteurs qui nourrissent aussi l’abstention : l’impuissance politique ; le court-termisme des décisions ; l’asymétrie des outils de la démocratie face aux forces antilibérales ; le consumérisme politique et juridique des citoyens. La brutalisation de la vie politique est l’un des indices et l’une des causes de cette situation. Nous devons y prendre garde. Pour y remédier, la politique doit davantage illustrer sa capacité à donner un sens et une réalité au destin collectif. Dans ce contexte, l’idéal républicain est, à mes yeux, plus pertinent que jamais.
Vous serez sûrement d’accord pour constater l’essoufflement, voire l’épuisement, de nos institutions démocratiques, mais vous ne le serez pas forcément sur les remèdes. Faut-il, Vincent Tiberj, inventer d’autres manières de consulter, de voter et de délibérer, comme avec les budgets participatifs, les conventions citoyennes ou les référendums locaux ?
V. T. : Le divorce que je constate, en France, entre la droitisation « par le haut » et l’absence de droitisation « par le bas » doit nous conduire à nous interroger sur la légitimité de nos représentants politiques. On ne peut pas se contenter de dire aux Français qui sont déçus par leur personnel politique que s’ils veulent être entendus, ils doivent retrouver le chemin des urnes. En militant dans des associations, en signant des pétitions, en organisant des boycotts, en participant à des maraudes pour les sans-abri, ces citoyens « intermittents » fabriquent du commun loin des bureaux de vote, loin des partis politiques et loin des élus nationaux.
Lire aussi la tribune | Cyril Dion : « La convention citoyenne pour le climat a permis de mesurer à quel point la démocratie est un exercice exigeant »
Si l’on veut consolider la démocratie française, il faut qu’elle cesse de se méfier des citoyens : ils doivent au contraire être accueillis dans les institutions grâce à l’invention de nouvelles formes démocratiques. Ils sont parfaitement capables de jouer leur rôle, comme l’ont montré la convention citoyenne sur le climat et celle sur la fin de vie. Au terme d’une longue délibération, ces Français tirés au sort ont élaboré des propositions à la fois équilibrées et documentées, comme l’avaient fait, avant eux, les citoyens tirés au sort des conventions de Colombie-Britannique et d’Irlande.
Jean-Michel Blanquer, partagez-vous ce diagnostic sur les conventions citoyennes ?
J.-M. B. : Je ne crois pas qu’il faille opposer les formes démocratiques nouvelles aux anciennes. La démocratie représentative me semble de plus en plus nécessaire si elle est rénovée dans une optique qui favorise le sens du long terme, de la nuance et de la complexité. Elle doit permettre de délibérer et de voter loin du simplisme et de la schématisation qui caractérisent souvent le débat public. Le spectacle navrant donné par l’Assemblée nationale depuis 2022 ne doit pas discréditer la démocratie représentative : il est le fait de ceux qui veulent la mettre à bas.
Pour aller au bout du projet des Lumières, il faut cependant ajouter de l’horizontalité à la verticalité. La notion de participation doit, selon moi, irriguer en profondeur la société française : je crois à l’utilité des initiatives ancrées dans les territoires, comme la participation économique – quand l’entreprise Duralex est sauvée par une coopérative de salariés, cela crée des liens –, mais aussi la participation associative – quand un collectif de citoyens crée des magasins en milieu rural ou quand des parents d’élèves interviennent au sein d’une école, cela crée du commun autour des valeurs républicaines.
Les conventions citoyennes sont utiles dès lors qu’elles nourrissent les institutions représentatives. Elles peuvent créer des formes de délibération éclairées, mais elles ne constituent pas l’alpha et l’oméga de la vitalité démocratique. Il ne faut pas affaiblir la puissance publique : l’Assemblée nationale et le Sénat doivent rester au cœur du processus démocratique.
« La Droitisation française. Mythe et réalités », de Vincent Tiberj : quand la France connaît une « grande démission »
C’est un livre convaincant qui va à l’encontre des idées reçues. Dans La Droitisation française. Mythe et réalités (PUF, 340 pages, 15 euros), le politiste Vincent Tiberj démontre avec beaucoup de précision et de rigueur que, contrairement aux discours convenus, la droitisation de la scène politique, depuis les années 1980, ne reflète pas la droitisation de la société. S’appuyant sur des enquêtes comprenant plus de 100 séries de questions posées à l’identique pendant quarante ans, il constate que la société française est de plus en plus ouverte au « libéralisme culturel », mais aussi à l’immigration.
Analysant l’évolution sur le temps long des « indices longitudinaux de préférences », le politiste déconstruit pas à pas le « mythe » d’une France conservatrice. Si cette tolérance croissante des Français envers les minorités ethniques et raciales ne se traduit pas dans les urnes, analyse le chercheur, c’est parce que beaucoup d’électeurs « ouverts » à la diversité, notamment parmi les jeunes et les diplômés, se détournent du vote et parce que l’extrême droite mène depuis les années 1980 un combat acharné pour politiser la question de l’immigration.
Plus qu’à une droitisation, conclut Vincent Tiberj, la France est aujourd’hui confrontée à une « grande démission » : les acteurs politiques occupent la scène, leur parole est commentée dans les médias, mais ils jouent leur rôle « face à une salle de plus en plus vide ». Le décalage entre les valeurs de plus en plus ouvertes des citoyens et les votes de plus en plus conservateurs des électeurs ne cesse de croître, nourrissant jour après jour une crise démocratique. En offrant un visage déformé du monde social, la scène politique peine désormais à assurer sa fonction de représentation.
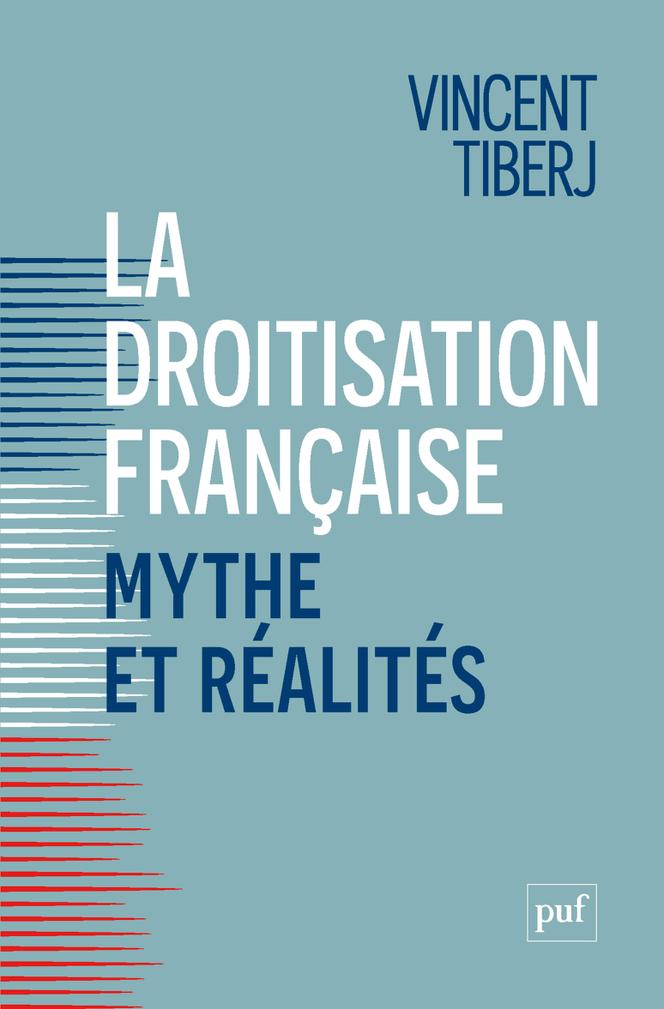
L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.S’abonner