Bernard Lahire : « Le rapport parent-enfant est une matrice de la domination omniprésente dans les sociétés humaines »
Avec son nouvel ouvrage, Bernard Lahire fait le pari vertigineux de rapprocher biologie et sociologie pour repenser à nouveaux frais toutes les organisations des sociétés humaines. Entretien.
2 septembre 2023 à 14h56
https://www.mediapart.fr/journal/culture-et-idees/020923/bernard-lahire-le-rapport-parent-enfant-est-une-matrice-de-la-domination-omnipresente-dans-les-s?utm_source=quotidienne-20230902-170007&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-quotidienne-20230902-170007&M_BT=115359655566
Que peuvent nous apprendre les écrevisses, les chimpanzés et les loups sur le fonctionnement des sociétés humaines ? Pourquoi l’humanité n’a-t-elle quasiment jamais connu d’organisations sociales égalitaires ? Comment expliquer que la domination masculine constitue un fait quasi universel ?
C’est un projet vertigineux et un pavé d’un millier de pages dans la mare des sciences sociales que signe le sociologue Bernard Lahire, professeur à l’ENS de Lyon, en publiant Les Structures fondamentales des sociétés humaines, aux éditions La Découverte.
Le chercheur, habitué des projets ambitieux, dont récemment une réinterprétation sociologique des rêves, ne propose en effet ici rien de moins qu’une refondation complète du socle des sciences de l’homme, à partir notamment d’une comparaison extensive entre les sociétés humaines et les sociétés non humaines et d’un arrimage des sciences sociales aux sciences de la vie.

À l’opposé d’une idée répandue qui distingue les sciences de la matière comme des sciences expérimentales, contrairement aux sciences sociales qui ne pourraient pas l’être, Bernard Lahire rappelle « qu’une partie non négligeable de ces sciences ne sont pas expérimentales, mais reposent, comme les sciences sociales, sur l’observation (au sens large du terme). Ni la cosmologie, ni la climatologie, ni la géologie, ni la minéralogie, ni la biologie évolutive, ni la zoologie, ni l’écologie, ni la paléontologie ne s’appuient pour l’essentiel sur des expériences en laboratoires ».
Pour le chercheur, « l’un des points qui ressort de ce travail, et qu’il [lui] aurait été impossible de prévoir avant d’être très avancé dans la recherche, est le fait que les sociétés humaines sont travaillées à la fois par des propriétés biologiques quasi constantes qui pèsent sur leurs structures profondes et par le poids de l’histoire, c’est-à-dire de l’accumulation culturelle au sens large du terme (savoirs et savoir-faire, artefacts, rites, institutions, etc.) ».
Bernard Lahire formule à partir de là des critiques très sévères sur l’état des sciences sociales contemporaines, « spécialisées, enfermées dans des aires géographiques, des périodes historiques ou des domaines de spécialité très étroits », leur « oubli du réel », leur fascination pour les « discontinuités » menant à un hyper-relativisme et un hyper-constructivisme, ou encore les « formations sans grand intérêt » des écoles doctorales qui devraient s’appeler « écoles de saut d’obstacles pour freiner la progression scientifique des apprentis chercheurs »…
En proposant de connecter davantage sciences de la nature et sciences sociales afin d’établir un nouveau paradigme pour ces dernières, il entend dégager des « lois sociologiques » susceptibles d’expliquer à nouveaux frais l’organisation des sociétés humaines.
Révolution copernicienne
« Au cours de ce long parcours durant lequel j’ai intentionnellement mêlé des références aux sciences naturelles et aux sciences sociales, j’insiste sur le fait qu’il n’a jamais été question de déterminisme génétique, car la biologie de l’espèce pèse sur le monde social essentiellement à un autre niveau de complexité que celui où se situent les gènes», tient-il à déminer en ayant conscience que sa démarche, appuyée sur des milliers de références, est à contre-courant de ce qui se pratique aujourd’hui.
Pour lui, le tabou qui pèse sur l’idée qu’il y aurait des « invariants » sociaux ancrés dans notre histoire et notre condition biologique vient notamment du fait que les « interdits sont scientifiques mais aussi politiques, et la peur de “naturaliser“, de “fataliser” ou de “désespérer” toutes celles et ceux qui luttent contre toutes les formes d’inégalité et de domination est présente jusque dans les rappels rituels du caractère historique des lois ».
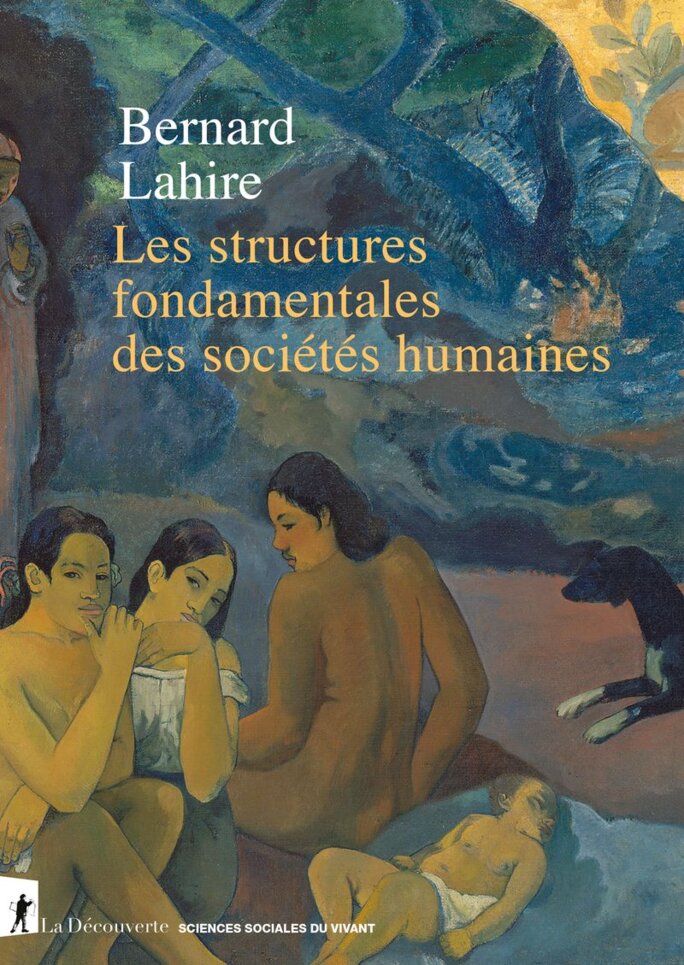
Ces invariants, pour reprendre les mots de l’anthropologue Françoise Héritier, ne sont pourtant pas « des universaux au sens que les philosophes donnent à ce terme ». Mais ils constituent des infrastructures des sociétés humaines dont la culture permet parfois de s’écarter, sans toutefois en effacer tous les effets. Bernard Lahire convoque comme exemple de ce type la manière dont les humains, avec l’extension de l’élevage laitier ou la maîtrise du feu, ont été progressivement capables de digérer le lactose, ont acquis la capacité de supporter l’inhalation de bois brûlé ou ont modifié leur appareil digestif avec la possibilité de cuire les aliments…
Plus récemment, il cite le primatologue et éthologue néerlandais Frans de Waal analysant la manière dont les « césariennes ont tout changé » : « Aux États-Unis, 26 % des naissances se font par cette voie, et jusqu’à 90 % dans certaines cliniques privées au Brésil. De plus en plus de femmes au bassin étroit survivront et transmettront un trait qui signifiait un arrêt de mort il y a encore quelques générations. Il en résultera inévitablement un nombre grandissant de césariennes, jusqu’au jour où l’accouchement par les voies naturelles deviendra l’exception. »
Avec cet ouvrage, Bernard Lahire propose une petite révolution copernicienne qui ne devrait laisser personne indifférent. Entretien.
Mediapart : Quel est l’objectif premier de ce livre aussi singulier qu’ambitieux dont vous écrivez qu’il est le travail « le plus risqué scientifiquement qu’il [vous] ait été donné de faire » ?
Bernard Lahire : Il y a, d’une certaine manière, trois livres en un. Le premier est une critique d’une épistémologie implicitement ou explicitement régnante dans les sciences sociales contemporaines, à savoir une épistémologie constructiviste, nominaliste, qui ne croit pas à la possibilité de dégager des lois ou des principes généraux de fonctionnement du monde social, et qui conduit à penser qu’il n’existe pas de cumulativité scientifique dans les sciences sociales. C’est l’épistémologie formulée par Max Weber, puis développée par Jean-Claude Passeron.

Pour elle, les sciences sociales sont vouées à demeurer « éternellement jeunes », à repartir de zéro à chaque nouvelle enquête. Certains appellent cela un « régime de scientificité », mais j’y vois personnellement un abandon de l’ambition scientifique. Depuis que je lis des sciences sociales, j’ai la conviction qu’il y a chez des auteurs et dans des traditions très différentes, des acquis fondamentaux mais qui sont laissés en jachère. C’est un véritable gâchis.
Le second livre vise à raccorder les sciences de la nature – et tout particulièrement la biologie évolutive, l’éthologie et la paléoanthropologie – et les sciences sociales – anthropologie, histoire, sociologie, etc.–, tenues par beaucoup comme radicalement incompatibles. Pourtant, il faudrait au minimum que les connaissances produites par les unes et les autres ne soient pas contradictoires entre elles.
Ce « raccordement » ou cette « articulation » a pour but de mettre au jour des éléments fondamentaux concernant le fonctionnement des sociétés humaines – ce que j’appelle des grands faits anthropologiques, des lignes de force et des lois générales –, éléments que nous ne voyons pas quand nous avons les yeux rivés sur des sociétés particulières, à des époques particulières.
Par exemple, les sociologues sont enfermés dans le présent des sociétés capitalistes modernes, et même dans l’étude spécialisée de secteurs particuliers de ces sociétés, ce qui ne permet guère de dégager et de comprendre clairement certains grands invariants sociaux et culturels.
La formulation de lois n’a rien d’une quête des essences.
Enfin, le troisième livre développe et illustre quelques grands faits anthropologiques, lignes de force et lois générales formulées dans la seconde partie, en s’appuyant sur de nombreux travaux de sciences sociales, passés ou récents.
Le tout est une invitation à changer de cadre, à mieux organiser le travail collectif pour permettre une cumulativité scientifique et unifier les sciences sociales, à ne pas craindre la mobilisation de savoirs issus de disciplines différentes, et à se donner des ambitions scientifiques collectives – j’insiste sur ce point, car cela ne peut pas être une ambition personnelle – plus grandes qu’elles ne le sont aujourd’hui.
Existe-t-il des différences entre ces termes que vous employez successivement pour décrire les sociétés humaines : structures, lois, lignes de force ou invariants ?
Au tout début de ma réflexion, j’avais tendance à tout ranger sous le terme de lois ou d’invariants, et je voyais bien que cela ne fonctionnait pas de façon satisfaisante. J’ai donc commencé à faire des différences entre des grands faits anthropologiques universels qui sont en partie des faits biologiques – développement extra-utérin particulièrement long, partition sexuée, grande longévité – et en partie des faits sociaux.
Il y a ensuite des lignes de force présentes dans toutes les sociétés humaines, mais souvent entremêlées dans les sociétés les moins différenciées et qui ne cessent de varier dans l’espace et dans le temps. Pour prendre une image architecturale, ce sont un peu comme des grands piliers qui soutiennent l’édifice que constitue chaque société humaine : lignes de force des modes de production, des rapports de parenté, et notamment des rapports parents-enfants, des rapports hommes-femmes, de la socialisation/transmission culturelle, de la production d’artefacts, de l’expressivité symbolique, des rites et institutions, des rapports de domination, du magico-religieux et de la différenciation sociale des fonctions. Et il y a enfin des lois générales de fonctionnement des sociétés qu’il serait trop fastidieux d’énoncer : j’en ai dégagé dix-sept.
Comment répondez-vous à ce qu’écrit le sociologue Jean-Claude Passeron, selon lequel toute tentative de formulation de lois sociologiques est vouée à sombrer soit dans une « vaine quête des essences ou des instances ultimes », soit dans la « banalité psychologique ou politique » ?
J’ai longtemps pensé comme lui, et avec lui, et je comprends bien les raisons de cette défiance. Mais la formulation de lois n’a rien d’une quête des essences. Tout d’abord parce qu’une grande partie de ces lois sont dynamiques. Elles décrivent des processus, des mouvements, des tendances, pas des essences.
Et puis c’est comme si l’on disait que les lois de l’évolution formulées par Darwin rendaient impossible la compréhension de l’incessante transformation des espèces ! C’est tout le contraire. Ces lois ne peuvent apparaître que dans la comparaison entre les différentes sociétés humaines et entre les sociétés humaines et non humaines. Elles n’ont rien de platitudes ou de vagues généralités.
C’est cette apparente “banalité psychologique et politique” qui est en fait l’énigme à prendre au sérieux et à résoudre.
Par exemple, Passeron, qui reprend ici Weber, dit que le concept de « domination » est amorphe et que la sociologie ne commence que lorsqu’on spécifie cette domination. Mais il y a quelque chose qu’il ne semble pas voir dans son raisonnement : pourquoi y a-t-il de la domination plutôt que des rapports sociaux parfaitement équilibrés dans toutes les sociétés humaines connues ?
C’est cette apparente « banalité psychologique et politique » qui est en fait l’énigme à prendre au sérieux et à résoudre. Les sciences font souvent des progrès décisifs quand elles se posent des questions jugées triviales ou enfantines que plus personne ne pense à formuler. Pour que quelque chose « varie », il faut bien que ce « quelque chose » existe plutôt que son contraire. Autrement dit, il n’y a pas de variations sans invariants et étudier l’un sans l’autre n’a aucun sens.
Quelles sont les principales « structures fondamentales » des sociétés humaines que votre dialogue avec les sciences naturelles et les comparaisons entre sociétés humaines mais aussi entre organisations humaines et animales vous ont permis de dégager ?
Il est difficile de répondre de façon complète et détaillée à cette question dans le cadre d’un entretien. C’est tout l’objet du livre. Disons néanmoins que, pour en indiquer quelques-unes parmi les plus significatives et connues, il y a les rapports de domination – et parmi eux les rapports parents-enfants, hommes-femmes, vieux-jeunes, etc. –, les rapports de parenté et les structures familiales, la division sociale du travail, les rapports entre les membres du groupe, « nous » et les « étrangers » au groupe, « eux », etc. Une partie de ces phénomènes sociaux est même observable autant chez des espèces non humaines que chez l’humain.
En quoi « l’altricialité secondaire », qui peut se définir, selon vos termes, en disant que, comparée à de nombreuses espèces, l’espèce humaine est caractérisée par une naissance « prématurée » et par une très longue période de développement physiologique, et notamment cérébral, extra-utérin, vous paraît-elle si essentielle pour comprendre les sociétés humaines ?
Le concept a été formulé par le zoologiste Adolf Portmann, qui comparait systématiquement le développement ontogénétique des différentes espèces. Ce développement très lent et cette dépendance particulièrement forte et longue chez l’humain sont souvent mentionnés dans les cours universitaires sur la socialisation pour souligner le caractère profondément social du petit humain, qui se socialise tout en poursuivant son développement à l’extérieur du ventre de la mère. Mais il est vite oublié et on n’en tire aucune conséquence quant au fonctionnement du monde social.
L’expérience précoce, systématique et durable que nous faisons en tant qu’humains, c’est l’expérience de la dépendance et de la domination.
Tout d’abord, il faut préciser que les humains ne sont pas les seuls à être altriciels. Il y a de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères dans lesquelles les petits ne sont pas très précoces. Mais le phénomène est accentué dans notre espèce. C’est lié à notre gros cerveau et à l’impossibilité de naître totalement développé pour que l’accouchement ne soit pas rendu impossible ; la taille du bassin des femmes étant restreinte par la bipédie. On remarquera d’ailleurs que c’est le même problème qui fait de l’accouchement un moment à haut risque chez les humains. Le danger ne s’est estompé que très tardivement dans l’histoire humaine, à partir du moment où l’on a commencé à médicaliser l’accouchement.
Mais étant donné ce fait anthropologique majeur qu’est l’altricialité secondaire, quelles en sont les conséquences sociales multiples, et même en cascade ? La conséquence centrale, tellement évidente qu’elle échappe la plupart du temps à la prise de conscience sociologique, c’est le fait que l’expérience précoce, systématique et durable que nous faisons en tant qu’humains, c’est l’expérience de la dépendance et de la domination.
Ne pas prendre acte de cette vie sociale dans l’ensemble du vivant, c’est faire de l’homme une exception parmi les espèces et le placer “hors nature”. C’est donc être pré-darwinien et clairement hors science.
Le rapport parent-enfant est, quel que soit le degré de bienveillance des parents, un rapport de domination. Et cela constitue une matrice pour comprendre pourquoi la domination, sous des formes extrêmement variées, est omniprésente dans les sociétés humaines.
On comprend que cette domination parents-enfants est à la base des rapports de domination des vieux sur les jeunes, des expérimentés sur les inexpérimentés, des aînés sur les cadets, etc., et même des rapports symboliques de domination qui sont construits entre l’esprit des ancêtres ou des divinités, qui sont conçus comme des protecteurs, et les vivants, ou encore entre ceux (groupes, lignages…) qui peuvent revendiquer une antériorité et ceux qui sont arrivés après.
Ce n’est pas un hasard si les chefs dans les sociétés à chefferie ou à État se présentent souvent comme des protecteurs du groupe, des garants de la paix, de la prospérité, etc. Le modèle implicite est parental : la mère patrie, le petit père des peuples, etc.
Qu’est-ce qui vous permet d’affirmer que les sociétés non humaines sont tout aussi « sociales » que les sociétés humaines et qu’on ne pourrait pas opposer des organisations animales fondées sur leur instinct et des organisations humaines fondées sur leur culture ?
Sur la question de la vie sociale chez les espèces animales non humaines, je n’affirme rien. Ce sont les éthologues qui le prouvent depuis plus de 70 ans maintenant ! On peut penser aux pionniers que furent Tinbergen, Karl von Frisch et Konrad Lorenz.
Depuis les années 1950, des milliers d’études sont venues enrichir la connaissance des comportements sociaux chez les animaux : les pratiques d’exogamie, les rapports de dominance et les faits de hiérarchie, les rapports entre mâles et femelles, entre parents et enfants, apparentés et non apparentés, les rapports de tension entre différents groupes de la même espèce, la division du travail, les phénomènes d’alliance ou de réconciliation, et ainsi de suite. Dès lors que des animaux vivent en groupe, on voit des rapports réguliers s’instaurer entre différentes catégories de membres ou entre différents groupes.

Le social est un niveau de réalité qui ne se réduit clairement pas à du « biologique », y compris dans les autres espèces que l’espèce humaine. Ne pas prendre acte de cette vie sociale dans l’ensemble du vivant, c’est faire de l’homme une exception parmi les espèces et le placer « hors nature ». C’est donc être pré-darwinien et clairement hors science.
Quant à l’instinct, on le surestime très nettement chez les animaux non humains. Là encore, de nombreux travaux éthologiques montrent que les processus de socialisation, d’apprentissage, ne sont pas spécifiques à l’homme mais qu’ils s’observent chez les oiseaux, les mammifères, les insectes, etc.
Et pour terminer sur la différence entre le « social » et le « culturel », il faut prendre conscience du fait qu’une vie sociale est possible sans processus de transmission culturelle aussi riches, et surtout aussi cumulatifs, que ceux qui caractérisent les sociétés humaines. Il y a des phénomènes de transmission culturelle documentés chez de nombreux mammifères et chez de nombreuses espèces d’oiseaux, mais ce qui nous distingue, c’est le fait que nous avons pu créer – très lentement au départ, puis de façon de plus en plus accélérée – des phénomènes de cumulativité culturelle.
Chaque génération part d’un état historique donné des savoirs, des savoir-faire et des artefacts et produit sur cette base – par combinaison, synthèse – de nouveaux savoirs, de nouveaux artefacts pour faire face à de nouveaux défis adaptatifs, et ainsi de suite. Il est donc important de distinguer le biologique du social et du culturel car de nombreuses espèces animales sont sociales sans être aussi culturelles que nous.
Votre idée sous-jacente est-elle de repenser la science des sociétés humaines à l’aune de la prise de conscience écologique et du vivant non humain ?
Je crois que ça a joué un grand rôle, même si cela a été plus inconscient que conscient pendant toute une partie de ma recherche. Les scientifiques ne peuvent faire autrement que d’être traversés par les grands enjeux de leur temps. Après, toute sensibilité aux questions de biodiversité et de dérèglement climatique ne conduit pas aux résultats contenus dans ce livre !
Disons que c’est au croisement de ces inquiétudes écologiques sur une possible accélération de la disparition de notre espèce et d’une insatisfaction à propos de sciences sociales qui se sont détournées de grandes questions jugées souvent trop philosophiques, trop métaphysiques, et qui trouvent pourtant des réponses dans les travaux des biologistes, des éthologues, des paléoanthropologues, des préhistoriens et de tous les chercheurs en sciences sociales, que le projet de ce livre a pris forme.
Comment repérer des constantes sociales dans l’organisation des sociétés humaines sans que cela ne produise une forme de déterminisme accablant, que ce soit dans la reproduction du pouvoir ou de la domination masculine ? Peut-on conserver une perspective émancipatrice avec de telles lois fondamentales ?
Ce qui est accablant, c’est de constater que la domination masculine est plurimillénaire, que les conflits intergroupes ou interethniques n’ont cessé de rythmer la vie des sociétés humaines, que des rapports de domination ont structuré toutes les sociétés humaines connues, etc., sans pouvoir comprendre les raisons profondes de ces faits. De ce point de vue, la réponse constructiviste apportée par les sciences sociales contemporaines à ces questions reste partielle et peu satisfaisante. Car si tout était une affaire de culture, pourquoi la réalité ne serait pas plus diverse qu’elle ne l’est ?
Sans connaissance de la réalité et des principes qui la gouvernent, il n’y a pas d’émancipation possible. Car seule la connaissance permet d’envisager les moyens culturels de contrecarrer ces forces. Ce n’est pas en niant les lois de la physique que nous sommes parvenus à voler, à aller dans l’espace, à communiquer à distance, à inventer l’électricité, etc.
À vous lire, les sociétés humaines, contraintes par la biologie, sont sur des « rails » qui « sont toujours là et qui continuent à limiter l’action de la culture », même si celle-ci « parvient parfois à déplacer quelques limites biologiques ». Quels exemples de déplacement donneriez-vous ?
Je pense que l’exemple le plus flagrant est celui du desserrement progressif, grâce à des moyens culturels (médicaux, techniques), du lien entre les femmes et les enfants. L’invention de la contraception et des techniques d’avortement ont contribué à faire que les femmes ne sont plus condamnées à un rôle de mère. Elles peuvent décider de ne pas avoir d’enfant et ont les moyens de leur choix. De même, l’invention du biberon et du lait maternisé ont permis de défaire un peu le lien mère-enfant. Une femme peut décider de ne pas allaiter, elle peut tirer son lait ou utiliser du lait maternisé et faire nourrir son enfant par d’autres (le père, une nourrice, etc.).
C’est-à-dire que, progressivement, on a introduit un peu d’élasticité dans un lien qui était très serré. Aucun mammifère n’est parvenu à faire ça, seule l’espèce humaine en a les moyens. Sur un tout autre exemple, on voit bien que l’invention des vaccins et plus généralement des traitements médicaux a changé la donne en contexte d’épidémie. Grâce à ces artefacts, on ne meurt plus aussi facilement qu’avant !
Vous citez à plusieurs reprises le biologiste Edward O. Wilson, qui avait déclenché une vague de critiques après avoir suggéré que les comportements des humains résultaient en partie de principes inscrits dans leurs gènes. En quoi votre analyse se distingue-t-elle de cette sociobiologie ?
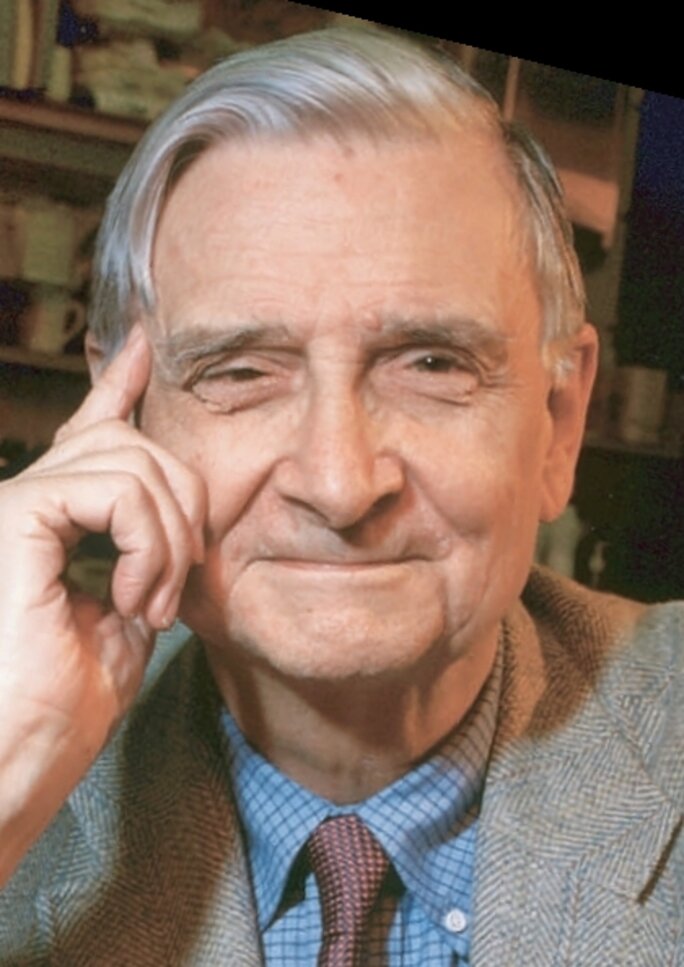
Je ne mobilise absolument pas la génétique, mais l’éthologie, qui est une sociologie de la vie sociale d’espèces non humaines, et la biologie qui s’intéresse à ce qu’elle appelle les « histoires de vie » propres à chaque espèce : type d’ontogenèse, plus ou moins grande rapidité de développement et d’accès à l’autonomie, âge d’accès à la maturité sexuelle, longévité, existence ou non de périodes de rut, existence ou non d’une ménopause chez les femelles, etc. Cela dit, Wilson est un myrmécologue – spécialiste des fourmis – incroyable, qui ne se réduit pas à sa tentative de réductionnisme biologique.
Vous êtes très critique sur le constructivisme des sciences sociales et sur les formes de « déni du biologique » que vous constatez même chez Pierre Bourdieu, avec lequel vous entretenez un rapport étroit mais critique. Cependant, on voit aussi à quel point aujourd’hui, les conservateurs et les réactionnaires du champ politique attaquent celles et ceux qui disent qu’il n’y a pas de fatalité ou de loi naturelle, que ce soit dans les études de genre ou les analyses sur la race. Comment n’être pas embarqué dans cette croisade ?
Ah ! Une chose est sûre : ces croisades politiques ne m’intéressent absolument pas et je me tiens à distance de ces débats. Je ne me laisserai instrumentaliser par personne, et encore bien moins par les conservateurs ou les réactionnaires.
Quand je dis que mes collègues des sciences sociales nient la réalité biologique ou prêtent des intentions politiques aux biologistes que beaucoup n’ont pas, je ne soutiens pas que les faits sociaux s’expliquent par du biologique ou qu’ils sont intransformables.
Je pourrais citer de grands chercheurs tels que Norbert Elias, Everett Hughes, Erving Goffman, Françoise Héritier, André Leroi-Gourhan, etc., qui tous, quoique de manière différente, ont exprimé l’importance de ne pas oublier le fait que nous faisons partie du règne animal, que nous sommes caractérisés par notre bipédie, nos pouces opposables, notre gros cerveau et notre système nerveux, notre partition sexuée, etc., pour faire de la science sociale qui ne soit pas totalement « hors sol ».
Vous repérez d’autres invariants des sociétés humaines, notamment le plus connu d’entre eux, à savoir l’interdiction de l’inceste. Or l’analyse de Lévi-Strauss à ce sujet paraît contestée par la réalité de la pratique massive de l’inceste, identifiée par exemple dans l’ouvrage récent « La Culture de l’inceste ». Autrement dit, les lois des sociétés humaines que vous repérez ne risquent-elles pas à leur tour de négliger les réalités concrètes mises en lumière par les sciences sociales et de demeurer trop abstraites ?
Je comprends ce que vous voulez dire, mais la notion de loi se combine très bien avec celle d’exception ou de contre-exemple. Sur la question de l’inceste, les biologistes vous diraient que dans le règne animal, il y a une tendance très forte à l’évitement de l’inceste, et que c’est sans doute dans l’espèce humaine qu’il y a le plus d’exceptions pour des raisons complexes. Mais cela reste des exceptions – même massives – qu’il faut étudier en tant que telles.
À LIRE AUSSILa clé sociologique des songes
10 janvier 2021Bernard Lahire: «Les enseignants n’arriveront jamais tout seuls à réduire les inégalités»
5 septembre 2019
Si l’on ne distinguait pas les régularités statistiques des exceptions, on pourrait dire que la loi de la reproduction sociale est fausse parce qu’il existe de nombreux cas de transfuges de classe. Dans la réalité sociale concrète, les lois se combinent entre elles, certaines venant contrarier l’action des autres.
Par exemple, la loi de la chute des corps prédit que deux objets lâchés au même moment de la même hauteur tombent sur le sol au même moment indépendamment de leur poids. Pourtant, dans la réalité ordinaire, les objets plus lourds tombent plus vite. Pour que les objets tombent en même temps, il faut que cela se passe dans le vide. Ce que vous observez dans la vie de tous les jours, c’est l’effet combiné de la chute des corps et des forces de frottement dans l’air. Eh bien, c’est exactement la même chose dans le monde social, à la différence près que beaucoup de savants se précipitent sur l’« évidence » qui semble contredire la loi pour remettre en cause l’existence d’une loi.