APRÈS LA MORT DE NAHEL, LA RÉVOLTE DES QUARTIERS POPULAIRES
Face à la stratégie incendiaire du pouvoir, l’urgence de réponses politiques
En traitant la révolte des quartiers populaires sous un angle sécuritaire, le pouvoir prend un risque majeur. Même si les violences nocturnes sont en train de s’éteindre, la marmite va continuer à bouillir tant que les conditions de vie et les perspectives ne seront pas meilleures.
Les nuits sont de plus en plus calmes. Dans les quartiers populaires, le mouvement de protestation qui a suivi la mort du jeune Nahel à Nanterre (Hauts-de-Seine) déserte progressivement les rues. Un « retour au calme et à l’ordre » jugé précaire mais salué par Emmanuel Macron, dont le gouvernement a déployé un arsenal massif pour dissuader les révoltés : des personnels sur le terrain (45 000 agents de police et de gendarmerie chaque soir), des circulaires incitant les juges à la plus grande fermeté et des déclarations martiales.
« Prochaine personne qui touche un policier ou un gendarme, qu’il sache qu’il sera retrouvé », a par exemple menacé Gérald Darmanin, le ministre de l’intérieur, samedi. Son collègue, Éric Dupond-Moretti, dans le même registre de langage : « Si vous balancez des comptes sur Snapchat, le compte, on va le péter, vous serez retrouvés. » Depuis mercredi, le gouvernement a annulé tous ses déplacements… sauf ceux consacrés à la dénonciation des violences urbaines.
Le président de la République lui-même a envoyé un message fort, lundi soir. Pour sa première sortie depuis le drame de Nanterre, il n’a pas rendu visite à la famille de Nahel, il ne s’est pas déplacé dans un quartier populaire, il n’est pas allé à la rencontre d’élus locaux ou d’acteurs de terrain. Il a passé quatre heures avec des agents de police à Paris, pour les assurer de son soutien et formuler des propositions, comme celle de « sanctionner financièrement les familles à la première infraction ».

L’exécutif a fait un choix, celui de traiter les événements actuels au prisme de leur versant sécuritaire. À force de discours et d’interventions médiatiques, le pouvoir a réussi à modifier l’atmosphère. On ne parle plus de colère, de violences policières, de la mort d’un adolescent, de l’état des quartiers populaires. On parle de bandes, de pillages, de saccages, de violences.
Et les grands discours se sont transformés en grands actes. Partout en France, les comparutions immédiates envoient des dizaines de jeunes hommes en prison, comme l’a raconté Mediapart ainsi que son partenaire, le Bondy Blog. Sur BFM TV, mardi, une avocate a raconté que son client avait écopé de dix mois de prison ferme pour avoir volé une canette de Red Bull. Le torse bombé, le pouvoir peut se targuer d’avoir remporté son bras de fer contre la rue. « Nous avons eu raison d’utiliser la force républicaine », a vanté Gérald Darmanin lundi.
Une forfanterie qui masque une victoire en trompe-l’œil. Certes, à la faveur d’une répression policière et judiciaire de grande ampleur, les brûleurs dorment désormais à la maison ou en prison. Mais rien n’est réglé. « Encore une victoire comme celle-là et nous serions complètement défaits », avait dit Pyrrhus, roi d’Épire, après avoir remporté une bataille contre les Romains. Une filiation historique dont feraient bien de se nourrir les soutiens du chef de l’État.
Au milieu des comparaisons avec les émeutes de 2005, on oublie parfois que les quartiers populaires brûlent au rythme des violences policières. La liste est aussi longue que celle des personnes mortes ou blessées entre les mains des forces de l’ordre : en 2007 à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), en 2010 à Grenoble (Isère), en 2016 à Beaumont-sur-Oise (Oise), en 2018 à Nantes (Loire-Atlantique), en 2020 à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), les mêmes scènes, la même rage, les mêmes messages.
Les événements actuels s’inscrivent dans cette longue histoire. Ils en incarnent, déjà, un épisode singulier, au vu de l’émoi suscité par la mort de Nahel, de l’ampleur de la révolte et du nombre de communes touchées par les violences. Dans les rues s’expriment le ras-le-bol de la brutalité policière, la dénonciation d’un racisme institutionnel et la lassitude des discriminations, comme le racontent nos reportages depuis une semaine. Élus locaux et militants associatifs déplorent en chœur les inégalités rampantes, les services publics aux abois et le sous-investissement de l’État.
L’exécutif a organisé sa propre surdité
Autant de cris d’alarme dont l’écho n’est visiblement pas arrivé jusqu’au palais de l’Élysée. « Pendant les émeutes de 2005, il y avait un message, a dit Emmanuel Macron aux policiers qu’il a rencontrés lundi. Là, je n’ai pas entendu de message. » À rebours de toutes les évidences, le propos raconte les années-lumière qui séparent le pouvoir des territoires les plus relégués.
Il explique aussi son incapacité à apporter une réponse politique aux revendications des banlieues. Comme un symbole, la première ministre a annulé un déplacement prévu à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) vendredi, elle a reporté les annonces qui devaient suivre le conseil interministériel des villes, et son ministre de la ville a annulé une visioconférence avec les représentants locaux de l’État lundi. À force de couper toutes les sondes, l’exécutif a organisé sa propre surdité.
La période invitait pourtant à un double exercice, de temps court et de temps long. À la réponse sécuritaire (déjà contestable dans sa brutalité et sa courte vue), le gouvernement aurait été inspiré de superposer une réponse sociale et politique à la crise. Le décès de Nahel aurait dû permettre d’ouvrir un vrai débat sur l’usage des armes dans la police, sur le racisme de l’institution, sur la ségrégation sociale à l’œuvre dans les quartiers. « On n’est pas dans ce temps-là », répond une source gouvernementale, qui évoque « l’impérieuse nécessité du retour au calme ».
Mardi, en recevant plus de 200 maires à l’Élysée, Emmanuel Macron a repoussé à la fin de l’été la présentation de pistes « pour déboucher sur des solutions très concrètes », car « on ne doit pas laisser la pâte retomber ». Dans l’immédiat, ce sont encore les violences urbaines qui ont occupé le président de la République. Il a promis aux élus une loi d’urgence pour reconstruire dans les plus brefs délais les équipements publics endommagés.À LIRE AUSSIMort de Nahel : « Les réponses des politiques vont être déterminantes »
30 juin 2023Nahel et les quartiers : mourir pour exister
3 juillet 2023
À la presse, l’Élysée fait savoir que le président de la République souhaite « débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons » de la révolte. En privé, pourtant, les cabinets ministériels s’empressent de dire que la période n’est pas aux « aides financières massives ». À Beauvau, Gérald Darmanin et son entourage freinent des quatre fers pour ne pas ouvrir un débat périlleux sur le maintien de l’ordre et les dysfonctionnements de la police. Et la notion de discrimination a disparu du champ lexical politique.
En 2005, Jacques Chirac, qui regardait pourtant de loin la situation des « banlieues » et dont les propos sur « le bruit » et « l’odeur » l’ont en grande partie disqualifié pour s’y pencher, avait eu des mots forts sur ce sujet. S’interrogeant, lors d’une allocution télévisée, sur les « racines » des émeutes, le président de la République d’alors avait déclaré : « L’adhésion à la loi et aux valeurs de la République passe nécessairement par la justice, la fraternité, la générosité. Nous ne construirons rien de durable sans combattre ce poison pour la société que sont les discriminations. »
Cette fois-ci, le gouvernement n’est pas seulement impuissant à entendre les revendications. Il est en train de prendre l’option, en toute connaissance de cause, d’esquiver la réflexion de fond au profit d’une sortie de crise sécuritaire… et moins coûteuse. Rentable à court terme, la stratégie du pouvoir est suicidaire si l’on veut bien lever le nez des enquêtes d’opinion et de l’actualité.
En traitant les conséquences sans aborder les causes, le gouvernement remet aujourd’hui le couvercle sur une marmite encore bouillante. Mais pour combien de temps ? Au prochain drame, c’est le même cycle qui s’ouvrira. L’émotion, la marche blanche, la colère, la violence, la répression. Et jusqu’à quand ? Combien de temps la République tolérera-t-elle encore de voir certains de ses enfants mourir dans de telles conditions après avoir vécu dans de telles conditions ?
Pourquoi les services publics sont pris pour cible
Médiathèques, écoles ou centres sociaux ont été pris pour cibles dans la nuit du 28 au 29 juin dans différentes villes de France. À l’éternelle question de savoir pourquoi, les sciences sociales apportent des réponses de plus en plus précises depuis les émeutes de 2005.
29 juin 2023 à 21h15
Àchaque affrontement entre forces de l’ordre et jeunes des quartiers populaires, après chaque nuit de soulèvement urbain, une question revient parmi les observateurs mais aussi les habitant·es : pourquoi s’en prendre aux équipements publics qui offrent encore quelques services sur des territoires le plus souvent déshérités en la matière ?
Derrière cette interrogation se loge aussi une question plus souterraine : qu’y a-t-il dans la tête des jeunes qui affrontent la police, mettent le feu ou défoncent des vitrines ? Les sciences sociales ont largement travaillé la question, particulièrement depuis les émeutes de 2005, et montrent qu’il est impossible de voir dans ces gestes le simple nihilisme, voire le banditisme auxquels certaines voix voudraient les réduire.
Une réponse préliminaire à la question oblige à commencer par passer au tamis ce que signifient « services » ou « équipements » publics dans un contexte de révoltes et de tensions urbaines. S’en prendre à un commissariat au lendemain du meurtre d’un adolescent par un policier, ou même à une mairie qui a autorité sur une partie des forces de l’ordre, n’a pas nécessairement la même signification que s’en prendre à une école, un CCAS (centre communal d’action sociale), une salle des fêtes ou une bibliothèque…

Un second préliminaire contraint aussi de rester prudent, au-delà même de la nature des institutions visées, sur ce qu’elles peuvent représenter, et dont la signification peut rester opaque ou confuse. Un des jeunes ayant participé aux ateliers d’écritureorganisés par l’écrivain et éducateur Joseph Ponthus dans une cité de Nanterre affirmait ainsi, à propos des émeutes de 2005 : « On a commencé par discuter de ce qu’il fallait pas brûler. Pas les voitures des gens, pas l’école, pas le centre commercial. On voulait s’attaquer à l’État. » De manière symptomatique, alors même que la volonté de s’en prendre à l’État est affirmée, l’école, pourtant l’institution publique qui maille l’ensemble du territoire, est mise de côté…
Cela dit, et bien qu’il soit encore trop tôt pour mesurer l’ampleur du soulèvement actuel et répertorier ou cartographier précisément ce à quoi il s’attaque, il semble bien que les équipements publics soient particulièrement visés.
Les chercheurs en sciences sociales – sociologues, politistes, anthropologues – sont d’accord pour y voir un geste éminemment politique.
Denis Merklen, sociologue
Le seul ministère de l’éducation nationale a ainsi dénombré jeudi « une cinquantaine de structures scolaires impactées à des degrés divers » par les incidents survenus après la mort de Nahel, aboutissant à la fermeture d’une « dizaine » d’entre elles, principalement dans les académies de Versailles, de Créteil et de Lille.
Pour le sociologue Sebastian Roché, il y aurait même une distinction à faire à ce sujet entre aujourd’hui et l’automne 2005. Interrogé sur France Info jeudi 29 juin, il jugeait en effet que la révolte actuelle « était beaucoup plus tournée vers les institutions publiques », tandis que les émeutes de 2005 auraient en priorité visé « beaucoup plus les voitures », même si des attaques contre des institutions publiques – gymnases, crèches, bibliothèques – s’étaient alors produites.

Le livre sans doute le plus précis sur le sujet a été publié aux éditions Presses de l’Enssib en 2013 par le sociologue Denis Merklen et s’intitule Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?(lire l’entretien que Mediapart avait conduit avec lui sur le sujet à l’occasion du dixième anniversaire des émeutes de 2005). Le chercheur y montrait qu’environ 70 bibliothèques avaient été incendiées en France entre 1996 et 2013, et que 2005 ne constituait pas une scène inédite ou inaugurale.
Toutefois, soulignait Denis Merklen à propos de ces attaques commises envers les institutions publiques, « leur interprétation a changé après les émeutes qui ont eu lieu en France cette année-là, sûrement comme conséquence de l’ampleur de la mobilisation. Auparavant, elles étaient perçues comme des actes irrationnels, nihilistes, on parlait alors de “violences urbaines” et pas encore d’émeutes. Pourquoi s’attaquer à une école maternelle ou à un gymnase ? Pourquoi les bénéficiaires détruisaient-ils ce qui leur était destiné ? Ce n’était pas compréhensible. La plupart des lectures en faisaient la manifestation d’un déficit, voire d’une absence de socialisation politique. »
Cette interprétation « nihiliste » demeure active dans certains secteurs de la société et du champ politique. Elle est propre à une manière de regarder les marges de la ville-centre comme une zone peuplée de populations « ensauvagées », incapables de respecter le bien commun ou même de distinguer leur propre intérêt.
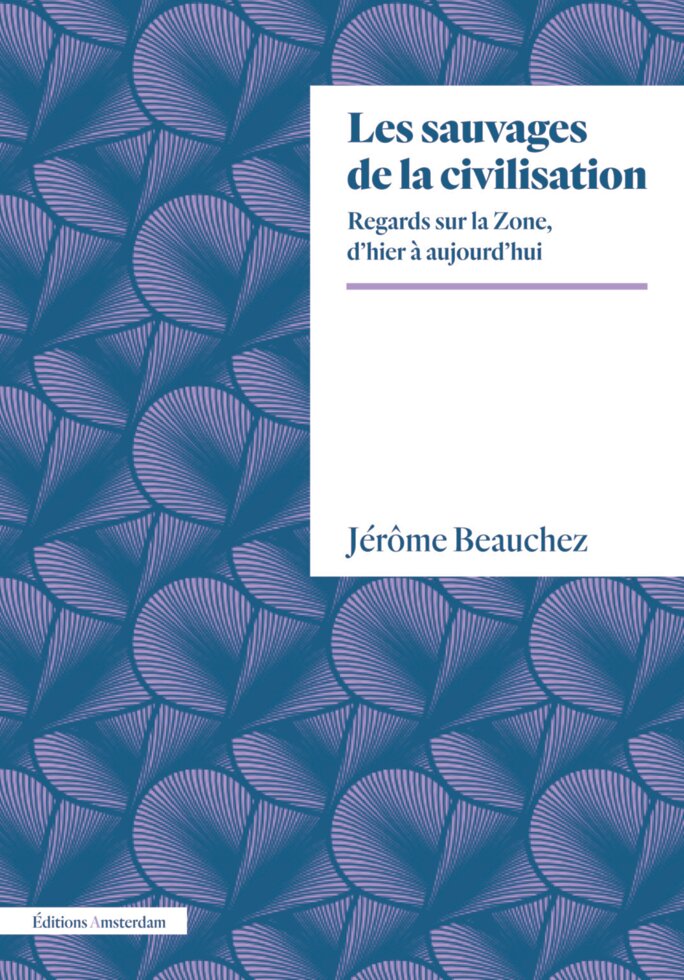
Le sociologue et anthropologue Jérôme Beauchez, professeur à l’université de Strasbourg, a tout récemment retracé l’histoire longue de ce regard négatif dans un livre intitulé Les Sauvages de la civilisation. Regards sur la Zone, d’hier à aujourd’hui, publié par les éditions Amsterdam l’an dernier.
Toutefois, même lorsque n’est pas entonné le refrain de la nécessaire remise en ordre d’un monde prétendument décivilisé à coups de renforts policiers, de couvre-feux ou d’états d’urgence, la dimension politique des attaques contre les institutions politiques demeure encore parfois déniée. Lorsque les institutions publiques visées sont des écoles ou des centres d’action sociale, mais aussi quand ceux qui les visent n’appartiennent pas à des organisations référencées et sont en outre le plus souvent cagoulés et racisés.
À l’inverse, lorsque le mouvement poujadiste s’en était pris à des centres des impôts, lorsque des militants de la FNSEA ont attaqué manu militari des préfectures ou lorsque des marins-pêcheurs ont incendié le Parlement régional de Bretagne en février 1994, la dimension politique du geste a été immédiatement lue comme telle. Ce n’est donc pas la violence en elle-même qui distinguerait le bon grain politique de l’ivraie et de l’ivresse émeutières.
Pour Denis Merklen, le ciblage des institutions publiques lors d’épisodes de soulèvements urbains est bien de nature politique, et même en quelque sorte au carré. « Aujourd’hui, affirme-t-il, les chercheurs en sciences sociales – sociologues, politistes, anthropologues – sont d’accord pour y voir au contraire un geste éminemment politique. Pourquoi cela ? Parce que les personnes vivant dans les quartiers populaires, plus que les autres, sont en contact permanent avec des institutions publiques pour résoudre les problèmes de leur vie quotidienne. S’en prendre à elles est une manière de signifier ce face-à-face. Ce n’est pas un déficit de politisation, mais un changement dans la politicité populaire – c’est-à-dire de la manière de faire de la politique par les catégories populaires – par la territorialisation des conflits sociaux. »
Pour le sociologue, lesémeutiers manifestent ainsi « le conflit dans lequel ils sont pris quotidiennement. Aux guichets des administrations, lieu principal des interactions, les exclusions et les difficultés d’accès prennent la forme d’un mépris fortement ressenti ».
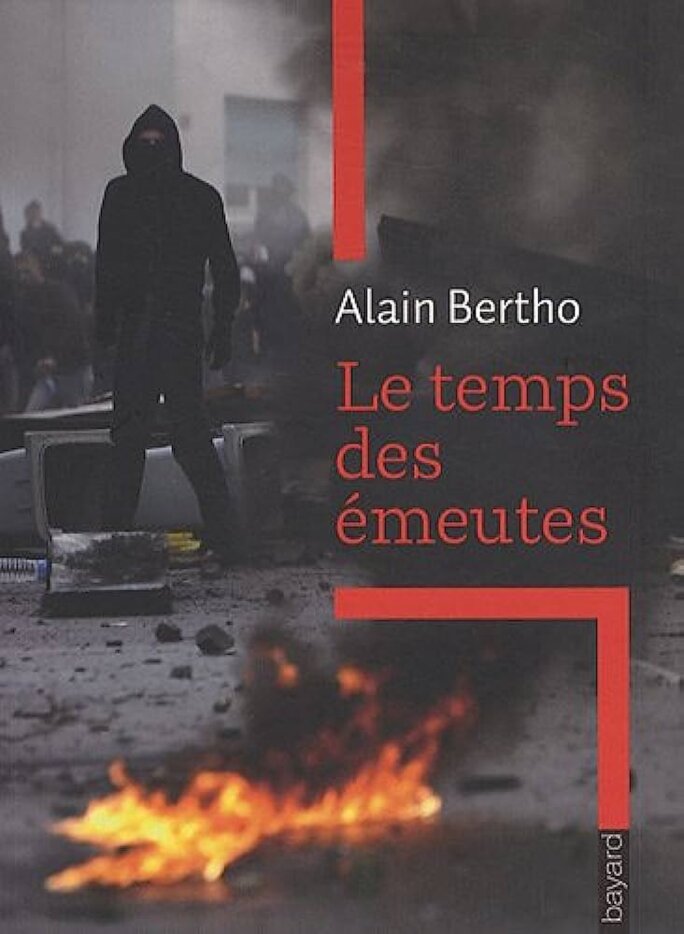
L’anthropologue Alain Bertho, professeur émérite à l’université Paris VIII, a consacré une grande partie de son travail aux émeutes urbaines, en France et à l’étranger, pour comprendre la mondialisation de ce vocabulaire de la protestation et en repérer les formes nationales ou locales. Il en a tiré deux ouvrages, Le Temps des émeutes, publié chez Bayard en 2009, puis Les Enfants du chaos, paru à La Découverte en 2016.
Dans ces deux ouvrages, le chercheur insiste, lui aussi, pour prendre en compte la dimension politique des émeutes, précisément quand celle-ci est parfois occultée par le fait que ces soulèvements n’empruntent pas les voies de la politique institutionnelle, ni celles de la geste révolutionnaire qui vise les lieux incarnant le pouvoir en majesté, et non un gymnase ou l’antenne d’un centre de sécurité sociale.
Il y a eu un débat en 2005, nous expliquait Alain Bertho au moment du soulèvement des « gilets jaunes », « sur la question de savoir si ces émeutes étaient un mouvement politique, proto-politique ou apolitique. La réponse que m’ont donnée ceux qui avaient alors brûlé des voitures est restée gravée dans ma tête : “Non, ce n’est pas politique, mais on voulait dire quelque chose à l’État.” Comment dire de façon plus claire que la politique partisane et parlementaire, à leurs yeux, ne servait à rien pour dire quelque chose à l’État ? ».
Dans ce même entretien, Alain Bertho insistait également sur la nécessité d’être « attentif au répertoire d’action qu’est le langage de l’émeute », faisant une distinction notamment entre les émeutes avec et sans pillage.
Dans ce répertoire d’action en réalité pluriel de l’émeute, parfois masqué par les images répétitives des fumées et des affrontements, les attaques visant des équipements publics tiennent une place spécifique et paradoxale.
Une spécificité des soulèvements urbains en France est de viser les institutions publiques, en partie parce qu’il existe – ou existait – encore un espoir en leur effectivité et efficacité.
Cependant, le paradoxe n’est sans doute pas seulement celui qui se formule d’ores et déjà à large échelle, dans des micro-trottoirs se demandant pourquoi certains jeunes attaquent des institutions censées les et leur servir, ou même dans la bouche de chercheurs, à l’instar de Sebastian Roché jugeant, toujours sur France Info, qu’on assiste en ce moment à un « désespoir que les populations retournent contre elles-mêmes ».
Il réside aussi dans ce que souligne Denis Merklen, à savoir que, pour les personnes vivant dans les quartiers populaires, « les services publics sont leur seul recours pour leurs besoins les plus élémentaires, liés à l’éducation, à la santé, au transport, au logement, à l’énergie et à la culture. Quasiment tous les aspects de leur vie quotidienne sont entre les mains d’institutions publiques. C’est une situation paradoxale, car cela tient aussi à la solidité et à la pénétration de notre État social qui assure tant bien que mal des filets solides de protection ».
Ces filets de protection sont certes moins nombreux et solides aujourd’hui qu’il y a dix ans, en raison du délitement des services publics, mais il n’en reste pas moins qu’une spécificité des soulèvements urbains en France, par rapport à d’autres pays, est de viser les institutions publiques, en partie parce qu’il existe – ou existait – encore un espoir en leur effectivité et efficacité.
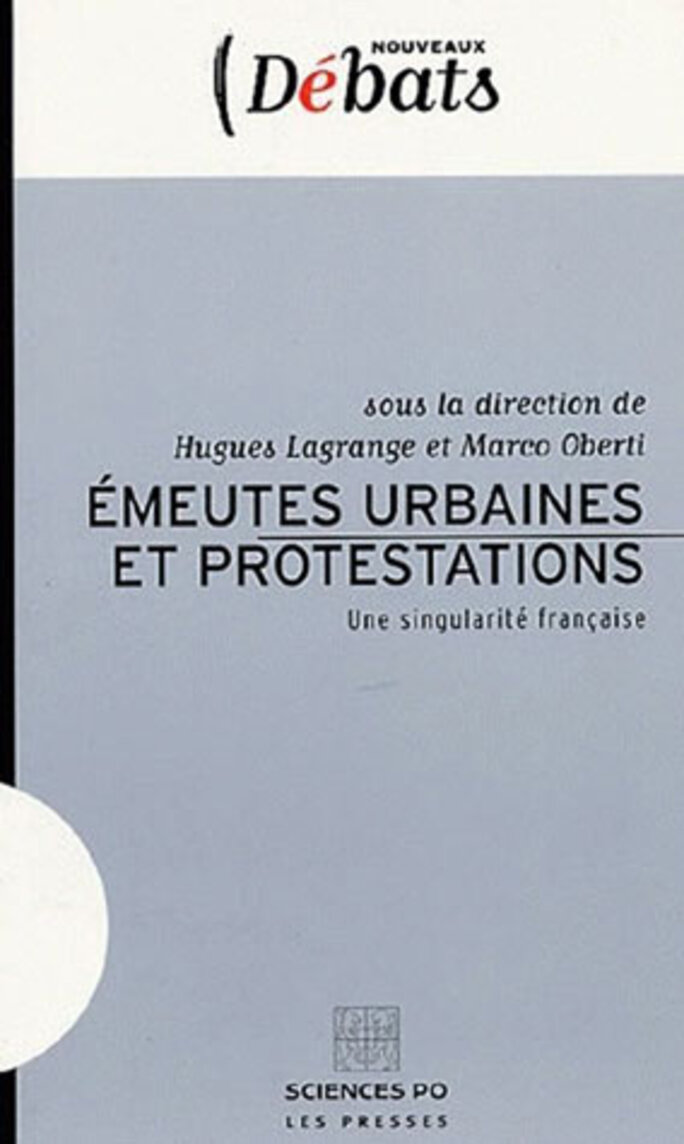
C’est en tout cas ce qui ressortait de l’ouvrage codirigé par les sociologues Hugues Lagrange et Marco Oberti l’année suivant les émeutes de 2005, intitulé Émeutes urbaines et protestations et publié aux Presses de Sciences Po. Le livre collectif proposait notamment une comparaison entre les situations italienne et britannique en rappelant que la société française se « caractérise par un État centralisé, de puissants services publics, une référence forte à la laïcité, une immigration ancienne liée à une histoire coloniale et à une décolonisation douloureuses ».
Pour les directeurs de cet ouvrage, la comparaison internationale des protestations urbaines conduisait à un « étrange paradoxe. La plus grande efficacité de la société française à lutter contre les inégalités sociales et à assurer une meilleure protection sociale produit simultanément un fort sentiment d’exclusion, surtout dans les quartiers populaires et immigrés les plus ségrégués ».
D’autant qu’à lire Hugues Lagrange et Marco Oberti, les Français, contrairement aux Britanniques, étaient « équipés de lunettes construites pour ne pas voir cette ségrégation ethnique ». Une situation largement liée à une pensée de la République et une organisation territoriale de ses services publics qui, à force de vouloir être « colour blind », s’avèrent aveugles aux discriminations ethnoraciales que leurs propres institutions publiques peuvent pourtant reproduire.
C’est évidemment le cas avec cette institution particulière qu’est la police, comme l’avait déjà montré le sociologue Didier Fassin dans son ouvrage La Force de l’ordre,qui explorait le racisme présent à l’intérieur de certaines unités de la BAC en particulier et l’éloignement croissant entre les forces de l’ordre et les habitant·es des quartiers populaires de façon plus générale.
À LIRE AUSSI
Pourquoi les émeutiers s’attaquent aux équipements publics
2 novembre 2015
Que fait (mal) la police dans les banlieues?
26 octobre 2011
Mais c’est aussi vrai d’institutions qui ont, au contraire, tenté de réduire la distance entre les institutions et les populations auxquelles elles s’adressent. Concernant le cas particulier des bibliothèques, Denis Merklen notait ainsi qu’elles « ont fait un immense travail de réflexion autocritique. Elles ont renouvelé leurs approches ; elles se sont ouvertes ».
Mais, poursuivait-il, elles ne peuvent, pas plus qu’aucun service public pris isolément, « résoudre les problèmes économiques et sociaux qui se posent dans ces quartiers », en raison « de la situation catastrophique du marché du travail » qui fait que « beaucoup d’habitants ne peuvent plus compter sur leur salaire » et n’ont plus que les services publics – et non plus les employeurs – comme interlocuteurs de leur situation sociale. Ce qui peut amener à détruire une salle des fêtes plutôt que séquestrer un patron…