Luc Semal : « Les résultats décevants de l’écologie politique en 2022 confirment que la question des limites à la croissance reste un impensé politique »
TRIBUNE
Luc Semal – Politiste, Maître de conférences au Muséum national d’histoire naturelle et membre de l’Institut Momentum
Le politiste analyse dans une tribune au « Monde » la « situation inextricable » à laquelle ont mené cinquante ans de déni politique depuis la publication du rapport Meadows, en 1972.
Publié le 12 avril 2022 à 05h45 – Mis à jour le 12 avril 2022 à 05h45 Temps de Lecture 5 min.
Tribune. Cinquante ans après la publication du rapport Meadows sur les limites à la croissance, les résultats du premier tour de l’élection présidentielle peuvent donner une pénible impression de surplace. Impression fausse, car en réalité la situation a bien empiré depuis.
Avril 1972 : dans le cadre d’un référendum décidé par Georges Pompidou, les Français s’apprêtent à voter pour ou contre l’élargissement des Communautés européennes à quatre nouveaux pays, dont le Royaume-Uni. Le président en exercice de la Commission européenne, le socialiste néerlandais Sicco Mansholt, vient d’écrire que les conclusions générales du tout récent rapport Meadows – pas encore traduit en français – sont « si évidentes » qu’elles devraient désormais guider les décisions des instances européennes. Il s’attire ainsi les foudres de Georges Marchais qui, au nom du PCF, dénonce le « programme monstrueux » de Mansholt, lequel conduirait à un net recul du bien-être des Français. Puis, d’autres personnalités de premier plan, dont Valéry Giscard d’Estaing et Raymond Barre, critiquent à leur tour Mansholt en assurant, entre autres, que le nucléaire permettra bientôt de repousser toutes les limites énergétiques. D’autres au contraire, dont l’agronome René Dumont et le philosophe André Gorz, saluent l’initiative de Mansholt, tout en ajoutant que la thèse des limites à la croissance mériterait d’être mieux articulée avec la question des inégalités – car ce sont d’abord et surtout les plus riches qui doivent réduire leur train de vie et leurs aspirations matérielles.
Lire aussi : Dennis Meadows : « Il faut mettre fin à la croissance incontrôlée, le cancer de la société »*
L’épisode n’a pas duré longtemps mais, pour la première fois, le débat politique a brièvement porté sur ce thème nouveau : pour ou contre la croissance ? Pour ou contre l’expansion ? Alors que l’écologie politique française émerge comme une force politique nouvelle, la « controverse Mansholt-Marchais » est un épisode à la fois fondateur et frustrant pour les écologistes. Oui, on a enfin parlé des limites à la croissance ; oui, le thème trouve un écho inattendu et la dynamique du mouvement antinucléaire semble prometteuse pour les écologistes ; mais la virulence des critiques adressées de toutes parts à Mansholt montre que le monde politique et économique est vent debout contre toute remise en cause de la croissance et de l’expansion.
Avril 2022 : cinquante ans ont passé. Les Français viennent de voter pour le premier tour de l’élection présidentielle. La campagne a pu sembler agitée par des thèmes potentiellement porteurs pour l’écologie politique : un nouveau rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) plus alarmant que jamais, une guerre en Ukraine qui fait craindre pour la sûreté des centrales nucléaires, une hausse des prix de l’énergie comparable à un choc pétrolier et gazier, etc. Mais non. Le second tour se jouera entre un président sortant, dont le bilan écologique n’est pas à la hauteur des enjeux, et une candidate d’extrême droite dont le programme montre qu’elle ferait encore pire. Tous deux ont la conviction que la réponse à la crise écologique passe moins par la sobriété que par la relance de la croissance et du nucléaire. Depuis cinquante ans, la promesse de solutions techniques est restée un argument récurrent de relativisation des limites écologiques, qui transcende les différences partisanes et prétend que nous n’aurions pas à choisir entre transition écologique et abondance matérielle.
Lire aussi La sobriété, cette « évidence » devenue un angle mort de la société de consommation**
Les résultats décevants de l’écologie politique en 2022 ne sont que marginalement attribuables aux faits et gestes de tel ou tel candidat. Ils s’inscrivent dans une tendance longue : depuis cinquante ans, la simple idée qu’il puisse exister des limites écologiques à la croissance et à l’expansion est restée dissonante, minoritaire dans l’opinion publique, et carrément hérétique parmi les décideurs. L’idée de décroissance y est au mieux ignorée, au pire utilisée comme une invective facile pour disqualifier l’ensemble des écologistes comme autant de fous inconséquents. Le rejet est si fort que, même parmi les partisans de la décroissance, beaucoup préfèrent s’autocensurer – attention, ne nous enfermons pas dans la radicalité et la marginalité, tentons plutôt de rassembler autour de termes et de projets moins clivants, etc.
Aborder de front la question des limites
Le problème est que la situation climatique et écologique est telle qu’il faudrait aborder de front la question des limites. Le dernier rapport du GIEC montre que les réductions des émissions de gaz à effet de serre, et donc les réductions de consommation d’énergies fossiles, devraient être massives et rapides, voire fulgurantes : les longues années qu’il faudrait pour construire plusieurs nouveaux réacteurs nucléaires sont un problème. La guerre en Ukraine nous rappelle le danger qui entoure et entourera toujours les réacteurs. Notre difficulté à nous passer du gaz russe révèle crûment la dépendance aux énergies fossiles qui demeure, et la vulnérabilité qui en découle. Cinquante ans de déni, de tergiversation, de procrastination ont conduit à une situation inextricable, où les questions du pouvoir d’achat et du prix à la pompe continuent à reléguer toute autre préoccupation au second plan. Lentement, le piège écologique, énergétique et climatique se referme.
Pour l’écologie politique, le principal enseignement de l’élection de 2022 est la confirmation que la question des limites à la croissance reste un immense impensé politique, consciencieusement confiné hors du champ du pensable par une écrasante majorité des décideurs. Quelques brèches apparaissent parfois ici ou là, mais sans durablement faire émerger un projet politique en rupture avec la croissance et son monde. Il revient à l’écologie politique la tâche ingrate de s’interroger à nouveau sur sa raison d’être, et de se réinventer dans un contexte d’assombrissement des horizons écologiques et climatiques. Elle pourrait être porteuse d’un projet assumé de réduction massive des surconsommations des plus riches, de protection des plus vulnérables, de partage des richesses et de répartition équitable des efforts de sobriété, dans le cadre d’une décroissance en urgence des flux de matière et d’énergie – d’où moins de voitures, moins d’avions, moins d’équipements… Mais qui veut entendre ça ?
Luc Semal est maître de conférences en science politique au Muséum national d’histoire naturelle. Chercheur au Centre d’écologie et des sciences de la conservation (Cesco) et spécialiste des mobilisations écologistes, il a notamment écrit Face à l’effondrement. Militer à l’ombre des catastrophes (PUF, 2019) et dirigé (avec Bruno Villalba) Sobriété énergétique. Contraintes matérielles, équité sociale, perspectives institutionnelles (Quæ, 2018).
Luc Semal(Politiste, Maître de conférences au Muséum national d’histoire naturelle et membre de l’Institut Momentum)
*Dennis Meadows : « Il faut mettre fin à la croissance incontrôlée, le cancer de la société »
Dans un entretien au « Monde », le physicien, coauteur il y a cinquante ans du rapport du Club de Rome « Les Limites à la croissance », estime que l’impératif est aujourd’hui de changer « les valeurs et les objectifs » des sociétés contemporaines, qui courent à leur perte.
Propos recueillis par Audrey Garric
Publié le 08 avril 2022 à 02h03 – Mis à jour le 08 avril 2022 à 11h06 https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/08/dennis-meadows-il-faut-mettre-fin-a-la-croissance-incontrolee-le-cancer-de-la-societe_6121114_3232.html
Temps de Lecture 8 min.
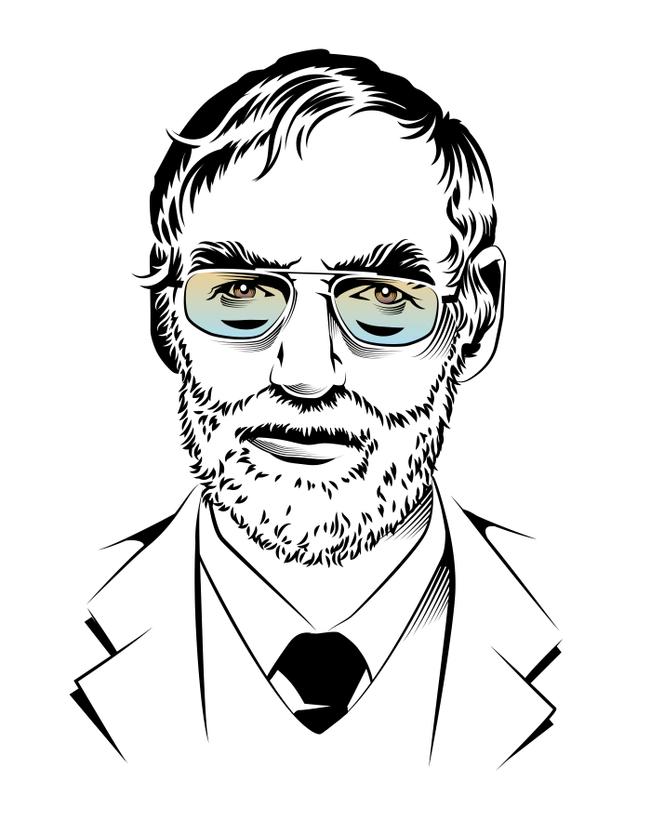
C’est un texte qui a fait date. En 1972, répondant à une commande du Club de Rome, un think tank basé en Suisse, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) publiaient The Limits to Growth, un rapport montrant que la croissance économique ne pouvait se poursuivre indéfiniment dans un monde aux ressources finies. Il prévoyait que la population et la production industrielle et de nourriture finiraient par ralentir puis reculer, contraintes par les limites de la planète disparition des ressources naturelles et capacité limitée de la Terre à absorber les émissions.
Lire aussi Dennis Meadows : « La démocratie a échoué à traiter le problème environnemental »
L’un de ses coauteurs, le physicien américain Dennis Meadows, 79 ans, a répondu aux questions du Monde, à l’occasion du cinquantième anniversaire du rapport, et de la publication d’une nouvelle version de ce best-seller, le 3 mars, Les Limites à la croissance (dans un monde fini), aux éditions Rue de l’Echiquier (488 pages, 14,90 euros).
Quel bilan tirez-vous, cinquante ans après la publication du rapport de 1972 ?
Notre empreinte écologique est trop élevée : nous consommons plus de ressources que la Terre ne peut en régénérer, qu’il s’agisse de combustibles fossiles, de sols fertiles, d’eau propre, etc. En 1972, nous avions encore une chance de ralentir ce processus, et de garder la démographie et la consommation à des niveaux soutenables. L’une de nos principales conclusions était que plus nous agissions tôt, meilleurs seraient les résultats. Mais pendant cinquante ans, nous n’avons pas agi. Nous sommes donc au-delà de la capacité de la Terre à nous soutenir, de sorte que le déclin de notre civilisation à forte intensité énergétique et matérielle est inévitable. Le niveau de vie moyen va baisser, la mortalité va augmenter ou la natalité être réduite et les ressources diminueront.
La plupart des gens pensent que l’épuisement des ressources ne nous affecte que lorsqu’il n’y a plus rien dans le sol. C’est plus complexe que cela. Les limites à la croissance sont liées au fait que, progressivement, le coût des ressources devient si élevé que nous ne pouvons plus nous permettre de les utiliser en si grandes quantités. Nous sommes actuellement dans cette situation où, par exemple, le prix du pétrole devient trop cher pour les consommateurs.
Envie d’en savoir plus sur la croissance et la décroissance ?Test gratuit
L’un de vos scénarios prévoyait que la croissance s’arrêterait autour de 2020. Est-ce vraiment ce que l’on observe maintenant ?
Cette possibilité est en train de se réaliser : les ressources sont de plus en plus chères, la demande est de plus en plus importante, de même que la pollution. La question est désormais de savoir non pas si mais comment la croissance va s’arrêter. Ce que nous voyons, c’est que la population diminue maintenant dans certains pays, au Japon, en Russie et bientôt en Chine. Bien sûr, le PIB continue de croître, mais ce n’est pas un bon indicateur du bien-être humain, car il augmente avec les activités néfastes telles que la réparation des dégâts de la guerre en Ukraine.
Le PIB augmente, mais ses composantes changent. Il s’agit de plus en plus de réparer les dommages environnementaux ou de remplacer les services gratuits que nous obtenions de la Terre, comme extraire l’eau du sol et la boire sans la dépolluer. Avant, les gens s’attendaient à avoir une vie meilleure que celle de leurs parents, maintenant ils pensent que leurs enfants seront moins bien lotis parce que la société ne produit plus de véritables richesses.
Le dépassement des limites va-t-il forcément se traduire par un effondrement ?
Imaginez une voiture qui roule vers un mur. Elle peut s’arrêter de deux façons, soit en freinant, soit en heurtant le mur. Lors de la réédition de notre ouvrage, en 2004, il était encore possible de ralentir par une action humaine. Maintenant, je pense que c’est trop tard. Il n’y a aucune possibilité de maintenir la consommation d’énergie aux niveaux actuels ni de ramener la planète dans ses limites. Cela signifie-t-il l’effondrement ? Si vous allez aujourd’hui en Haïti, au Soudan du Sud, au Yémen ou en Afghanistan, vous pourriez conclure qu’il a en fait déjà commencé. Il y a eu tellement de civilisations, les Phéniciens, les Romains, les Mongols et, plus récemment, les Américains. Elles se développent et puis c’est leur fin. C’est notre condition humaine.
Lire aussi :
Dominique Méda : « L’heure de la sobriété est venue »
Faut-il donc abandonner l’objectif de développement durable ou de croissance verte ?
Le développement durable n’est plus possible. Le terme de croissance verte est utilisé par les industriels pour continuer leurs activités à l’identique. Ils ne modifient pas leurs politiques mais changent de slogan. C’est un oxymore. Nous ne pouvons pas avoir de croissance physique sans entraîner des dégâts à la planète. Les pays pauvres en ont toujours un peu besoin, mais les riches doivent passer à un développement qualitatif – améliorer l’équité, la santé, l’éducation, l’environnement.
Pourquoi les gouvernements et les populations ne réagissent-ils pas ?
Il y a plusieurs raisons. D’abord, parce qu’en raison de l’évolution génétique depuis des centaines de milliers d’années nous ne sommes pas faits pour penser sur le long terme, mais sur le court terme : comment survivre face aux animaux sauvages. Ensuite, en raison de notre égoïsme. Beaucoup de gens tirent de l’argent et du pouvoir à court terme grâce à la croissance, donc résistent au fait de la ralentir. Enfin, notre système politique ne récompense pas les politiciens qui auraient le courage de faire des sacrifices maintenant pour obtenir des bénéfices plus tard. Ils risquent de ne pas être réélus.
L’autre élément majeur, c’est que la promesse de croissance infinie est devenue la base du consensus politique. Quand tout le monde comprendra que la croissance ne peut pas continuer ainsi, les changements nécessaires seront impossibles car ceux qui s’attendent à obtenir moins y feront obstacle.
Y a-t-il un système de gouvernance qui puisse réaliser les changements nécessaires ?
Actuellement, tous les systèmes politiques – démocraties, dictatures, anarchies – échouent à résoudre les problèmes de long terme, comme le changement climatique, la hausse de la pollution ou des inégalités. Ils ne le peuvent pas, à moins qu’il y ait un changement dans les perceptions et valeurs personnelles. Si les gens se souciaient vraiment les uns des autres, des impacts sur le long terme et dans des endroits éloignés d’eux-mêmes, alors n’importe quelle forme de gouvernement pourrait créer un avenir meilleur.
Dans votre nouvelle préface, vous écrivez anticiper des « changements politiques d’ampleur considérable ». Lesquels ?
Le changement climatique, l’épuisement des combustibles fossiles ou encore la pollution de l’eau vont entraîner des désordres, des chocs, des désastres et catastrophes. Or si les gens doivent choisir entre l’ordre et la liberté, ils abandonnent la seconde pour le premier. Je pense que nous allons assister à une dérive vers des formes de gouvernement autoritaires ou dictatoriales. Actuellement déjà, l’influence ou la prévalence de la démocratie diminue et dans les pays dits démocratiques comme les Etats-Unis, la vraie liberté diminue.
Les solutions technologiques peuvent-elles nous aider ?
Même en étant un technologue, et en ayant été un professeur d’ingénierie pendant quarante ans, je suis sceptique. Le problème ne vient pas de la technologie, mais de nos objectifs et valeurs. Si les objectifs implicites d’une société sont d’exploiter la nature, d’enrichir les élites et de faire fi du long terme, alors elle développera des technologies dans ce sens. Nous n’avons pas besoin de nouvelles technologies agricoles pour réduire la faim dans le monde. Nous devons simplement mieux redistribuer la nourriture que nous produisons. Les technologies ont par ailleurs un coût (en énergie, argent, etc.) et viendra un moment où il sera trop élevé.
Pour sortir des énergies fossiles, vous défendez l’efficacité énergétique et le développement des renouvelables, mais pas celui du nucléaire. Pourquoi ?
Le nucléaire est une idée terrible. A court terme, car il y a un risque d’accident catastrophique : puisqu’on ne peut pas éviter à 100 % les erreurs humaines, on ne devrait pas prendre un tel pari. A long terme, car nous allons laisser les générations futures gérer le problème des déchets pendant des milliers d’années. L’énergie renouvelable est formidable, mais il n’y a aucune chance qu’elle nous procure autant d’énergie que ce que nous obtenons actuellement des fossiles. Il n’y a pas de solution sans une réduction drastique de nos besoins en énergie.
Lire aussi La croissance, nouveau clivage politique
Aujourd’hui, à la place du développement durable, vous défendez un objectif de résilience à l’échelle locale. De quoi s’agit-il ?
C’est la capacité à absorber les chocs et continuer à vivre, sans cesser de pourvoir aux besoins essentiels en matière de nourriture, de logement, de santé ou de travail. C’est la capacité de récupération d’une ville après un tremblement de terre, d’une forêt après un incendie. On peut le faire par soi-même, contrairement à la durabilité : on ne peut pas adopter un mode de vie durable dans un monde non durable. A l’inverse, à chaque fois que quelqu’un est plus résilient, le système le devient davantage. Il faut maintenant l’appliquer à chaque niveau, mondial, régional, communautaire, familial et personnel.
Comment éviter les caricatures d’un retour à la bougie ou à l’âge de pierre ?
Je pense que les problèmes entraînés par l’absence de résilience le feront pour nous. Avec la guerre en Ukraine, de nombreux pays prennent soudainement conscience qu’il serait souhaitable d’être plus résilients dans l’utilisation de l’énergie ou de la production alimentaire. Nous devrions aussi éviter le terme de décroissance, car il est principalement négatif – il met l’accent sur tous les problèmes de la croissance. Or nous savons que, pour réussir politiquement, il faut être pour quelque chose. Il faut donc trouver une image positive d’une société sans croissance : par exemple, le fait d’accéder à plus de bonheur ou à une meilleure santé.
Lire aussi : « Il est temps de cesser de confondre croissance et développement »
En 1972, votre rapport effleurait le changement climatique. Comment la connaissance actuelle a-t-elle fait évoluer vos travaux ?
Le changement climatique, de même que l’extinction des espèces ou l’augmentation des déchets plastiques, que l’on qualifie de problèmes, sont en fait des symptômes. La limitation du changement climatique est utile, mais revient à donner une aspirine à quelqu’un atteint d’un cancer. Cela l’aidera seulement à se sentir mieux temporairement. Il faut mettre fin à la croissance incontrôlée, le cancer de la société.
Gardez-vous de l’espoir ?
Pas pour cette civilisation intensive en énergie et en matériaux. Elle va disparaître et devenir quelque chose de différent. Chacun d’entre nous peut encore espérer améliorer les choses pour lui-même, mais pas pour la société globale. Les jeunes peuvent manifester autant qu’ils le veulent pour le climat, cela ne fera pas baisser le CO2 et n’empêchera pas la mer de monter. Mais peut-être que cela aidera la société à mieux s’adapter aux changements.
Audrey GarricContribuer
La sobriété, cette « évidence » devenue un angle mort de la société de consommation
La notion de modération ou de frugalité est devenue marginale à partir du XVIIIe siècle dans les sociétés d’abondance. Elle réapparaît aujourd’hui, mais sans définition précise.
Par Claire LegrosPublié le 17 novembre 2021 à 01h22 – Mis à jour le 17 novembre 2021 à 14h59
Temps de Lecture 4 min.

Histoire d’une notion. Réduire ses déplacements, relocaliser ses achats, privilégier les objets d’occasion… Ces idées semblent faire leur chemin dans l’opinion publique, selon le baromètre de l’Agence de la transition écologique (Ademe).
La notion de sobriété, notamment énergétique, suscite aussi « un intérêt croissant de la part des sciences sociales et politiques », note Edouard Toulouse (La Revue de l’énergie, mars-avril 2020), ingénieur et membre de l’association négaWatt, qui anime, depuis 2017, Enough, un réseau international de recherche sur le sujet. Pour autant, elle reste peu mobilisée dans les politiques publiques. « Il y a là comme un angle mort, un sujet tabou », constate Barbara Nicoloso, directrice de l’association Virage Energie, qui accompagne les collectivités dans leur transition énergétique.
Une notion ancienne
Comment expliquer ce phénomène ? Qu’on la nomme « tempérance » ou « frugalité », la modération est une notion ancienne, qui s’enracine dans les grandes traditions philosophiques et religieuses. Présente dans la pensée grecque et les principales religions, elle est longtemps perçue comme « une évidence », dans des sociétés « soumises aux contraintes matérielles », où les populations s’organisent « pour répartir des sources d’énergie peu abondantes, gérer la pénurie pour se chauffer, s’alimenter, se déplacer, ou produire des biens », rappelle l’historien des techniques François Jarrige (« Sobriété énergétique, un nouvel oxymore ? », AOC,février 2020).
La démarche est individuelle mais aussi collective. Dans son ouvrage Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie (Gallimard, 2006), le géographe Jared Diamond cite l’exemple des Islandais, qui ont su, pendant des siècles, limiter le nombre de moutons par éleveur, afin de préserver un environnement volcanique où la terre fertile est une denrée rare.
C’est à partir du XVIIIe siècle que s’opère un basculement de la pensée occidentale. Avec les sciences modernes émerge l’idée que la Terre est exploitable, qu’il suffit de la creuser pour en extraire une énergie abondante.
Se déploie alors « un nouvel imaginaire où l’émancipation et la réalisation de soi passent par un progrès technologique sans limite, qui pourvoit à la satisfaction matérielle de tous les désirs », analyse Barbara Nicoloso, autrice d’un Petit traité de sobriété énergétique (Charles Léopold Mayer, 200 pages, 10 euros). Au XIXe siècle, la sobriété devient même une idée rétrograde, « un signe de misère ou de retard », constate François Jarrige. Alors que les promoteurs du charbon, du pétrole, puis du nucléaire sont célébrés comme des héros, « leurs opposants et tous ceux qui cherchaient d’autres chemins ont été oubliés et rejetés dans les poubelles du passé ».
La question de la justice sociale
Ce récit se renforce encore tout au long du XXe siècle jusqu’à l’avènement de la société de l’hyperconsommation et du tout-jetable. L’idée de sobriété est marginalisée, portée par des philosophes critiques de la société industrielle, comme Jean Baudrillard – il dénonce, dans La Société de consommation, en 1970, la « mystique de la croissance » –, les penseurs Jacques Ellul et Ivan Illich ou l’économiste Serge Latouche, théoricien de la décroissance, qui propose de mettre en œuvre la « satisfaction d’un nombre judicieusement limité de besoins » (Le Pari de la décroissance, 2006).
Lire aussi Simplicité, sobriété… La conversion aux « low tech » de jeunes ingénieurs
Ces réflexions rencontrent peu d’écho. La « chasse au gaspi », lancée par Valéry Giscard d’Estaing en 1979 après les chocs pétroliers, apporte la preuve qu’une stratégie de rationnement volontaire à l’échelle d’un pays est possible. Mais cette politique se veut transitoire et tourne court avec le développement du parc de centrales nucléaires, tandis que la consommation énergétique repart de plus belle. Dans un modèle de société fondé sur la croissance, la sobriété dérange. Elle est, à tort, souvent assimilée à la recherche d’efficacité – faire plus avec moins – qui mise sur le progrès technologique pour préserver la planète.
Or, des travaux en sciences de l’environnement montrent que si l’efficacité est un élément important pour agir sur le climat, elle n’est pas suffisante et doit être associée à une profonde réflexion sur les usages et les modes de vie. Dans cette perspective, les initiatives individuelles ne suffiront pas. « La sobriété n’a de sens que si elle est portée par la collectivité, assure Bruno Villalba, professeur de science politique à AgroParisTech et coauteur de Sobriété énergétique (Quæ, 2018). Elle relève aujourd’hui d’une pratique sociale aux contours flous, et manque à la fois d’une définition précise, d’indicateurs qui permettent d’en modéliser les effets, et de mécanismes de politiques publiques décidés démocratiquement. »
Lire la tribune : « La révolution silencieuse de la sobriété s’immisce dans de nombreux pans de nos vies »
A quoi renoncer pour être efficace ? Comment faire la part entre les besoins fondamentaux et ce dont on peut se passer, alors que des travaux scientifiques montrent que cette distinction est plus culturelle qu’universelle, et évolue avec le développement de la société ? Et surtout comment définir un accès équitable à l’énergie et aux biens quand une large part de la population vit déjà une sobriété qu’elle n’a pas choisie ?
Mettre en œuvre une politique de sobriété pose de nombreuses questions, et en premier lieu celle de la justice sociale. « La sobriété n’est ni l’ascèse ni la privation, mais un rééquilibrage qui doit se construire démocratiquement et suppose d’inventer un autre imaginaire de liberté et d’émancipation », assure Barbara Nicoloso. Il n’est peut-être pas trop tard.
Claire Legros
Voir aussi: