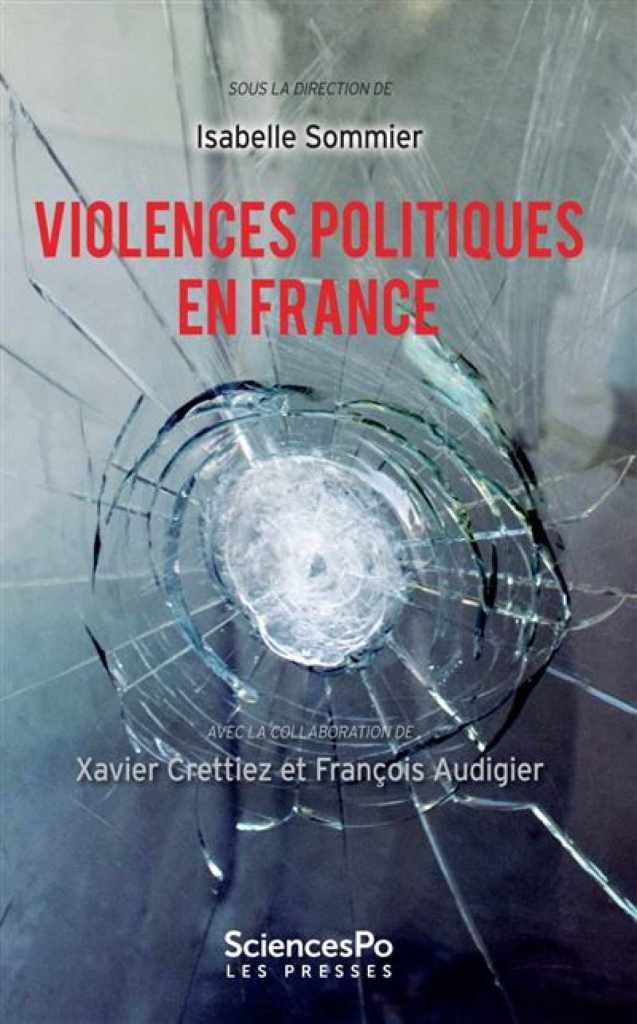Isabelle Sommier : « Il faut toujours penser ensemble la violence contestataire et la violence d’Etat »
Dans un entretien au « Monde », la sociologue observe ces dernières années un maintien de l’ordre qui « contribue à une montée en radicalité » des manifestants.
Propos recueillis par Abel MestrePublié hier à 17h45, mis à jour à 06h08
Temps de Lecture 4 min.

Isabelle Sommier, professeure de sociologie politique à l’université Paris-I – Panthéon-Sorbonne et chercheuse au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, a dirigé l’ouvrage Violences politiques en France (Presses de Sciences Po, 416 pages, 24 euros), qui part de l’étude de 6 000 épisodes de violence politique entre 1986 et la période actuelle.
Ce livre se base sur une recension précise des faits de violence politique en France, entre 1986 et aujourd’hui. Pourquoi avoir fait le choix d’objectiver ce phénomène ?
Il y a des chiffres officiels sur la délinquance, mais pas sur la violence militante, pour laquelle on ne disposait que d’ouvrages historiques ou de monographies. On a fait le pari de construire une base statistique pour objectiver la réalité du recours à la violence sous toutes ses formes, des agressions aux attentats, en passant par les affrontements et les dégradations, dans plusieurs familles activistes, et cela sur une période suffisamment longue, de presque quarante ans, à distance de l’autre grande période militante, celle de 1968. Grâce à ce regard clinique, un certain nombre d’attendus ou de préjugés tombent.
Pourquoi débuter en 1986 ?
C’est l’apogée d’Action directe avec l’assassinat de Georges Besse [le PDG de la régie Renault, tué par balles], avant que le groupe ne soit démantelé, mais aussi le début des attentats islamistes en France : on entre dans une nouvelle ère. 1986 c’est également l’apparition des coordinations de grévistes qui mettent en arrière-plan les syndicats traditionnels. Cette tendance à l’autonomie des luttes ne fera que se renforcer.
« Au XXe siècle ce sont les attentats qui prévalaient, aujourd’hui ce sont surtout les dégradations »
C’est enfin l’année du mouvement contre la loi Devaquet, avec la mort de Malik Oussekine [un étudiant tué par deux policiers en marge d’une manifestation] qui, à la suite d’une commission d’enquête, conduira à une évolution des techniques des forces de police des foules. Lesquelles connaissent un nouveau changement de doctrine, favorisant le contact physique, comme on le voit depuis 2016 et plus encore 2018. Il faut toujours penser ensemble la violence contestataire et la violence d’Etat.
En presque quarante ans, quelles dynamiques et évolutions sont apparues ?
On a distingué cinq familles : les idéologiques, les confessionnels, les séparatistes, les professionnels, les sociétaux. Ce qui est frappant avec ces 6 000 épisodes de violence étudiés, c’est que la moitié est le fait des indépendantistes, des Corses au premier chef. Ils sont très présents pendant la première période, puis déclinent pour être supplantés par les « idéologiques » et les « confessionnels ». Il y a aussi une bascule : on passe d’organisations très structurées, voire clandestines, à des groupes informels, instables. Et il y a un groupe nouveau qui émerge avec une dynamique forte : celui des animalistes.
Sur le plan des modes d’action, il y a un changement : au XXe siècle ce sont les attentats qui prévalaient, aujourd’hui ce sont surtout les dégradations. Il y a également des transformations internes à un camp politique dans le choix de ses cibles. Par exemple, les agressions sont massivement (aux deux tiers) le fait de l’extrême droite, surtout des skinheads et des néonazis qui, dans les années 1980, ciblaient les juifs – 2 % des cas aujourd’hui. On a maintenant des agressions altérophobes, commises contre des personnes « racisées ».
Il y a une spécificité sur la violence islamiste : peu de faits mais une forte létalité…
En nombre d’épisodes violents, les « confessionnels » représentent moins de 7 % mais les islamistes seuls sont responsables de 84 % de l’ensemble des morts. Il y a une distorsion entre le nombre de faits et le nombre de victimes. Ces groupes religieux sont portés par une vision apocalyptique, sur le mode « vous êtes avec nous ou contre nous ». Il n’y a aucune retenue dans les moyens utilisés, au contraire. Plus ils tuent au hasard, plus il y aura d’écho.
Un chapitre du livre est consacré à la période 2016-2020. Est-ce un cycle politique à l’image du cycle post-1968 ?
Il faut plus de recul, mais c’est vrai que l’on repère depuis la loi travail, en 2016, certaines particularités. Il y a une remontée des violences et surtout de l’usage émeutier de la manifestation. La manifestation ne s’est dégagée de l’émeute que progressivement par l’institutionnalisation. Il y a aujourd’hui un processus inverse. Deux phénomènes sont à analyser : l’accentuation de la défiance, la délégitimation des organisations représentatives qui portent traditionnellement les manifestations, par des primo-manifestants comme une grande partie des « gilets jaunes » ou des groupes qui rejettent le principe de la représentation, comme les autonomes. On est plus dans la déambulation inorganisée.
Lire aussi « On a assiste à une escalade de la violence en manifestation »
De l’autre côté, on a un maintien de l’ordre très particulier qui contribue à la montée en radicalité des manifestants et à une solidarisation de ceux qui ne sont pas venus en découdre à l’égard d’éléments plus violents.
Dans ce chapitre, les « gilets jaunes » occupent une place centrale. Comment les définir ?
On a décidé de les classer dans la catégorie des « professionnels ». Dans ce mouvement, il était surtout question de pouvoir d’achat, de dignité au travail malgré sa précarisation. Bref, de thématiques sociales. C’est un phénomène inouï, par sa composition socioprofessionnelle – des classes moyennes inférieures, des artisans, des commerçants, beaucoup de femmes –, par sa durée et son extension sur tout le territoire. Il va favoriser un processus de politisation sur les ronds-points, en témoigne l’extension des revendications : d’une révolte antifiscale à des revendications liant la question sociale à la question démocratique. C’est tout à fait inédit.
Plus de trente ans de « Violences politiques en France » passés au crible
L’ambition est haute : étudier les 6 000 actes de violences politiques commis en France depuis 1986. C’est tout l’objet de Violences politiques en France (Presses de Sciences Po, 416 pages, 24 euros), dirigé par Isabelle Sommier, professeure de sociologie politique à Paris-I, en collaboration avec Xavier Crettiez (professeur de science politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye) et François Audigier (professeur d’histoire à l’Université de Lorraine).
Ce travail de fourmi permet de connaître l’évolution d’un phénomène qui fascine tant les politiques que les médias, mais qui est trop souvent traité en s’appuyant sur des préjugés. Ainsi, l’on voit que la violence d’extrême droite privilégie les atteintes aux personnes, quand à gauche, ce sont les atteintes aux biens et les affrontements avec les forces de l’ordre. De même, on oublie à quel point les séparatistes corses ont tenu le haut du pavé de la violence militante au XXe siècle. Un chapitre est également consacré aux « sociétaux », famille militante qui connaît un fort dynamisme, notamment à travers la lutte antinucléaire ou le mouvement animaliste.
A travers l’étude de ces phénomènes, le livre décrit scientifiquement un moment charnière dans l’histoire politique de notre pays – celui de la fin du XXe siècle et de ses idéologies – et l’avènement d’un nouveau désordre mondial. Une mue qui trouve ses traductions en France dans les attentats islamistes, mais aussi dans des rapports sociaux de plus en plus tendus où les corps intermédiaires qui servaient de médiateurs disparaissent.