Vendre de la discorde plutôt qu’informer
Un journalisme de guerres culturelles
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/03/HALIMI/62848
Le juste milieu ne rapporte plus. Hier assise sur la manne publicitaire, la presse modérée recherchait une audience de masse et la cajolait en simulant l’objectivité. La recette change. Désormais, les médias prospèrent en alimentant les guerres culturelles auprès de publics polarisés et mobilisés. Pour le meilleur ou pour le pire. Et sous le regard vigilant, parfois sectaire, de leur propre lectorat.
par Serge Halimi & Pierre Rimbert

Il rachète à tour de bras médias et éditeurs (Vivendi, Editis, Prisma), convoite Europe 1, taille dans les effectifs et les dépenses, encourage un journalisme de racolage destiné à l’extrême droite (CNews), fait régner la terreur dans les rédactions — et menace de poursuivre en justice Le Monde diplomatique, qui enquête sur ses activités en Afrique : s’il fallait personnifier les nuisances du capitalisme médiatique, le nom de Vincent Bolloré s’imposerait d’emblée.
Abondamment commentée dans la presse, la brutalité du milliardaire breton ne fournit pourtant pas le meilleur indicateur du mouvement qui bouscule le paysage journalistique des années 2020. Car la force montante ne se trouve ni dans l’infographie des propriétaires (1), ni dans le Bottin des annonceurs. Elle se devine dans l’empressement des directions éditoriales à s’excuser quand un article déplaît à leurs lecteurs. Ce nouveau pilier de l’économie de la presse fut longtemps considéré comme la cinquième roue du carrosse médiatique : les abonnés. Leur influence croissante fait résonner au cœur des rédactions les clameurs et les clivages de nos sociétés. Cette irruption ne concerne pour le moment qu’une poignée de titres. Mais elle traduit un mouvement de fond.
Certes, l’appropriation privée rebat toujours les cartes du grand Monopoly de la communication. Mais elle a cessé de bouleverser un secteur depuis longtemps soumis à sa logique marchande. Et à son corset managérial : alors que les écrans dévorent toujours plus avidement le temps et les conversations, les forces qui produisent l’information se raréfient. En France, le nombre de journalistes s’effrite à un rythme modéré (— 6% entre 2008 et 2019), mais l’effectif a chuté de près d’un quart aux États-Unis. Cette moyenne masque une disparité : les rédactions américaines ont supprimé 36 000 emplois dans la presse écrite tandis qu’elles créaient 10 000 postes dans les médias non imprimés (2).
Longtemps prophétisé, le régime d’information à deux vitesses — riche pour les riches, pauvre pour les pauvres — s’installe sous nos yeux. Il réverbère la géographie des inégalités éducatives et culturelles. Moins agile à se déployer en ligne compte tenu de l’âge et des habitudes de son lectorat, la presse locale s’appauvrit, se concentre ou, comme aux États-Unis, s’éteint : plus de 2 100 quotidiens et hebdomadaires y ont disparu depuis 2004, soit un quart du total, bien souvent remplacés par un réseau de sites partisans dont l’allure journalistique, la maquette classique et la couverture territoriale servent de paravent à la diffusion d’articles de complaisance financés par des intérêts liés aux partis politiques (3). La survie de la presse locale reposait sur la publicité et les petites annonces, deux ressources englouties par Facebook et Google, qui, eux, ne produisent pas d’informations mais pillent celles des journaux qu’ils ont préalablement privés d’annonceurs.
Proportionnel au nombre de paires d’yeux tombées sur la réclame imprimée, le prix de la publicité obéit à une tout autre règle sur Internet, où la qualité du ciblage remplace la quantité de public touché. Or, dans ce domaine, nul ne surclasse les prédateurs de la Silicon Valley. Leur concurrence force la presse généraliste à vendre ses espaces numériques à prix sacrifiés : de l’an 2000 (quand Google crée sa régie) à 2018, ses recettes publicitaires ont été divisées par trois (4). La pandémie leur porte le coup de grâce. Au deuxième trimestre 2020, la mise à l’arrêt de l’économie a sabré 20% des revenus procurés par les annonceurs du Monde (5) — et 44% au New York Times (6 août 2020).
Ci-gît le modèle du «double marché» inventé en 1836 par Émile de Girardin qui, d’un côté, alléchait le chaland par un faible prix de vente et, de l’autre, vendait le lectorat aux marchands souhaitant placer leur réclame. Cette économie impliquait une double dépendance : aux annonceurs quand tout allait bien; aux actionnaires, sollicités pour remettre au pot, en période de vaches maigres. Elle connaît son âge d’or dans les années 1960 et 1970, puis, sur un mode plus frénétique, lors de la «bulle Internet» qui éclata en 2000 : dans les couloirs de Libération, un quotidien alors gavé de publicité, les dirigeants éditoriaux gloussaient qu’ils pourraient désormais se dispenser des ventes. Les journaux dits «gratuits» concrétiseront en 2002 cette stratégie de génie — avant de disparaître dans le trou noir de l’économie numérique.
Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la prééminence de la ressource publicitaire avait transformé la vision du monde social renvoyée aux lecteurs : «La couverture du monde du travail a diminué et changé d’orientation, passant de la puissance des syndicats en tant qu’institutions aux désagréments que les grèves imposaient aux consommateurs», observe Nicholas Lemann, professeur de journalisme à l’université de Columbia (6). L’ère de la réclame avait coïncidé avec une élévation sensible du salaire, du statut et du niveau de diplôme des salariés de la presse. Elle se clôt dans un climat de précarité des producteurs d’information, de discrédit des médias, de défiance radicale entre les classes populaires et les couches intellectuelles. «Pour la toute première fois, moins de la moitié des Américains font confiance aux médias traditionnels», s’épouvante en janvier dernier une société de conseil (7). L’élection surprise de M. Donald Trump en 2016 aura dissipé aux yeux des lecteurs du New York Times le mirage d’une société de marché pacifiée par les vertus de l’éducation et de la communication. Un nouveau modèle émerge, mieux ajusté à l’anémie publicitaire et aux réalités d’une société fracturée : celui de médias hyperpartisans, de masse ou de niche, financés lorsqu’ils relèvent de l’écrit par une solide base d’abonnés.
L’abonné : «Temps futurs! Vision sublime!» Les médias sont hors de l’abîme… Hier jugé hors d’atteinte et hors du coup par les génies d’Internet, convaincus que l’information en ligne serait gratuite ou ne serait pas, ce souscripteur fidèle fait quinze ans plus tard l’objet de toutes les convoitises. Des chaînes payantes, plates-formes de diffusion vidéo et audio ont démontré que, à l’époque de la gratuité et du piratage généralisés, les utilisateurs restent disposés à payer un service spécifique pourvu qu’on ne le trouve pas ailleurs.
Au jeu de la conversion de l’audience gratuite en lecteurs payants, seuls les journaux les plus puissants et les plus spécialisés triomphent. Pour ceux nés à l’époque de l’imprimerie, la réussite économique passe par le sacrifice progressif du papier et de ses coûts d’impression et de distribution. Le Monde compte 360 000 abonnés numériques au début de cette année et vise le million en 2025, pour seulement 100 000 abonnés papier. De son côté, après une décennie de numérisation à marche forcée, le New York Timesa plastronné : «Pour la première fois, les recettes des abonnés au numérique dépassent celles des abonnés au papier»(5 novembre 2020). À cette date, 4,7 millions de souscripteurs sur écrans rapportaient à peine plus que les 831 000 abonnés à l’édition imprimée : le salut économique impose donc un recrutement numérique tous azimuts. Dans un raccourci saisissant de notre époque, des fabricants de papier journal, comme Norske Skog, reconvertissent leurs machines afin de produire du carton d’emballage pour Amazon (8)…
«Avant Internet, le New York Times, comme tous les journaux, se contentait de servir ses maîtres publicitaires. Aujourd’hui, en l’absence d’autres formes de revenus — subventions gouvernementales, fondations à but non lucratif —, c’est le lecteur qui décide si une publication vit ou meurt, résume Ross Barkan, journaliste et militant de l’aile gauche du Parti démocrate. Et cela confère au public un pouvoir nouveau (9). » À première vue, la bascule marque un bond vers l’indépendance : les abonnés ne réclament-ils pas la meilleure information possible là où les annonceurs n’exigent qu’un temps de cerveau disponible? Naguère perçu comme hétérogène et dépourvu de moyen de pression, le lectorat a rarement disposé d’une influence sur la ligne éditoriale. En se fixant une identité, politique (en France) ou locale (aux États-Unis), chaque publication naissante sélectionnait d’emblée une audience correspondant à sa vision du monde. De leur côté, les responsables de la presse «de qualité» se faisaient de leur clientèle l’image reflétée par le courrier des lecteurs : libérale éclairée, allergique au sectarisme, intéressée à la chose commune et à la marche du monde, ne formant son jugement qu’à partir de faits liés par des raisonnements; la figure de l’«honnête homme», en somme, pour qui la lecture du quotidien représentait, selon la fameuse formule de Friedrich Hegel, «une sorte de prière du matin réaliste». Le journalisme s’inventait un peuple de croyants dont il serait le dieu.
Ce mirage s’est dissipé. Toute source de financement comporte un risque d’influence éditoriale, et le modèle de l’abonnement ne fait pas exception. Les années 1990 et 2000 avaient été marquées par une discordance entre la polarisation sociale croissante des populations et l’homogénéité relative des médias dominants. Les parts de marché, estimaient les comptables de la presse, se gagnent au centre, comme les élections. De l’ère Brexit-Trump, l’élite du journalisme aura retenu cette leçon : l’exacerbation des divisions politiques — et surtout culturelles — alimente l’audience, mobilise les lecteurs et génère du profit. «Les entreprises cherchaient auparavant à attirer un public le plus large possible; elles s’emploient désormais à capter et à retenir de multiples fractions de lectorat, a résumé le journaliste américain Matt Taibbi. Fondamentalement, cela signifie que la presse, qui commercialisait naguère une vision de la réalité supposée acceptable aux yeux d’un large éventail, vend à présent de la division (10) » (lire «Comment Donald Trump et les médias ont ravagé la vie publique»). Plutôt que ses «vieux» lecteurs, qui considèrent encore le journal comme une entité éditoriale à part entière, le New York Times s’emploie à séduire des «communautés» qui reçoivent sur les réseaux sociaux les liens d’articles isolés, détachés du reste de l’édition du jour, mais correspondant étroitement à leurs attentes. Sur chacun des sujets qui les mobilisent, ces petits groupes accueilleront tout faux pas par une tempête de tweets indignés.
Du consensus sédatif au dissensus lucratif, le virage épouse opportunément le fonctionnement des réseaux sociaux. Hier propre à Facebook et à Twitter, le modèle de la chambre d’écho qui renvoie inlassablement aux utilisateurs ce qu’ils veulent lire et entendre s’étend désormais aux médias traditionnels, à cette différence que les lecteurs paient cash pour recevoir les informations qui les caressent dans le sens du poil. D’autant plus persuadés que Twitter arbitre la vie publique qu’ils y passent eux-mêmes une partie significative de leur temps d’éveil, les journalistes confondent volontiers l’activisme polémique alimenté au quotidien par quelques centaines de «twittos» blanchis sous le clavier avec les attentes de leurs centaines de milliers d’abonnés. Échaudés par quelques orages d’indignation numérique, bien des dirigeants éditoriaux évitent de prendre à rebrousse-poil les militants du clic. «Le journalisme en ligne financé par les lecteurs favorise un contenu éditorial plus idéologique : des articles qui réaffirment ce que pense déjà son public, plutôt que de le contredire,écrit Lemann. Ainsi fonctionnent les chaînes d’information câblées (11). »
Selon une enquête réalisée fin 2019 par le Pew Reseach Center, 93% des personnes qui utilisent Fox News comme source principale d’information politique se déclarent républicaines. Symétriquement, 95% de celles qui choisissent MSNBC se disent démocrates; tout comme, dans la presse écrite, 91% des lecteurs du New York Times (12). Divisés de part et d’autre d’une barricade culturelle, deux publics enfermés dans leurs chambres d’écho respectives arment leurs convictions, les répercutent en ligne et, au moindre écart, somment leurs médias favoris de rectifier le tir ou de purger les déviants.
Mais les rafales de tweets qui charpentent les polémiques en ligne influencent-elles vraiment la production d’information? Dans une large mesure, explique une enquête en cours de publication (13). Partant d’une série de plusieurs milliers d’«événements» lancés sur les réseaux sociaux et repris dans les médias traditionnels, les chercheurs établissent que la popularité d’un sujet apparu sur Twitter — mesurée au nombre de tweets, de retweets et de citations qu’il génère — détermine la couverture que lui consacre la presse : «Une augmentation de 1% du nombre de tweets correspond à une augmentation de 8,9% du nombre d’articles.» Et le phénomène est encore plus prononcé dans les journaux où les rédacteurs s’activent le plus ardemment sur la messagerie en 280 signes.
Car les journalistes ont trouvé dans ce réseau social souvent narcissique, péremptoire et moutonnier un monde qui leur ressemble. «Twitter est une fenêtre sur l’actualité du monde, c’est pourquoi certains des comptes les plus actifs appartiennent à des journalistes», claironne une page consacrée aux «bonnes pratiques» du groupe fondé par M. Jack Dorsey (14). C’est la définition même de l’effet Larsen : les journalistes les plus bouillonnants sur un réseau social où piaffent nombre de leurs collègues répercutent dans leurs colonnes l’écho de cet environnement électronique. Issus de plus en plus exclusivement de la bourgeoisie cultivée, au point que plus de la moitié des rédacteurs du New York Times et du Wall Street Journal sortent des universités d’élites américaines (15), les gens de presse oublient que Twitter lui-même attire une clientèle plus diplômée, aisée, urbaine, jeune et de gauche que la population au milieu de laquelle elle vit. Et que la «fenêtre» est elle-même distordue, puisque les 10% de «twittos» les plus prolixes produisent 80% des tweets (16). «Il faut souligner que les utilisateurs de Twitter ne sont pas représentatifs de la population générale des lecteurs de presse»,insistent les auteurs de l’enquête précitée.
Mais il est si doux et, pour un temps, si payant de prendre son reflet pour le miroir du monde…
Serge Halimi & Pierre Rimbert
(1) Lire «Médias français : qui possède quoi?».
(2) Elizabeth Grieco, «10 charts about America’s newsrooms», Pew Research Center, 28 avril 2020, www.pewresearch.org
(3) The New York Times, 19 octobre 2020.
(4) Séries longues de la presse éditeur de 1985 à 2018 — presse d’information générale et politique française, nationale et locale, ministère de la culture, www.culture.gouv.fr
(5) La Lettre A, 30 juillet 2020.
(6) Nicholas Lemann, «Can journalism be saved?», The New York Review of Books,27 février 2020.
(7) www.axios.com, 21 janvier 2021.
(8) L’Usine nouvelle, Antony, 17 juin 2020; Les Affaires, Québec, 30 juin 2018.
(9) Ross Barkan, «The gray zone lady», The Baffler, mars-avril 2020, https://thebaffler.com
(10) Matt Taibbi, «The post-objectivity era», TK News, substack.com, 19 septembre 2020.
(11) Nicholas Lemann, «Can journalism be saved?», op. cit.
(12) Elizabeth Grieco, «Americans’ main sources for political news vary by party and age», Pew Research Center, 1er avril 2020.
(13) Julia Cagé, Nicolas Hervé et Béatrice Mazoyer, «Social media and newsroom production decisions», Social Science Research Network, 20 octobre 2020 (prépublication).
(14) Jennifer Hollett, «How journalists can best engage with their audience», Twitter.
(15) Proportion plus élevée au sein de la Chambre des représentants, du Sénat, des juges fédéraux ou… des patrons du Fortune 500. Cf. Zaid Jilani, «Graduates of elite universities dominate the New York Times and Wall Street Journal, study finds», The Intercept, 6 mai 2018, https://theintercept.com
(16) Stefan Wojcik et Adam Hughes, «Sizing up Twitter users», Pew Research Center, 24 avril 2019.
« L’ affaire Beaud et Noiriel” est exemplaire de la dégradation de la qualité du débat public »
TRIBUNE
Collectif
Revenant, dans une tribune au « Monde », sur la réception particulièrement houleuse de l’essai « Race et sciences sociales » de l’historien et du sociologue, un collectif d’universitaires, dont Irène Théry, Dominique Schnapper et Christian Baudelot, alerte sur les menaces qui pèsent sur les libertés académiques.
Publié aujourd’hui à 06h45, mis à jour à 07h41 Temps de Lecture 2 min.
Tribune. Le 5 février sortait l’ouvrage Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d’une catégorie (Agone, 432 pages, 22 euros), de deux chercheurs dont les travaux, sans nécessairement faire l’unanimité, sont respectés par tous, l’un historien (Gérard Noiriel), l’autre sociologue (Stéphane Beaud). Il s’agit, dans ce livre, de mettre en évidence l’apport des sciences sociales sur les questions de la « race » et du racisme qui se trouvent aujourd’hui au cœur du débat public. Les auteurs se sont efforcés, en effet, de s’éloigner des querelles « identitaires » en mobilisant enquêtes historiques et sociologiques.
On aurait pu croire que cette démarche, qui relève du réflexe professionnel, recueillerait un large soutien de la communauté des chercheurs. Or, force est de constater qu’à quelques exceptions près le renfort se fait attendre, laissant Beaud et Noiriel seuls au front, à défendre l’autonomie et la raison d’être des sciences sociales. Sans doute peut-on le comprendre dans une conjoncture où les adversaires théoriques des deux chercheurs sont la cible de la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal.
Manichéisme moral
C’est justement une bonne occasion d’appeler à un débat scientifique argumenté qui ne saurait se réduire aux invectives, aux insultes et, a fortiori, aux interdictions professionnelles. Or Beaud et Noiriel ont subi ce que l’on appelle dans le langage des réseaux (si peu) sociaux une shit storm, un torrent de boue qu’ont renforcé quelques recensions médiatiques fielleuses. L’« affaire Beaud et Noiriel » est exemplaire de la dégradation de la qualité du débat public et c’est en cela qu’elle nous interpelle, quoi que l’on puisse penser par ailleurs de leur ouvrage.
« L’empire de l’émotion indignée rencontre les intérêts de nombreuses entreprises de presse qui font de l’audience avec ce type de polémiques »
Les libertés académiques sont menacées par la ministre mais elles le sont aussi autrement. Beaucoup de chercheurs, a fortiori lorsqu’ils sont précaires, ont désormais peur de s’exprimer dans un débat où l’intensité de l’engagement se mesure à la véhémence de la critique et où l’attaque ad hominem tient lieu d’argument. Le manichéisme moral invite à ce genre de dérives : le « camp d’en face » et même celui d’à côté seraient, « par nature », mauvais.
L’empire de l’émotion indignée rencontre les intérêts de nombreuses entreprises de presse qui font de l’audience avec ce type de polémiques. Un tribunal médiatique siège en permanence, où les procès à charge remplacent les débats d’idées.
Dans cet état du débat scientifique, les chercheurs qui ont le courage d’aborder des questions polémiques, afin d’instiller, en intellectuels, davantage de réflexivité dans le débat public, sont voués à rencontrer le silence ou les insultes. Une chape de plomb s’abat alors sur un « débat » de plus en plus hermétique aux apports des sciences sociales, tandis que les réseaux sociaux y font régner les rapports de force.
Nous déplorons ces inquiétantes dérives qui voient la morale, l’émotion, l’attaque personnelle remplacer la réflexion, l’argumentation, l’intelligence collective. Il est urgent de garantir pour tous les chercheurs, quelles que soient leurs orientations, l’autonomie de la recherche et l’expression libre des idées sans risquer les invectives et les menaces gouvernementales et/ou le lynchage médiatique, en mettant en place les moyens politiques et juridiques de leur protection. Sinon, nombre d’entre eux privilégieront le repli dans leur « tour d’ivoire ».
Les chercheurs ont aussi leur part à prendre dans l’assainissement du débat public en étant exigeants du point de vue de l’éthique de la discussion et en ne participant pas aux campagnes publiques contre tel ou tel de leurs collègues. Lorsque le débat s’envenime, leur devoir de savant et d’intellectuel est d’appeler au calme.
Liste complète des signataires
Collectif
« Race et sciences sociales », de Stéphane Beaud et Gérard Noiriel : de la « lutte des classes » à la « lutte des races », et inversement
Le livre du sociologue et de l’historien balaye des siècles de controverses et d’évolutions du concept de race et des « études raciales ». Mais il ne convainc pas pleinement.
Publié le 11 février 2021 à 08h00
Temps de Lecture 3 min.
« Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d’une catégorie », de Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, Agone, « Epreuves sociales », 422 p., 22 €.
Ces dernières années, peu de livres ont suscité, avant leur sortie, autant de réactions que Race et sciences sociales, du sociologue Stéphane Beaud et de l’historien Gérard Noiriel. La publication d’extraits dans le numéro de janvier du Monde diplomatique *a suffi à déchaîner une vague de protestations, beaucoup, comme le philosophe Norman Ajari sur son blog, y voyant une « incompréhension de la race » et « des effets réels du racisme ».
Etait-il trop tôt pour aboutir à une conclusion si tranchée, sans parler du tombereau d’injures et d’absurdes accusations de racisme sur les réseaux sociaux ? De Stéphane Beaud, dont les travaux sur les classes populaires font autorité, et Gérard Noiriel, pionnier de l’histoire de l’immigration en France, il y a lieu d’attendre qu’ils ne se contentent pas, lorsqu’ils portent un regard critique sur l’importance croissante des questions de race dans les sciences sociales, d’alimenter des polémiques sommaires.
Lire aussi cette rencontre (2019) : Stéphane Beaud, une sociologie par le bas
De fait, l’objet du livre paraît être de critiquer le concept de race, non parce qu’il serait inadéquat, mais parce qu’il tendrait à devenir hégémonique, et d’ouvrir, à l’inverse, le spectre interprétatif à l’ensemble des « variables » – « appartenance de classe, sexe, situation de génération, couleur de peau, etc. » –, qu’il s’agit de « faire jouer conjointement ».
Volonté de voir plus large
Sa structure même, composite, témoigne de cette volonté de voir plus large. Analyses de l’émergence de l’idée de race dans les champs politique et savant, récit du tournant des années 1970, qui débouchera dans les années 2000 sur une « institutionnalisation des études raciales », étude de cas : la généalogie du contemporain balaye des siècles de controverses, d’ajustements conceptuels, d’évolution des sociétés et de leurs représentations.
Il était difficile d’aller aussi loin et d’une manière aussi ample dans les soubassements de la question. La promesse d’ouverture du spectre est-elle pour autant tenue ? En réalité, des biais apparaissent bientôt, qui n’ont d’ailleurs rien à voir avec les errances qu’on a attribuées aux auteurs durant la polémique. Ainsi du choix de s’en tenir à la France : s’il est vrai, comme ils le répètent, que l’obsession pour la race est en grande part importée des Etats-Unis, pourquoi ne pas remonter à la source, et étudier les travaux d’auteurs américains ?
Lire aussi (2019) **: « Le Venin dans la plume », de Gérard Noiriel : une invitation à cesser de banaliser la réaction identitaire
Autre resserrement inopiné du champ, un glissement s’opère entre la volonté de multiplier les facteurs explicatifs et, sinon une réduction à un seul, du moins une conception hiérarchique de cette multiplicité. L’appartenance de classe finit par apparaître comme l’axe autour duquel les autres facteurs doivent s’ordonner, sans que, pour le coup, on ait le sentiment d’échapper à une pétition de principe, faute de distance critique suffisante – faute, aussi, que le glissement lui-même soit explicité.
Double registre
Tout se passe en définitive comme si le livre était soumis à un double registre, scientifique et politique. Le premier vise à défendre l’autonomie des sciences sociales à l’égard des passions qui traversent la société. Le second est travaillé par la nostalgie d’une époque où les luttes « contre toutes les formes d’exploitation et de discrimination » auraient tenu unies les « forces progressistes ». Nostalgie bien sûr respectable. Quelle autonomie cependant pour le chercheur, si cette passion-là doit l’emporter sur le désir de rendre compte finement des faits sociaux ?
En se succédant sans se confronter, chacun des registres amoindrit la portée de l’autre, rendant caduque la libération annoncée. De la « lutte des classes » à la « lutte des races », et inversement, l’affrontement se noue entre deux paradigmes concurrents, là où Beaud et Noiriel, après avoir montré ce qu’il y a de stérilisant dans l’arrimage au facteur « race », semblaient vouloir dépasser les alternatives trop simples. Leur livre, malgré la pertinence de tant de ses analyses, ne peut dès lors échapper au grief de représenter, en regard de son intuition fondamentale, une occasion manquée.
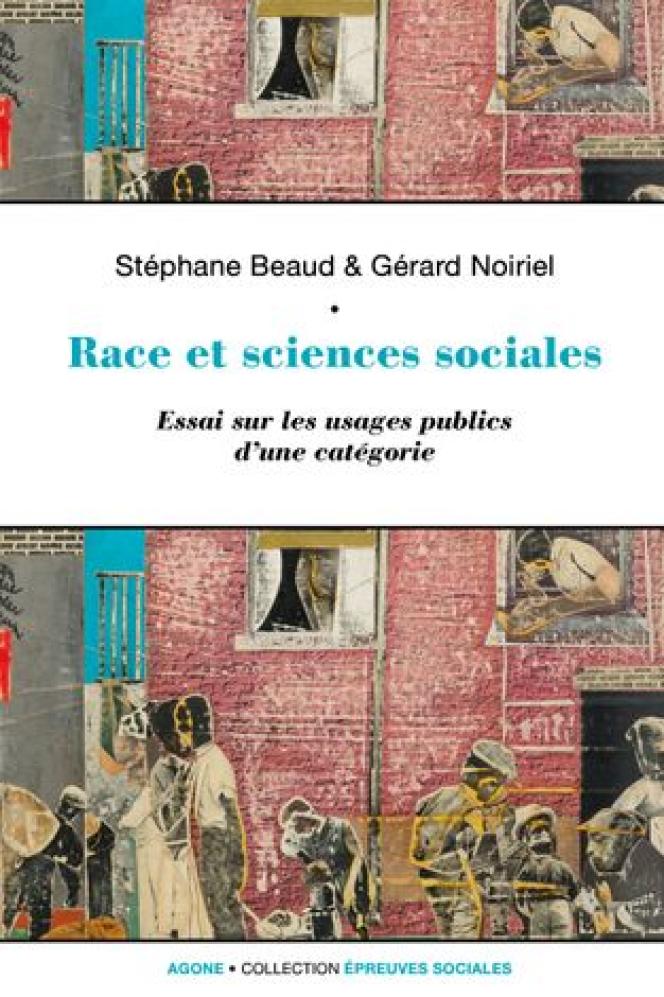
*Un militantisme qui divise les classes populaires
Impasses des politiques identitaires
S’il s’enracine dans une longue histoire, le langage identitaire a explosé avec les réseaux sociaux et les chaînes d’information en continu. Jadis réservé à la droite, il imprègne désormais les discours des militants et dirigeants politiques de tous bords, au point de transformer la «race» en variable bulldozer, qui écrase toutes les autres.
par Stéphane Beaud & Gérard Noiriel
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/01/BEAUD/62661

La question raciale a resurgi brutalement au cœur de l’actualité, le 25 mai 2020, lorsque les images du meurtre de George Floyd, filmé par une passante avec un smartphone, ont été diffusées en boucle sur les réseaux sociaux et les chaînes d’information en continu. L’assassinat de cet Afro-Américain par un policier blanc de Minneapolis a déclenché une immense vague d’émotion et de protestations dans le monde entier. Une multitude d’acteurs — militants antiracistes, journalistes, politiciens, intellectuels, experts, artistes, écrivains, etc. — sont intervenus aux États-Unis et ailleurs pour donner leur opinion sur ce crime et sur sa signification politique.
En France, depuis une quinzaine d’années, la dénonciation publique des crimes racistes ou de faits nourrissant des suspicions de discrimination raciale prend régulièrement dans les médias la forme d’«affaires raciales» qui s’autoalimentent presque sans fin. Après la pétition intitulée «Manifeste pour une République française antiraciste et décolonialisée», signée par cinquante-sept intellectuels et diffusée par le site Mediapart le 3 juillet 2020, l’hebdomadaire Marianne a riposté le 26 juillet 2020 en publiant un «Appel contre la racialisation de la question sociale», signé par plus de quatre-vingts personnalités et une vingtaine d’organisations.
La comparaison des deux pétitions montre comment fonctionne ce que Pierre Bourdieu appelait le jeu des «cécités croisées». La critique justifiée des violences racistes de certains policiers et du «racisme d’État» dans les colonies françaises jusqu’à la fin de la guerre d’Algérie conduit les pétitionnaires de Mediapart à défendre un projet politique focalisé sur les questions raciales et décoloniales occultant les facteurs sociaux. Inversement, les auteurs de l’appel paru dans Marianne rappellent le rôle central que joue la classe sociale dans les inégalités qui touchent la France d’aujourd’hui, mais leur propre combat identitaire, résumé par le slogan «Notre République laïque et sociale, une chance pour tous!», les pousse à affirmer que «notre pays n’a jamais connu la ségrégation»,affirmation qu’aucun historien, aucun sociologue sérieux ne peut cautionner. Ces affrontements identitaires, où chaque camp mobilise sa petite troupe d’intellectuels, placent les chercheurs qui défendent l’autonomie de leur travail dans une position impossible.
Américanisation de la vie publique
Cette racialisation du discours public a été largement servie par la révolution numérique qui a éclaté au cours des années 2000. Le développement extraordinaire de l’industrie médiatique a parachevé ce que Jürgen Habermas avait appelé la «colonisation du monde vécu (1)». Ces immenses machines à fabriquer de l’information sont alimentées vingt-quatre heures sur vingt-quatre grâce à un carburant qui exploite les gisements émotionnels enfouis en chacun de nous et qui nous font réagir instantanément et instinctivement face aux injustices, aux humiliations, aux agressions. La «fait-diversion» de l’actualité politique, née avec la presse de masse à la fin du XIXe siècle, a atteint aujourd’hui son paroxysme, substituant de plus en plus à l’analyse raisonnée des problèmes sociaux la dénonciation des coupables et la réhabilitation des victimes.
Les entreprises américaines mondialisées qui possèdent les réseaux sociaux ont brutalement accéléré ce processus, car les milliards d’individus que touchent ces réseaux ne sont plus seulement les récepteurs passifs des discours fabriqués par les médias, mais des acteurs qui participent à leur diffusion et même à leur élaboration. Les réseaux sociaux ont ainsi donné naissance à un espace public intermédiaire dépassant le cadre des États nationaux, contribuant fortement à l’américanisation des polémiques publiques, comme l’illustre la rapidité avec laquelle sont importées des expressions comme color-blind («aveugle à la couleur [de peau]»), «Black Lives Matter» («Les vies des Noirs comptent»), cancel culture(«culture du bannissement»), etc.
Le racisme étant aujourd’hui l’un des sujets politiques les plus aptes à mobiliser les émotions des citoyens, on comprend pourquoi sa dénonciation occupe une place de plus en plus centrale dans les médias. Constater ce fait, ce n’est pas — faut-il le rappeler? — nier ou minimiser la réalité du problème, et cela n’interdit en rien de constater en même temps que les expressions de formes décomplexées de racisme se multiplient elles aussi dans les médias (2). Les personnes issues de l’immigration postcoloniale (pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne) — qui appartiennent pour la majorité d’entre elles aux classes populaires (3) — ont été les premières victimes des effets de la crise économique à partir des années 1980. Elles ont subi des formes multiples de ségrégation, que ce soit dans l’accès au logement, à l’emploi ou dans leurs rapports avec les agents de l’État (contrôles d’identité «au faciès» par la police). En outre, ces générations sociales ont dû faire face politiquement à l’effondrement des espoirs collectifs portés au XXe siècle par le mouvement ouvrier et communiste.
Étant donné l’importance prise par les polémiques identitaires dans le débat public, il n’est pas surprenant qu’une partie de ces jeunes puissent exprimer leur rejet d’une société qui ne leur fait pas de place en privilégiant les éléments de leur identité personnelle que sont la religion, l’origine ou la race (définie par la couleur de peau). Malheureusement, les plus démunis d’entre eux sont privés, pour des raisons socio-économiques, des ressources qui leur permettraient de diversifier leurs appartenances et leurs affiliations. C’est ce qui explique qu’ils puissent se représenter le monde social de manière binaire et ethnicisée : le «nous» (de la cité, des jeunes Noirs ou Arabes, des exclus, mais aussi de plus en plus, semble-t-il, le «nous» musulman) versus le «eux» (des bourgeois, des «céfrans», des «gaulois», des Blancs, ou des athées, etc.). Si l’on veut pousser la lutte contre le racisme jusqu’au bout, il faut aussi combattre cet enfermement identitaire, car il empêche ces jeunes révoltés d’apercevoir que leur existence sociale est profondément déterminée par leur appartenance aux classes populaires.
Le langage racialisant qui présente la couleur de peau comme la variable déterminant l’ensemble des pratiques économiques, sociales et culturelles de nos concitoyens écrase la complexité et la finesse des relations sociales et des rapports de pouvoir. Toutes les enquêtes sociologiques, statistiques ou ethnographiques montrent pourtant que les variables sociales et ethniques agissent toujours de concert et avec des intensités différentes. Si tout l’art des sciences sociales consiste à démêler finement, selon les contextes (géographique, historique, interactionnel), le jeu des variables agissantes, il reste qu’on ne peut rien comprendre au monde dans lequel nous vivons si l’on oublie que la classe sociale d’appartenance (mesurée par le volume de capital économique et de capital culturel) reste, quoi qu’on en dise, le facteur déterminant autour duquel s’arriment les autres dimensions de l’identité des personnes.
La meilleure preuve est donnée par ceux qui ont bénéficié d’une mobilité sociale leur ayant permis d’accéder aux classes moyennes (enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, intermittents du spectacle, etc.), voire aux classes supérieures (journalistes de télévision ou de radio, écrivains, vedettes de la chanson ou du cinéma, etc.). La quasi-totalité de ces «transfuges de classe», comme on dit, mettent à profit les ressources que leur offre leur ascension sociale pour diversifier leurs attaches affectives, professionnelles ou culturelles, car ils savent pertinemment que c’est un cheminement vers davantage de liberté. Pourquoi les descendants des immigrations postcoloniales qui font toujours partie des classes populaires seraient-ils constamment ramenés à leur statut de victime et privés des moyens leur permettant d’accéder eux aussi à cette émancipation?
En occultant les relations de pouvoir qui structurent nos sociétés, ces discours identitaires contribuent à accentuer les divisions au sein des classes populaires; ce qui a été depuis les années 1980 le but recherché par les forces conservatrices pour briser l’hégémonie de la gauche. Placer le combat politique sur le plan racial en présentant tous les «Blancs» comme des privilégiés, c’est inciter ces derniers à se défendre avec le même genre d’arguments. Étant donné qu’en France les «Blancs» sont majoritaires, les «non-Blancs» sont condamnés à rester éternellement minoritaires. Croire que des actes de contrition à la Jeff Bezos (4) pourraient conduire les individus définis comme «Blancs» à renoncer à leurs «privilèges», c’est réduire la politique à des leçons de morale; ce qui est habituel aux États-Unis, et tend à le devenir en France.
Puisque l’expérience américaine est sans cesse mobilisée aujourd’hui lorsqu’il s’agit d’évoquer la question raciale, il n’est pas inutile de rappeler l’analyse qu’a présentée récemment le philosophe Michael Walzer pour expliquer l’échec relatif du mouvement antiraciste noir américain, échec qui explique à son tour pourquoi le racisme reste un problème central aux États-Unis. Lui qui fut, au début des années 1960, un étudiant pleinement engagé dans la lutte pour les droits civiques menée par les Noirs américains est revenu, cinquante ans plus tard, sur ce moment fondateur de son engagement politique. Il rappelle la force des liens noués dans le Sud entre des étudiants des grandes universités du Nord-Est (Harvard, Brandeis), notamment des étudiants juifs comme lui, et des pasteurs et militants noirs.
Dans le bilan qu’il dresse avec le recul, il soulève la question essentielle des alliances politiques à nouer dans le camp des forces progressistes : «Nous, nous pensions que le nationalisme noir, même s’il était compréhensible, était une erreur politique : pour se faire entendre, les minorités doivent s’engager dans des politiques de coalition, les Juifs ont appris cela il y a longtemps. Vous ne pouvez pas être isolés lorsque vous représentez 10 ou 2% de la population. Vous avez besoin d’alliés et vous devez élaborer des politiques qui favorisent les alliances. C’est ce qu’a refusé le nationalisme noir, et c’est cela qui l’a conduit, je crois, à une impasse (…). Les “politiques de l’identité” ont pris le dessus dans la vie politique américaine et ont conduit à des mouvements séparés : les Noirs, les Hispaniques, les femmes, les gays. Il n’y a pas eu de solidarité entre ces différentes formes de lutte pour la reconnaissance. “Black Lives Matter”, par exemple, est une expression fondamentale de la colère légitime des Noirs, liée notamment au comportement de la police. Mais les Hispaniques ne sont pas mieux traités; il n’y a pas, que je sache, de “Hispanic Lives Matter” et pas d’effort coordonné pour la création d’une coalition de groupes ethniques pour une réforme de la police (5).»
Étant donné l’américanisation de notre vie publique, on peut craindre malheureusement que le constat de Walzer soit en train de se vérifier en France également. Certes, de nombreuses voix se font entendre, plaidant régulièrement pour la «convergence des luttes». Cependant, celles et ceux qui militent dans ce sens doivent agir désormais au sein du nouveau système communicationnel qui s’est imposé avec la révolution numérique des années 2000. Auparavant, pour promouvoir une cause dans l’espace public, il fallait que celle-ci soit définie et défendue collectivement par des organisations rassemblant un grand nombre de militants. Aujourd’hui, il suffit que quelques activistes — qui s’érigent en porte-parole de telle ou telle revendication sans avoir été mandatés par personne — attirent l’attention des médias. D’où la multiplication des actions spectaculaires, comme celles des militants qui interdisent des pièces de théâtre au nom du combat antiraciste. La complaisance des journalistes à l’égard de ce type d’action alimente des polémiques qui divisent constamment les forces progressistes. Alors que la liberté d’expression et l’antiracisme avaient toujours été associés jusqu’ici par la gauche, ces coups de force ultraminoritaires finissent par les opposer l’une à l’autre. Ce qui ouvre un véritable boulevard aux conservateurs.
Stéphane Beaud & Gérard NoirielRespectivement sociologue et historien. Auteurs de Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d’une catégorie,Agone, Marseille, à paraître le 5 février 2021, dont ce texte est extrait.

(1) Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Fayard, Paris, 1987 (1re éd. : 1981).
(2) Gérard Noiriel**, Le Venin dans la plume. Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la République, La Découverte, Paris, 2019.
(3) Ce qui explique aussi, de manière directe, leur surreprésentation dans les faits divers rapportés par la presse locale, les actes de délinquance et la population carcérale.
(4) Référence au tweet d’Amazon en réaction à l’assassinat de George Floyd : «Le traitement injuste et brutal des Noirs dans notre pays doit cesser» (31 mai 2020).
(5) Michael Walzer et Astrid Von Busekist, Penser la justice, Albin Michel, coll. «Itinéraires du savoir», Paris, 2020.
**« Le Venin dans la plume », de Gérard Noiriel : une invitation à cesser de banaliser la réaction identitaire
« Une invitation à cesser de banaliser la réaction identitaire, relayée par une partie de l’élite médiatique«
Dans son dernier livre, l’historien compare la grammaire identitaire de deux pamphlétaires nationalistes, Eric Zemmour et Edouard Drumont.
Par Nicolas Truong Publié le 09 septembre 2019 à 09h34 – Mis à jour le 09 septembre 2019 à 18h19
Livre. Lorsqu’un polémiste nationaliste distille son « venin », que peut faire un historien ? Mobiliser son savoir, montrer, textes et archives à l’appui, comment le passé éclaire le présent et la façon dont le mort saisi le vif. Historien et directeur d’études à l’EHESS, Gérard Noiriel a reconnu dans les diatribes d’Eric Zemmour contre les « envahisseurs » ou le « lobby gay » la « grammaire identitaire » d’ Edouard Drumont (1844-1917), l’auteur antisémite de La France juive (1886). Certes, le chroniqueur du Figaro ne cible pas les juifs, mais les musulmans, reconnaît-il. Mais, selon Noiriel, la rhétorique serait la même.
La ressemblance des discours exhumés par le chercheur est en effet saisissante : une haine partagée du « parti de l’étranger », une même ritournelle du « c’était mieux avant », une critique quasi identique de la surévaluation de la Révolution (les « principes funestes de 89 », selon Drumont ; « notre passion immodérée pour la Révolution [qui] nous a aveuglés et pervertis », dixit Zemmour) ; la focalisation sur les racines chrétiennes de la France ; l’assimilation de la « décadence » de la France à la chute de Rome face à Carthage ; le rejet des minorités sexuelles (« le gay veut être un juif comme les autres », dit Zemmour, alors que Drumont perçoit les lesbiennes comme le signe de « la fin du monde »).
Lire aussi Gérard Noiriel : « Eric Zemmour légitime une forme de délinquance de la pensée »
Point important, explique Noiriel, « le “gay” occupe [chez Zemmour] très exactement la place du juif chez Drumont », comme en témoigne une phrase du chroniqueur du Figaro, qui assure sans ambages que « la rencontre entre l’homosexualité et le capitalisme est le non-dit des années 1970 ». Autre trait marquant et commun des deux imprécateurs, la « rhétorique de l’inversion », qui transforme les dominés en dominants. Ainsi en va-t-il des protestants lors de l’épisode sanglant de la Saint-Barthélemy (« les colombes étaient des soldats » car « les huguenots étaient les maîtres de Paris », écrit Drumont ; l’Eglise catholique a fini par céder à la « doxa dominante » et « s’y soumettre en faisant repentance pour la Saint-Barthélemy le 24 août 1997 », poursuit Zemmour).
Des différences, aussi
D’où l’appel à résister à « l’invasion » des « hordes puantes » (Drumont). D’où le recours à la peur afin de combattre la « colonisation intérieure » : « C’est vous qui devez vous soumettre au juif, vous plier à ses coutumes », écrit Drumont ; « Ce n’est pas à l’islam de s’adapter à la nation française, mais à la France de s’adapter à l’islam », pérore Zemmour. Bien sûr, les différences sont notables, à l’image de Drumont qui défend notamment les Arabes, selon lui victimes d’une « race abjecte » qui les aurait empêchés de bénéficier du décret Crémieux, qui permettait aux juifs d’Algérie d’accéder à la citoyenneté française. Et comparaison n’est pas toujours raison : la situation sociale des juifs en 1886 est-elle comparable à celles des musulmans en 2006 ? lui reprochera-t-on.
Mais l’historien sait aussi que la science peut être désarmée face à l’idéologie. Il sait que la raison ne gagne pas sans cœur. En un mot, il sait qu’il faut également mobiliser les émotions pour contrer les pulsions libérées par les propagandistes de la réaction. C’est pourquoi Gérard Noiriel évoque ses origines sociales, explique que, contrairement à Zemmour, qui regrette le manque de diversité du quartier parisien de son enfance, lui a choisi de rester dans sa banlieue afin d’y faire vivre davantage la mixité, et qu’il s’investit même dans une association d’éducation populaire, où il invite d’ailleurs le polémiste à faire un jour un tour.
Lire aussi Gérard Noiriel : « Les raisons de ma propre indignation »
Ce livre irritera sans aucun doute les professionnels de l’« anti-bien-pensance », largement dominante dans certains cercles médiatico-politiques. Et sera peut-être discuté par ses collègues historiens sur son usage – pertinent ou excessif – du comparatisme historique. Mais il est également un appel à la responsabilité de tous ceux – notamment journalistes et intellectuels – qui manient la parole publique. Une invitation à cesser de banaliser la réaction identitaire, relayée par une partie de l’élite médiatique, qui s’effarouche au même moment de l’extension des « populismes » à l’Europe entière.
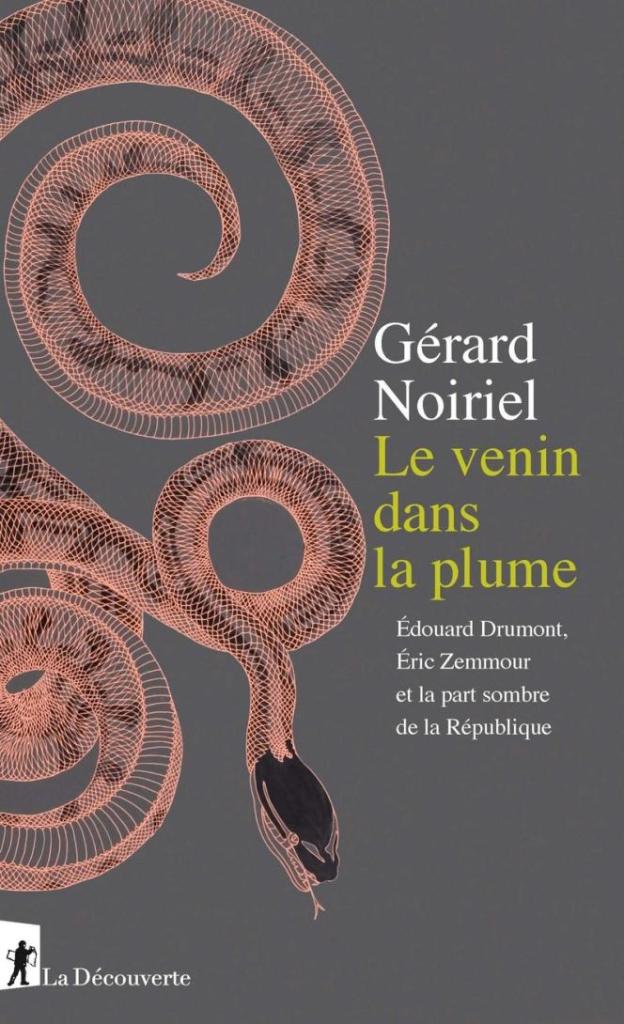
Le Venin dans la plume. Edouard Drumont, Eric Zemmour et la part sombre de la République, de Gérard Noiriel (La Découverte, 252 pages, 19 euros, à paraître le 12 septembre).
Nicolas Truong
Voir aussi:
La chasse aux sorcières dénoncée par 600 membres de l’enseignement supérieur à propos de l’islamophobie-gauchisme: https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/2021/02/21/9439/
Le sujet qui divise le plus les universitaires et intellectuel·les de France depuis maintenant plusieurs années: la pertinence du concept de «race» dans les sciences sociales avec Julien Talpin CNRS (Dans Slate soutien de la gauche américaine, une critique agressive de Beaud et Noiriel ) https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/2021/02/23/slate-autre-organe-de-la-gauche-americaine-en-rajoute-suite-a-la-parution-du-livre-de-lhistorien-gerard-noiriel-et-du-sociologue-stephane-beaud-races-et-sciences-sociales-avec-julien-talpin/
La représentation du genre dans la religion, à la source de l’écriture inclusive: https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/2021/02/21/la-representation-du-genre-dans-la-religion-a-la-source-de-lcriture-inclusive-dans-le-sillage-de-la-theologie-protestante-feministes/
Décoloniaux, racisés, intersectionalité, discours post-colonial, islamo-gauchisme, quelles sont et d’ou viennent ces nouvelles notions dans les recherches académiques ?https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/2021/02/19/decoloniaux-racises-intersectionalite-discours-post-colonial-islamo-gauchisme-quelles-sont-et-dou-viennent-ces-nouvelles-notions-dans-les-recherches-academiques/
« Islamo-gauchisme », un terme sans « aucune réalité scientifique »: https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/2021/02/18/frederique-vidal-suscite-lindigation-en-demandant-au-cnrs-une-enquete-sur-lislamo-gauchisme-a-luniversite/
Pour Médiapart, les recherches sur l’islamo-gauchisme et l’intersectionalité pour Médiapart sont marginales, et les chercheurs qui s’y consacrent sont harcelés par « les universalistes chauvins » https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/2021/02/24/pour-mediapart-les-recherches-sur-les-questions-raciales-et-lintersectionalite-sont-marginales/
Rejeter en bloc Marx, les Lumières et les valeurs de la République, il fallait le faire: Le Parti des indigènes de la République, a adopté depuis longtemps « un objectif de dénonciation de la racisation opérée en France » (Houria Bouteldja en 2015): https://jeansantepolitiqueenvironnement.wordpress.com/2021/02/21/le-parti-des-indigenes-de-la-republique-a-adopte-depuis-longtemps-un-objectif-de-denonciation-de-la-racisation-operee-en-france-il-clive-la-gauche-antiraciste-interview-de-houria-bouteldja-en-2/
Un avis sur « Le débat sur la réaction identitaire fait rage: « un tribunal médiatique (dont Valeurs actuelles, Médiapart, Slate…) siège en permanence, où les procès à charge remplacent les débats d’idées. » »