Virginie Maris, philosophe en défense de la nature récalcitrante
Etroitement associée aux recherches en sciences du vivant, cette philosophe de l’environnement prône une approche pragmatique de sa discipline, tout entière au service des espèces et des espaces protégés.
Par Catherine Vincent Publié aujourd’hui à 06h30
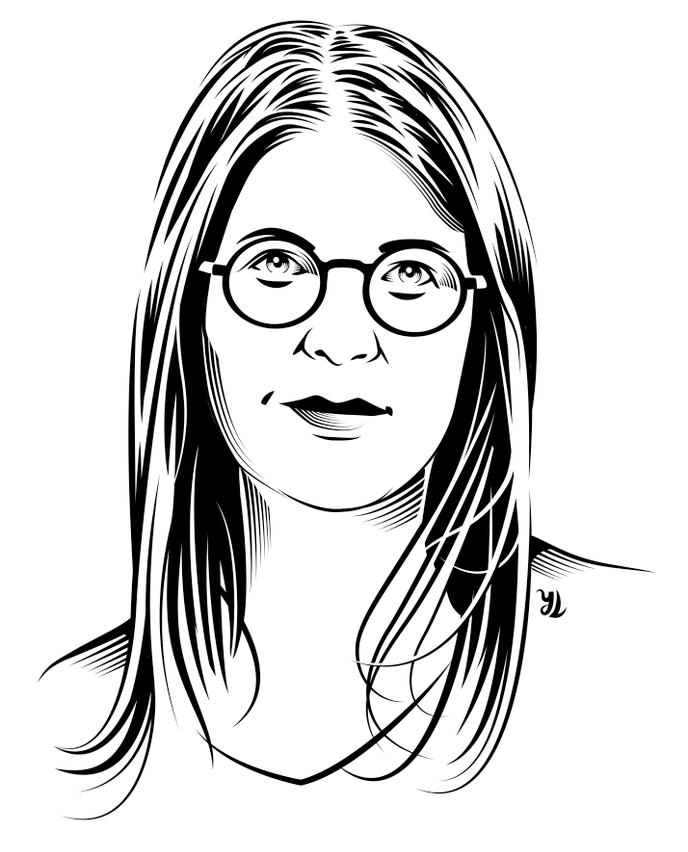
Portrait. Arrimer son masque sur les oreilles pour rencontrer une philosophe spécialisée dans la gestion du vivant, l’interroger en haussant le ton pour franchir le mètre de distanciation physique qui nous sépare, cela conduit quasi mécaniquement à cette question : « Et la situation actuelle, vous en pensez quoi ? » Virginie Maris n’hésite guère. « Cela ne me fait pas du tout penser, ni produire. Cela me plonge dans une grande perplexité. »
On s’étonne, elle précise. « Pour moi qui travaille depuis longtemps sur le rapport de l’homme à la nature, la pandémie de Covid-19 n’est pas surprenante. Cela fait des années que les écologues et les épidémiologistes s’y attendent. » D’où vient alors cette perplexité ? « De notre conformité collective. Après une année 2019 parsemée de contestations tant sur le plan climatique que social, je découvre que nous sommes domesticables. Qu’il nous est possible, presque du jour au lendemain, de reprendre nos activités, masqués et dociles, comme des zombies qui traversent l’espace public. Et cela me fait un peu peur. »
Limiter l’emprise humaine sur la planète
Docile ? On doute qu’elle le soit. A 42 ans, Virginie Maris présente à tout le moins un profil de chercheuse atypique. D’abord, parce qu’elle travaille depuis plus de dix ans dans un laboratoire spécialisé dans les sciences du vivant, le prestigieux Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE) de Montpellier – ce qui, pour une philosophe, n’est pas si courant. Ensuite, parce qu’elle entretient « un rapport presque instrumental à la philosophie », qu’elle envisage avant tout comme un outil « au service d’un enjeu politique et social majeur » – en l’occurrence, l’effondrement de la biodiversité. Enfin, parce qu’elle défend une conception de la préservation de la nature à rebours de la cohabitation prônée par d’autres, en insistant sur la nécessité de limiter l’emprise humaine sur la planète. Un thème qu’elle développe dans son dernier ouvrage, La Part sauvage du monde (Seuil, 2018), titre qui ne doit rien au hasard.
« Je vois dans le sauvage le caractère absolument subversif, récalcitrant d’une nature qui, de part en part, nous échappe et fuit ce grand projet de gestion du monde »
« Alors que notre tradition occidentale survalorise la culture, la domestication et le contrôle du vivant, je vois dans le sauvage le caractère absolument subversif, récalcitrant d’une nature qui, de part en part, nous échappe et fuit ce grand projet de gestion du monde », détaille-t-elle. Penser la nature dans sa différence, comme ce qui est irréductiblement extérieur aux affaires humaines : la posture ne va pas sans effort. Elle l’oblige notamment à prendre ses distances « avec des alliés et des amis, qui s’occupent du vivre-ensemble plus que de la séparation. Ceux qui inventent de nouvelles diplomaties interspécifiques, ceux qui se soucient des friches et des villes ou soutiennent une paysannerie durable, ceux qui défendent des façons plus douces de “faire avec” la nature ». Pas question, pour Virginie Maris, de disqualifier ces approches. Mais sa priorité est ailleurs. Il nous faut aussi, soutient-elle, préserver des espaces et des territoires « où les êtres de nature peuvent faire sans nous ». Autrement dit, réinvestir à nouveau frais le « grand partage », tel que défini par l’anthropologue Philippe Descola, entre les humains et leur production d’une part, le monde naturel d’autre part.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Philippe Descola : « Nous sommes devenus des virus pour la planète »
Cette sensibilité, qui l’a menée à faire une thèse de philosophie sur la biodiversité, lui est venue sur le tard. « Quand j’étais enfant, je détestais les petites bêtes. J’ai grandi à Annecy, près de la montagne, mais mes parents ne sont pas des écolos », confie-t-elle pourtant. Un début de cursus en biologie éveille son intérêt pour le vivant, son adhésion à Greenpeace lui ouvre les yeux sur « la tragédie » que constitue l’extinction des espèces, mais la jeune étudiante n’en continue pas moins de s’orienter vers la philosophie des mathématiques. Jusqu’à son « épiphanie ». « J’ai rencontré l’éthique environnementale en étant chargée de cours, et j’ai soudain compris que la philosophie pouvait aussi s’intéresser à ce qui m’animait comme citoyenne. » Depuis, ces deux facettes d’elle-même n’ont plus cessé de s’alimenter l’une l’autre. Dans un écosystème on ne peut plus favorable à cette symbiose, puisque le CEFE, dès la fin des années 1990, a eu la clairvoyance de s’ouvrir aux sciences humaines et sociales. Aux côtés des écologues et des évolutionnistes, on y trouve des géographes, des anthropologues, des ethnobotanistes… Lorsqu’elle rejoint l’équipe en 2009, juste après l’obtention de son poste au CNRS, la jeune chercheuse arrive dans un contexte préparé à la recevoir.
Opinions marquées sur l’éthique
Philippe Jarne, qui s’apprêtait alors à prendre la direction du CEFE, se souvient très bien de ce moment : « Elle nous avait contactés quelques jours avant la date limite de dépôt des dossiers, pendant les vacances de Noël… On a sauté sur sa candidature. » Pour ce biologiste de l’évolution, son regard de philosophe est« bien plus qu’une cerise sur le gâteau. Virginie a des opinions assez marquées sur l’éthique et sur le positionnement d’un écologue dans la société. Cela nous oblige à réfléchir différemment, à replacer ce qu’on fait dans une vision plus large du monde ». Quelle valeur attribue-t-on à la biodiversité ? Comment contourner le vocabulaire de la biologie des invasions, calqué sur un discours militaire et parfois xénophobe ? Avec son approche pragmatique de la philosophie, les questions qu’elle soulève s’ancrent directement dans la réalité de l’écologie. « Virginie a la double culture. Avoir quelqu’un comme elle à portée d’oreilles et de voix, c’est extrêmement enrichissant », ajoute Jean-Louis Martin, autre collègue du CEFE avec qui elle a cosigné plusieurs publications.
Après Nature à vendre. Les limites des services écosystémiques (Quae, 2014) et Philosophie de la biodiversité (Buchet/Chastel, 2016), La Part sauvage du monde est son troisième ouvrage. Mais l’écriture ne constitue qu’une petite partie de ses activités. Outre ses recherches interdisciplinaires au CEFE, Virginie Maris consacre une bonne part de son temps de travail à diverses structures institutionnelles, tel le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Une interface entre sciences, politiques publiques et gestion de la nature qui lui permet d’être « dans le cœur du réacteur » de la décision politique. Avec son lot de rencontres, mais aussi de désillusions quant à la capacité réelle de l’Etat à se saisir des enjeux de la biodiversité.
Engagement en politique
« Le verrou, c’est la perméabilité entre les intérêts économiques et les institutions garantes du bien public, autrement dit la force des lobbys », résume-t-elle. Pour cette chercheuse habitée par « un sentiment d’urgence et d’effectivité », l’espérance dans l’action politique s’est soudain déplacée, à l’automne dernier, dans une liste écocitoyenne pour les municipales d’Arles (Bouches-du-Rhône), où elle habite de longue date. Après une campagne « de bric et de broc », celle-ci a remporté 8,5 % des voix au premier tour. Un score suffisant pour que Virginie Maris figure désormais dans l’opposition au conseil du nouveau maire, Patrick de Carolis. Avec un enthousiasme tout neuf. « A ma petite échelle, je ne peux rien faire contre les lobbys. Mais contribuer à inventer un cadre dans lequel les citoyens trouvent un intérêt à se battre collectivement pour le bien commun, c’est peut-être à ma portée. » Article réservé à nos abonnés Lire aussi « On doit changer la société » : rencontre avec des pionniers de la nouvelle économie du partage
De « la montée en compétence et en créativité collective » à laquelle elle a participé pendant cette campagne, elle parle encore avec des étoiles dans les yeux. Comme pour tenter de compenser la déception causée par « le rendez-vous tragiquement manqué avec une réflexion de fond qu’aurait pu susciter la crise sanitaire actuelle, sur l’organisation de la société, du travail, des productions alimentaires et matérielles ». Une autre raison, et non des moindres, de perplexité.