« La pratique du pouvoir n’a pas changé Trump. C’est l’inverse qui s’est produit » : extraits du livre « Amérique années Trump »
Jérôme Cartillier et Gilles Paris, correspondants de l’AFP et du « Monde » à Washington, décryptent dans leur ouvrage les failles de l’Amérique à travers le bruit et l’agitation d’une présidence hors norme.
Par Jérôme Cartillier et Gilles Paris Publié le 17 septembre 2020 à 06h00 – Mis à jour le 18 septembre 2020 à 16h20
Bonnes feuilles. La pratique du pouvoir n’a pas changé Donald Trump. C’est l’inverse qui s’est produit. Au cours de quatre années d’un mandat unique en son genre, l’ancien homme d’affaires a installé un autre exercice de la politique, qui fait des émules à travers le monde. Il est parvenu à ses fins sans coup de force spectaculaire. Il n’a pas brisé les piliers de la démocratie américaine. Son opposition a pu user des leviers mis à sa disposition, sans en négliger aucun. La justice a été régulièrement saisie et a tranché. La presse a enquêté, dévoilé et interpellé, même si elle l’a payé en insultes présidentielles qui ont ébranlé ce contre-pouvoir.
Il s’est contenté de ne pas respecter les règles observées avant lui. Chaque fois qu’il a semé le trouble, y compris en instillant le doute sur la sincérité du scrutin présidentiel de 2020 en évoquant à nouveau sans preuves, comme en 2016, une fraude potentiellement massive, il a persisté. Les Américains ont découvert qu’il était possible, sans encourir de sanction majeure en cours de mandat, de s’affranchir de normes, souvent non écrites, auxquelles ses prédécesseurs avaient généralement consenti parce qu’ils les considéraient comme la base d’un contrat social.
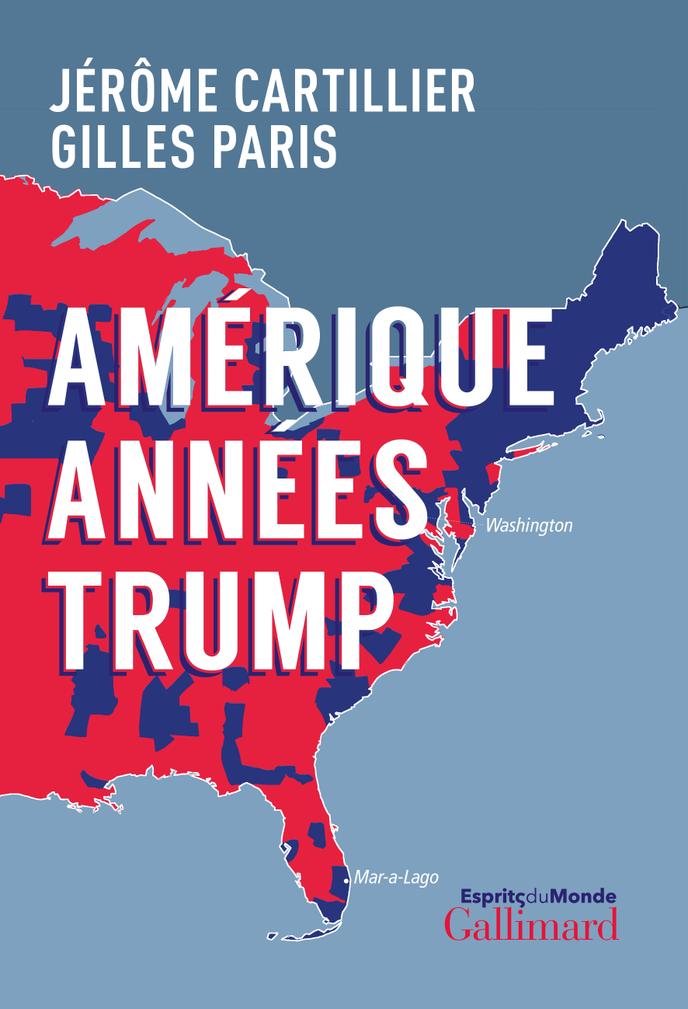
Pratique politique destructrice
Il a pu compter sur le renoncement, l’apathie et enfin la complicité du Parti républicain, y compris de la part de ceux qui, comme Lindsey Graham, avaient précocement estimé qu’il représentait un « désastre absolu » pour le Grand Old Party, et qu’il pourrait « détruire le conservatisme ». « Il nous faudra une génération pour nous en remettre », avait assuré le sénateur. Ceux qui avaient sonné l’alarme se sont contentés de chevaucher le tigre sans chercher à peser sur sa course.
Des décennies de choix de la surenchère ont préparé le terrain. La capacité d’attraction d’un Ronald Reagan a été remplacée par une quête de la pureté idéologique et par la chasse aux modérés. Elle a commencé avec l’offensive du « Contrat pour l’Amérique », en 1994, dirigé contre un démocrate centriste, Bill Clinton, et s’est poursuivie avec le mouvement quasi insurrectionnel du Tea Party, quinze ans plus tard. Le Grand Old Party a laissé infuser une pratique politique destructrice assimilée à la guerre civile permanente. Puis il s’est retrouvé subjugué par un tribun qui a pris son contrôle pour y imposer ses propres priorités.
Donald Trump a réussi dans son entreprise sans chercher à susciter l’adhésion au-delà de son camp. Le diviseur en chef des Etats-Unis a tout fait au contraire pour entretenir une loyauté frisant souvent l’adulation en veillant à répondre aux demandes spécifiques de sa coalition : réforme fiscale favorable aux plus fortunés, dérégulation environnementale ou sociale, exaltation des valeurs de la droite religieuse, entretien des ressorts ultranationalistes. (…)
Rien n’a eu de prise sur les fidèles
En contrepartie, le peuple trumpiste n’a été ébranlé par aucun des travers du président. Le manque de sang-froid, le court-termisme, l’impatience, le goût pour la flatterie, l’absence de compassion, l’incapacité à fédérer, la défiance vis-à-vis de la science, le mépris des fonctionnaires fédéraux, la recherche de boucs émissaires, la xénophobie à peine dissimulée derrière le slogan « America First », l’incapacité à s’entourer, le prisme déformant de la téléréalité appliqué à la politique ou les rancœurs aveuglantes : rien n’a eu de prise sur ses fidèles. Mal élu en 2016, défait lors des élections de mi-mandat pour la Chambre des représentants deux ans plus tard, ce président impérial a été le premier à occuper cette fonction sans jamais avoir obtenu auprès de l’opinion américaine, à un moment ou un autre, dans les urnes ou dans les sondages, une majorité absolue de soutiens.Lire aussi « Malgré son impopularité, Trump conserve une base solide »
Accroché à une poignée de formules qui ont fait mouche en campagne, prisonnier d’une vision manichéenne du pouvoir fondée sur un affrontement bloc contre bloc sans nuance, il a réussi à conserver la fidélité de l’essentiel de son socle électoral, ce qui lui a permis d’espérer un nouvel exploit dans les urnes. Mais le trumpisme qui permet d’occuper le terrain de façon spectaculaire montre ses limites en temps de crise : il n’offre pas de méthode de gouvernement. Dans la dernière ligne droite de son mandat, Donald Trump a peiné à sentir les secousses qui traversent l’Amérique bien au-delà des clivages traditionnels. Il a minoré ou caricaturé le mouvement de protestation contre les violences policières au moment où le pays, profondément ébranlé, a tenté de retrouver une boussole morale.Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Trump est du bon côté de l’histoire » : en Virginie, les nostalgiques du Sud esclavagiste défendent leur « héritage »
Selon une analyse du New York Times, entre 15 et 26 millions de personnes ont participé à des manifestations consécutives à la mort de George Floyd au cours du mois de juin 2020, ce qui en fait le plus grand mouvement de l’histoire américaine. Cette présidence dévorante et la mise sous tension permanente du pays ne sont pas sans périls. L’un de ces dangers est résumé par un dessin de Roz Chast publié en 2019 dans l’hebdomadaire The New Yorker. Il met en scène une autruche plongeant la tête dans le sable. Elle atteint une première strate intitulée « Je ne peux plus supporter aucune information concernant Trump ». Mais elle poursuit son effort et s’enfonce vers deux nouvelles strates, « Je ne peux plus supporter aucune information », puis enfin « Je ne peux plus rien supporter du tout ». Il résume un sentiment tenace, par essence difficile à quantifier : un épuisement de l’Amérique. (…)
Biden, une promesse de calme
Face à lui, son adversaire démocrate Joe Biden a d’abord proposé comme alternative une présidence moins tapageuse, moins bruyante. Dans une période de grandes secousses, il a fait à l’Amérique une promesse de calme. Lorsqu’il s’est lancé au printemps 2019, à l’âge de 76 ans, promettant de défendre les « valeurs fondamentales » des Etats-Unis et leur rang dans le monde, il n’a pas, tant s’en faut, suscité un enthousiasme similaire à celui provoqué, douze ans plus tôt, par l’annonce de la candidature d’un jeune sénateur de l’Illinois nommé Barack Obama. Pourtant, il a de facto rassemblé son camp. En choisissant comme colistière la sénatrice de Californie Kamala Harris, une femme noire de plus de vingt ans sa cadette, ayant des origines indiennes et jamaïcaines, il a envoyé un signal fort – et calculé – à son parti et au pays.
« En accédant au pouvoir sans avoir jamais servi l’État de quelque manière, Donald Trump a ouvert en outre la voie à d’autres aventures similaires »
Son pari ? S’imposer dans une posture de pacificateur. Au sein de la famille démocrate, dans laquelle les divisions entre le courant centriste et l’aile gauche incarnée par Bernie Sanders se sont payées au prix fort en 2016. A l’échelle du pays, aussi, où il espère, par son parcours et sa personnalité, bénéficier d’une oreille attentive au cœur de l’électorat de Trump : chez les ouvriers, les retraités et les femmes non diplômées. Au-delà des frontières américaines enfin, pour rassurer des alliés ébranlés.
Pour Donald Trump, un autre écueil réside dans l’incapacité à proposer un horizon à un peuple habitué à se mesurer à de nouvelles frontières. S’il joue avec brio du ressort de la nostalgie, excelle dans l’invocation d’un passé mythifié, difficile à définir, il peine à projeter son pays vers les enjeux qui l’attendent. Empêché de meetings pendant la crise du Covid-19, il ressasse son impatience de revenir au « bon vieux temps », et reste sourd aux interrogations que la crise sanitaire alimente sur les modes de vie.
Comme prisonnier de son âge, il ne parle pas à la jeunesse américaine qui le rejette massivement. Il redoute l’horloge démographique qui va sonner la fin de la majorité blanche aux Etats-Unis. Il campe dans le déni sur l’environnement, mentionne peu les technologies nouvelles et leurs défis pour l’économie, à commencer par les révolutions à venir de l’intelligence artificielle. Il s’est défini en 2016 comme la « dernière chance » pour éviter une transformation jugée dévastatrice vers des Etats-Unis encore plus métissés, alors que cette évolution apparaît inéluctable.
La tentation est forte de réduire cette présidence unique en son genre à une aberration, à une simple parenthèse permise par la conjonction inattendue de facteurs improbables. Donald Trump, lorsqu’il abandonnera la Maison Blanche, laissera cependant derrière lui une double réalité : une pratique de la politique, et de possibles héritiers dans une nouvelle génération d’élus républicains tels que l’ambitieux sénateur de l’Arkansas Tom Cotton, admirateur zélé du président. En accédant au pouvoir sans avoir jamais servi l’Etat de quelque manière, Donald Trump a ouvert en outre la voie à d’autres aventures similaires. Au point que personne n’écarte qu’elles puissent être incarnées par le polémiste Tucker Carlson, de Fox News, défenseur décomplexé d’un ethnonationalisme américain.
« Le républicain a promis de rendre l’Amérique à nouveau “grande”, mais elle apparaît désormais recroquevillée, diminuée et incertaine »
Ce legs trumpien risque donc de peser durablement sur le Grand Old Party, sur son message comme sur ses représentants. Il peut également s’étendre au Parti démocrate, en accentuant par réaction un enfermement dans une radicalité symétrique. Donald Trump n’a pas fait mystère de ce projet par ses ingérences permanentes dans les débats démocrates, tentant inlassablement de favoriser une aile gauche plus facile à réduire à une menace « socialiste ». Donald Trump s’est imposé à son pays à sa manière, à ses conditions, mais il l’a payé d’un prix fort au-delà des frontières américaines. Le républicain a promis de rendre l’Amérique à nouveau « grande », mais elle apparaît désormais recroquevillée, diminuée et incertaine. La crise sanitaire mondiale provoquée par le Covid-19 a mis en exergue de manière accablante les conséquences en chaîne entraînées par le slogan « America First ». (…)
La pandémie a illustré cruellement une réalité : en négligeant le levier du soft power, cette capacité d’attraction et de persuasion qui ne repose ni sur la contrainte militaire ni sur la contrainte économique, le président a travaillé contre les intérêts de son pays. Cette désinvolture ne se limite pas aux Nations unies, où Washington refuse d’endosser ses responsabilités internationales et où la Chine qu’il entend officiellement endiguer profite de l’absence américaine pour augmenter son influence. Chaque fois que les Etats-Unis de Donald Trump ont tranché de manière unilatérale, sur le climat, sur le commerce ou sur l’Iran, ils se sont isolés.
Défiance à l’égard des alliés européens
Arrivé au pouvoir en homme neuf malgré ses 70 ans, Donald Trump se trouvait pourtant dans une situation unique. Tenu par aucun héritage, libre de toute attache par rapport aux engagements internationaux de son pays, il aurait pu s’engager dans un état des lieux sans concessions. Les interrogations ne manquent pas, de la place de son pays au Moyen-Orient à sa relation avec l’Europe. Incapable d’embrasser la tâche, mal entouré, il s’est contenté de remplacer ce qu’il considérait comme un dogmatisme par un autre, plus caricatural. Il a revendiqué un « réalisme » guidé par les « principes », mais ces derniers se sont réduits à quelques réflexes : la dénonciation de la mondialisation, posture dont la pandémie a souligné la vacuité, et la défiance systématique à l’égard des alliés, à commencer par l’Allemagne et la France.Article réservé à nos abonnés Lire aussi Europe, Chine… : « Quand Donald Trump voit des ennemis partout »
Il n’a pas été le premier à les décrire comme des « passagers clandestins ». Mais jamais avant lui un président des Etats-Unis n’avait autant jeté le trouble et semé la confusion en affaiblissant les valeurs communes des démocraties libérales. L’inertie propre aux relations internationales a bridé les velléités de rupture. Elles finiraient pourtant par l’emporter si rien ne venait s’opposer à la boule de démolition mise en branle par l’ancien homme d’affaires. Et elles feraient alors le jeu des adversaires pourtant communs, russes ou chinois. Car Donald Trump a instillé le doute et l’incertitude sur la fiabilité des Etats-Unis, la volonté ou la capacité à respecter leur parole et leur signature apposée sur de nombreux traités.
« La croyance en la supériorité du modèle américain est partout battue en brèche, y compris chez les Américains, et sans doute pour la première fois de leur histoire »
Ce trouble explique une attente anxieuse, à Bruxelles, Tokyo, Jérusalem, Riyad ou Ankara, sans précédent dans l’histoire récente, sur la direction que ce pays va emprunter. Au tournant du siècle, l’ancienne secrétaire d’Etat Madeleine Albright avait défini son pays comme « la nation indispensable »parce que, disait-elle, « nous voyons plus loin que d’autres pays dans le futur, et nous voyons ici le danger pour nous tous ». La réaction face à la pandémie a montré combien cette certitude appartient au passé.
Les Etats-Unis ne souffrent pas seulement de ce renoncement au rôle de métronome, si imparfait et critiqué soit-il. La croyance en la supériorité du modèle américain est partout battue en brèche, y compris chez les Américains, et sans doute pour la première fois de leur histoire. Une étude du Pew Research Center a montré qu’en 2019 seuls 15 % des Américains âgés de 18 à 29 ans considéraient leur pays comme « au-dessus des autres ». Les jeux ne sont pas faits.
La puissance de l’attraction américaine, par-delà la panne de leadership, réside d’abord dans sa transparence par opposition à l’opacité de la Chine. Elle se manifeste aussi dans ses universités, sa recherche, et sa vitalité culturelle. Et si Washington ne regarde qu’à l’intérieur de ses frontières, le monde entier continue de suivre la crise sanitaire à partir des chiffres de la Johns Hopkins University, à Baltimore. Mais la capacité à répondre sur la durée au défi du redressement de son économie, comme à celui des criantes inégalités raciales qui minent sa société, pèsera d’un poids écrasant sur le regard qui sera à l’avenir porté sur la première puissance mondiale. Surtout après l’invasion désastreuse de l’Irak, en 2003, puis la crise financière de 2008, deux chocs enclenchés à chaque fois par « la nation indispensable ».Article réservé à nos abonnés Lire aussi Président Trump, an IV : l’insurgé de la Maison Blanche
Au cœur des traumatismes du Covid-19 et de la mort de George Floyd, Donald Trump a choisi, lors d’une longue allocution débridée dans les jardins de la Maison Blanche sous un soleil de plomb, une formule pour vanter une Amérique qui, grâce à lui, serait de nouveau respectée. Au crépuscule d’un mandat de repli, de mise en pièces des alliances et de célébration jusqu’à la caricature de la devise « America First », elle sonnait pourtant étrangement : « Nous sommes une force positive. Nous sommes, d’une certaine manière, la clé du monde. »
« Amérique années Trump », de Jérôme Cartillier et Gilles Paris (Gallimard, 400 pages, 23 euros).
Jérôme Cartillier et Gilles Paris